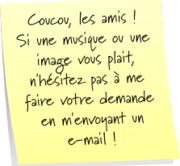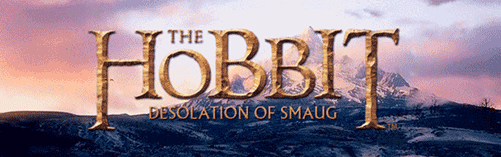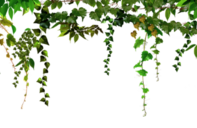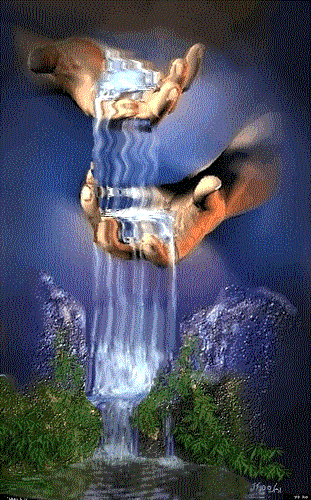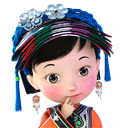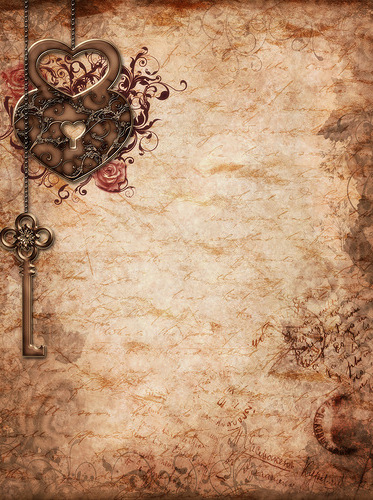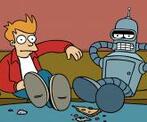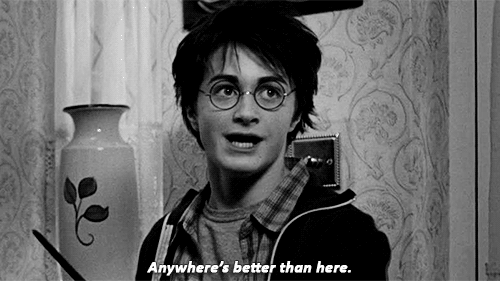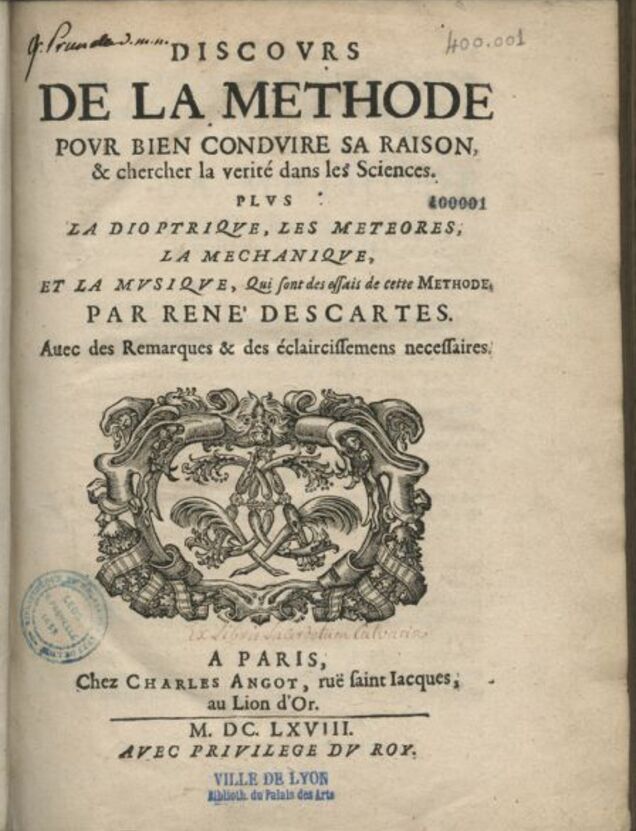-
Par Salomé ATTIA le 15 Juillet 2015 à 13:36
Discours de la méthode
Discours de la méthode
de René DescartesPréface
POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON ETCHERCHER LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES
Si ce discours semble trop long pour être tout lu en une fois,on le pourra distinguer en six parties. Et, en la première, on trouvera diverses considérations touchant les sciences. En la seconde, les principales règles de la méthode que l’auteur a cherchée. En la 3, quelques-unes de celles de la morale qu’il a tirée de cette méthode. En la 4, les raisons par lesquelles il prouve l’existence de Dieu et de l’âme humaine, qui sont les fondements de sa métaphysique. En la 5, l’ordre des questions de physique qu’il a cherchées, et particulièrement l’explication du mouvement du cœur et de quelques autres difficultés qui appartiennent à la médecine, puis aussi la différence qui est entre notre âme et celle des bêtes. Et en la dernière, quelles choses il croit être requises pour aller plus avant en la recherche de la nature qu’il n’a été, et quelles raisons l’ont fait écrire.
Partie 1
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes; et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus; et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent, et qui s’en éloignent.
Pour moi, je n’ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun; même j’ai souvent souhaité d’avoir la pensée ou la prompte, ou l’imagination aussi-nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente, que quelques autres. Et je ne sache point de qualités que celles-ci, qui servent à la perfection de l’esprit : car pour la raison, ou le sens, d’autant qu’elle est la seule chose qui nous rend hommes, et nous distingue des bêtes, je veux croire qu’elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci l’opinion commune des philosophes, qui disent qu’il n’y a du plus et du moins qu’entre les accidents, et non point entre les formes, ou natures, des individus d’une même espèce.
Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d’heur, de m’être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins,qui m’ont conduit à des considérations et des maximes, dont j’ai formé une méthode, par laquelle il me semble que j’ai moyen d’augmenter par degrés ma connaissance, et de l’élever peu à peu au plus haut point, auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d’atteindre. Car j’en ai déjà recueilli de tels fruits, qu’encore qu’aux jugements que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de ladéfiance, plutôt que vers celui de la présomption; et que,regardant d’un oeil de philosophe les diverses actions etentreprises de tous les hommes, il n’y en ait quasi aucune qui neme semble vaine et inutile; je ne laisse pas de recevoir uneextrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en larecherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pourl’avenir, que si, entre les occupations des hommes purement hommes,il y en a quelqu’une qui soit solidement bonne et importante, j’osecroire que c’est celle que j’ai choisie.
Toutefois il se peut faire que je me trompe, et ce n’estpeut-être qu’un peu de cuivre et de verre que je prends pour del’or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nousméprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements denos amis nous doivent être suspects, lorsqu’ils sont en notrefaveur. Mais je serai bien aise de faire voir, en ce discours,quels sont les chemins que j’ai suivis, et d’y représenter ma viecomme en un tableau, afin que chacun en puisse juger, etqu’apprenant du bruit commun les opinions qu’on en aura, ce soit unnouveau moyen de m’instruire, que j’ajouterai à ceux dont j’aicoutume de me servir.
Ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode quechacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement defaire voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la mienne. Ceuxqui se mêlent de donner des préceptes, se doivent estimer plushabiles que ceux auxquels ils les donnent; et s’ils manquent en lamoindre chose, ils en sont blâmables. Mais, ne proposant cet écritque comme une histoire, ou, si vous l’aimez mieux, que comme unefable, en laquelle, parmi quelques exemples qu’on peut imiter, onen trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu’on aura raison dene pas suivre, j’espère qu’il sera utile à quelques-uns, sans êtrenuisible à personne, et que tous me sauront gré de mafranchise.
J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et parce qu’on mepersuadait que, par leur moyen, on pouvait acquérir uneconnaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie,j’avais un extrême désir de les apprendre. Mais, sitôt que j’eusachevé tout ce cours d’études, au bout duquel on a coutume d’êtrereçu au rang des doctes, je changeai entièrement d’opinion. Car jeme trouvais embarrassé de tant de doutes et d’erreurs, qu’il mesemblait n’avoir fait autre profit, en tâchant de m’instruire,sinon que j’avais découvert de plus en plus mon ignorance. Etnéanmoins j’étais en l’une des plus célèbres écoles de l’Europe, oùje pensais qu’il devait y avoir de savants hommes, s’il y en avaiten aucun endroit de la terre. J’y avais appris tout ce que lesautres y apprenaient; et même, ne m’étant pas contenté des sciencesqu’on nous enseignait, j’avais parcouru tous les livres, traitantde celles qu’on estime les plus curieuses et les plus rares, quiavaient pu tomber entre mes mains. Avec cela, je savais lesjugements que les autres faisaient de moi; et je ne voyais pointqu’on m’estimât inférieur à mes condisciples, bien qu’il y en eûtdéjà entre eux quelques-uns, qu’on destinait à remplir les placesde nos maîtres. Et enfin notre siècle me semblait aussifleurissant, et aussi fertile en bons esprits, qu’ait été aucun desprécédents. Ce qui me faisait prendre la liberté de juger par moide tous les autres, et de penser qu’il n’y avait aucune doctrinedans le monde qui fût telle qu’on m’avait auparavant faitespérer.
Je ne laissais pas toutefois d’estimer les exercices, auxquelson s’occupe dans les écoles. je savais que les langues, qu’on yapprend, sont nécessaires pour l’intelligence des livres anciens;que la gentillesse des fables réveille l’esprit; que les actionsmémorables des histoires le relèvent, et qu’étant lues avecdiscrétion, elles aident à former le jugement; que la lecture detous les bons livres est comme une conversation avec les plushonnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs, etmême une conversation étudiée, en laquelle ils ne nous découvrentque les meilleures de leurs pensées; que l’éloquence a des forceset des beautés incomparables; que la poésie a des délicatesses etdes douceurs très ravissantes; que les mathématiques ont desinventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, tant àcontenter les curieux, qu’à faciliter tous les arts et diminuer letravail des hommes; que les écrits qui traitent des mœurscontiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à lavertu qui sont fort utiles; que la théologie enseigne à gagner leciel; que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement detoutes choses, et se faire admirer des moins savants; que lajurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent deshonneurs et des richesses à ceux qui les cultivent; et enfin, qu’ilest bon de les avoir toutes examinées, même les plussuperstitieuses et les plus fausses, afin de connaître leur justevaleur et se garder d’en être trompé.
Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues, etmême aussi à la lecture des livres anciens, et à leurs histoires,et à leurs fables. Car c’est quasi le même de converser avec ceuxdes autres siècles, que de voyager. Il est bon de savoir quelquechose des mœurs de divers peuples, afin de juger des nôtres plussainement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contrenos modes soit ridicule, et contre raison, ainsi qu’ont coutume defaire ceux qui n’ont rien vu. Mais lorsqu’on. emploie trop de tempsà voyager, on devient enfin étranger en son pays; et lorsqu’on esttrop curieux des choses qui se pratiquaient aux siècles passés, ondemeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent encelui-ci. Outre que les fables font imaginer plusieurs événementscomme possibles qui ne le sont point; et que même les histoires lesplus fidèles, si elles ne changent ni n’augmentent la valeur deschoses, pour les rendre plus dignes d’être lues, au moins enomettent-elles presque toujours les plus basses et moins illustrescirconstances : d’où vient que le reste ne paraît pas tel qu’ilest, et que ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu’ils entirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins denos romans, et à concevoir des desseins qui passent leursforces.
J’estimais fort l’éloquence, et j’étais amoureux de la poésie;mais je pensais que l’une et l’autre étaient des dons de l’esprit,plutôt que des fruits de l’étude. Ceux qui ont le raisonnement leplus fort, et qui digèrent le mieux leurs pensées, afin de lesrendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieuxpersuader ce qu’ils proposent, encore qu’ils ne parlassent que basbreton, et qu’ils n’eussent jamais appris de rhétorique. Et ceuxqui ont les inventions les plus agréables, et qui les saventexprimer avec le plus d’ornement et de douceur, ne laisseraient pasd’être les meilleurs poètes, encore que l’art poétique leur fûtinconnu.
Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de lacertitude et de l’évidence de leurs raisons; mais je ne remarquaispoint encore leur vrai usage, et, pensant qu’elles ne servaientqu’aux arts mécaniques, je m’étonnais de ce que, leurs fondementsétant si fermes et si solides, on n’avait rien bâti dessus de plusrelevé. Comme, au contraire, je comparais les écrits des ancienspaïens, qui traitent des mœurs, à des palais fort superbes et fortmagnifiques, qui n’étaient bâtis que sur du sable et sur de laboue. Ils élèvent fort haut les vertus, et les font paraîtreestimables par-dessus toutes les choses qui sont au monde; mais ilsn’enseignent pas assez à les connaître, et souvent ce qu’ilsappellent d’un si beau nom n’est qu’une insensibilité, ou unorgueil, ou un désespoir, ou un parricide.
Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’aucunautre, à gagner le ciel; mais ayant appris, comme chose trèsassurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorantsqu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent,sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettreà la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pourentreprendre de les examiner et y réussir, il était besoin d’avoirquelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plusqu’homme.
Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que, voyant qu’elle aété cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuisplusieurs siècles, et que néanmoins il ne s’y trouve encore aucunechose dont on ne dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse,je n’avais point assez de présomption pour espérer d’y rencontrermieux que les autres; et que, considérant combien il peut y avoirde diverses opinions, touchant une même matière, qui soientsoutenues par des gens doctes, sans qu’il y en puisse avoir jamaisplus d’une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux toutce qui n’était que vraisemblable.
Puis, pour les autres sciences, d’autant qu’elles empruntentleurs principes de la philosophie, je jugeais qu’on ne pouvaitavoir rien bâti, qui fût solide, sur des fondements si peu fermes.Et ni l’honneur, ni le gain qu’elles promettent, n’étaientsuffisants pour me convier à les apprendre; car je ne me sentaispoint, grâces à Dieu, de condition qui m’obligeât à faire un métierde la science, pour le soulagement de ma fortune; et quoique je nefisse pas profession de mépriser la gloire en cynique, je faisaisnéanmoins fort peu d’état de celle que je n’espérais point pouvoiracquérir qu’à faux titres. Et enfin, pour les mauvaises doctrines,je pensais déjà connaître assez ce qu’elles valaient, pour n’êtreplus sujet à être trompé, ni par les promesses d’un alchimiste, nipar les prédictions d’un astrologue, ni par les impostures d’unmagicien, ni par les artifices ou la vanterie d’aucun de ceux quifont profession de savoir plus qu’ils ne savent.
C’est pourquoi, sitôt que l’âge me permit de sortir de lasujétion de mes précepteurs, je quittai entièrement l’étude deslettres. Et me résolvant de ne chercher plus d’autre science, quecelle qui se pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grandlivre du monde, j’employai le reste de ma jeunesse à voyager, àvoir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverseshumeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, àm’éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune meproposait, et partout à faire telle réflexion sur les choses qui seprésentaient, que j’en pusse tirer quelque profit. car il mesemblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité, dansles raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui luiimportent, et dont l’événement le doit punir bientôt après, s’il amal jugé, que dans ceux que fait un homme de lettres dans soncabinet, touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet,et qui ne lui sont d’autre conséquence, sinon que peut-être il entirera d’autant plus de vanité qu’elles seront plus éloignées dusens commun, à cause qu’il aura dû employer d’autant plus d’espritet d’artifice à tâcher de les rendre vraisemblables. Et j’avaistoujours un extrême désir d’apprendre à distinguer le vrai d’avecle faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assuranceen cette vie.
Il est vrai que, pendant que je ne faisais que considérer lesmœurs des autres hommes, je n’y trouvais guère de quoi m’assurer,et que j’y remarquais quasi autant de diversité que j’avais faitauparavant entre les opinions des philosophes. En sorte que le plusgrand profit que j’en retirais était que, voyant plusieurs chosesqui, bien qu’elles nous semblent fort extravagantes et ridicules,ne laissent pas d’être communément reçues et approuvées pard’autres grands peuples, j’apprenais à ne rien croire tropfermement de ce qui ne m’avait été persuadé que par l’exemple etpar la coutume, et ainsi je me délivrais peu à peu de beaucoupd’erreurs, qui peuvent offusquer notre lumière naturelle, et nousrendre moins capables d’entendre raison. Mais après que j’eusemployé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et àtâcher d’acquérir quelque expérience, je pris un jour résolutiond’étudier aussi en moi-même, et d’employer toutes les forces de monesprit à choisir les chemins que je devais suivre. Ce qui meréussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fusse jamaiséloigné, ni de mon pays, ni de mes livres.
Partie 2
J’étais alors en Allemagne, où l’occasion des guerres qui n’ysont pas encore finies m’avait appelé; et comme je retournais ducouronnement de l’empereur vers l’armée, le commencement de l’hiverm’arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui medivertît, et n’ayant d’ailleurs, par bonheur, aucuns soins nipassions qui me troublassent, je demeurais tout le jour enferméseul dans un poêle, où j’avais tout loisir de m’entretenir de mespensées. Entre lesquelles, l’une des premières fut que je m’avisaide considérer que souvent il n’y a pas tant de perfection dans lesouvrages composés de plusieurs pièces, et faits de la main dedivers maîtres, qu’en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsivoit-on que les bâtiments qu’un seul architecte a entrepris etachevés ont coutume d’être plus beaux et mieux ordonnés que ceuxque plusieurs ont tâché de raccommoder, en faisant servir devieilles murailles qui avaient été bâties à d’autres fins. Ainsices anciennes cités, qui, n’ayant été au commencement que desbourgades, sont devenues, par succession de temps, de grandesvilles, sont ordinairement si mal compassées, au prix de ces placesrégulières qu’un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine,qu’encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on ytrouve souvent autant ou plus d’art qu’en ceux des autres;toutefois, à voir comme ils sont arrangés, ici un grand, là unpetit, et comme ils rendent les rues courbées et inégales, ondirait que c’est plutôt la fortune, que la volonté de quelqueshommes usant de raison, qui les a ainsi disposés. Et si onconsidère qu’il y a eu néanmoins de tout temps quelques officiers,qui ont eu charge de prendre garde aux bâtiments des particuliers,pour les faire servir à l’ornement du public, on connaîtra bienqu’il est malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d’autrui,de faire des choses fort accomplies. Ainsi je m’imaginai que lespeuples qui, ayant été autrefois demi-sauvages, et ne s’étantcivilisés que peu à peu, n’ont fait leurs lois qu’à mesure quel’incommodité des crimes et des querelles les y a contraints, nesauraient être si bien policés que ceux qui, dès le commencementqu’ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelqueprudent législateur. Comme il est bien certain que l’état de lavraie religion, dont Dieu seul a fait les ordonnances, doit êtreincomparablement mieux réglé que tous les autres. Et pour parlerdes choses humaines, je crois que, si Sparte a été autrefois trèsflorissante, ce n’a pas été à cause de la bonté de chacune de seslois en particulier, vu que plusieurs étaient fort étranges, etmême contraires aux bonnes mœurs, mais à cause que, n’ayant étéinventées que par un seul, elles tendaient toutes à même fin. Etainsi je pensai que les sciences des livres, au moins celles dontles raisons ne sont que probables, et qui n’ont aucunesdémonstrations, s’étant composées et grossies peu à peu desopinions de plusieurs diverses Personnes, ne sont point siapprochantes de la vérité que les simples raisonnements que peutfaire naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui seprésentent. Et ainsi encore je pensai que, pour ce que nous avonstous été enfants avant que d’être hommes, et qu’il nous a fallulongtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, quiétaient souvent contraires les uns aux autres, et qui, ni les unsni les autres, ne nous conseillaient peut-être pas toujours lemeilleur, il est presque impossible que nos jugements soient sipurs, ni si solides qu’ils auraient été, si nous avions eu l’usageentier de notre raison dès le point de notre naissance, et que nousn’eussions jamais été conduits que par elle.
Il est vrai que nous ne voyons point qu’on jette par terretoutes les maisons d’une ville, pour le seul dessein de les refaired’autre façon, et d’en rendre les rues plus belles; mais on voitbien que plusieurs font abattre les leurs pour les rebâtir, et quemême quelquefois ils y sont contraints, quand elles sont en dangerde tomber d’elles-mêmes, et que les fondements n’en sont pas bienfermes. A l’exemple de quoi je me persuadai, qu’il n’y auraitvéritablement point d’apparence qu’un particulier fît dessein deréformer un État, en y changeant tout dès les fondements, et en lerenversant pour le redresser; ni même aussi, de réformer le corpsdes sciences, ou l’ordre établi dans les écoles pour les enseigner;mais que, pour toutes les opinions que j’avais reçues jusques alorsen ma créance, je ne pouvais mieux faire que d’entreprendre, unebonne fois, de les en ôter, afin d’y en remettre par après, oud’autres meilleures, ou bien les mêmes, lorsque je les auraisajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que, par cemoyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je nebâtissais que sur de vieux fondements » et que je ne m’appuyasseque sur les principes que je m’étais laissé persuader en majeunesse, sans avoir jamais examiné s’ils étaient vrais. Car, bienque je remarquasse en ceci diverses difficultés, elles n’étaientpoint toutefois sans remède, ni comparables à celles qui setrouvent en la réformation des moindres choses qui touchent lepublic. Ces grands corps sont trop malaisés à relever, étantabattus, ou même à retenir, étant ébranlés, et leurs chutes nepeuvent être que très rudes. Puis, pour leurs imperfections, s’ilsen ont, comme la seule diversité qui est entre eux suffit pourassurer que plusieurs en ont, l’usage les a sans doute fortadoucies; et même il en a évité ou corrigé insensiblement quantité,auxquelles en ne pourrait si bien pourvoir par prudence. Et enfin,elles sont quasi toujours plus supportables que ne serait leurchangement : en même façon que les grands chemins, qui tournoiententre des montagnes, deviennent peu à peu si unis et si commodes, àforce d’être fréquentés, qu’il est beaucoup meilleur de les suivreque d’entreprendre d’aller plus droit, en grimpant au-dessus desrochers, et descendant jusques au bas des précipices.
C’est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeursbrouillonnes et inquiètes, qui, n’étant appelées, ni par leurnaissance, ni par leur fortune, au maniement des affairespubliques, ne laissent pas d’y faire toujours, en idée, quelquenouvelle réformation. Et si je pensais qu’il y eût la moindre choseen cet écrit, par laquelle on me pût soupçonner de cette folie, jeserais très marri de souffrir qu’il fût publié. Jamais mon desseinne s’est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes proprespensées, et de bâtir dans un fonds qui est tout à moi. Que si, monouvrage m’ayant assez plu, je vous en fais voir ici le modèle, cen’est pas, pour cela, que je veuille conseiller à personne del’imiter. Ceux que Dieu a mieux partagés de ses grâces aurontpeut-être des desseins plus relevés; mais je crains bien quecelui-ci ne soit déjà que trop hardi pour plusieurs. -a seulerésolution de se défaire de toutes les opinions qu’on a reçuesauparavant en sa créance n’est pas un exemple que chacun doivesuivre; et le monde n’est quasi composé que de deux sortesd’esprits auxquels il ne convient aucunement. A savoir, de ceuxqui, se croyant plus habiles qu’ils ne sont, ne se peuvent empêcherde précipiter leurs jugements, ni avoir assez de patience pourconduire par ordre toutes leurs pensées : d’où vient que, s’ilsavaient une fois pris la liberté de douter des principes qu’ils ontreçus, et de s’écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraienttenir le sentier qu’il faut prendre pour aller plus droit, etdemeureraient égarés toute leur vie. Puis, de ceux qui, ayant assezde raison, ou de modestie, pour juger qu’ils sont moins capables dedistinguer le vrai d’avec le faux, que quelques autres par lesquelsils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter desuivre les opinions de ces autres, qu’en chercher eux-mêmes demeilleures.
Et pour moi, j’aurais été sans doute du nombre de ces derniers,si je n’avais jamais eu qu’un seul maître, ou que je n’eusse pointsu les différences qui ont été de tout temps entre les opinions desplus doctes. Mais ayant appris, dès le collège, qu’on ne sauraitrien imaginer de si, étrange et si peu croyable, qu’il n’ait étédit
par quelqu’un des philosophes; et depuis, en voyageant, ayantreconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires auxnôtres, ne sont pas, pour cela, barbares ni sauvages, mais queplusieurs usent, autant ou plus que nous, de raison; et ayantconsidéré combien un même homme, avec son même esprit, étant nourridès son enfance entre des Français ou des Allemands, devientdifférent de ce qu’il serait, s’il avait toujours vécu entre desChinois ou des Cannibales ; et comment, jusques aux modes denos habits, la même chose qui nous a plu il « y » a dix ans, et quinous plaira peut-être encore avant dix ans, nous semble maintenantextravagante et ridicule : en sorte que c’est bien plus lacoutume et l’exemple qui nous persuadent, qu’aucune connaissancecertaine, et que néanmoins la pluralité des voix n’est pas unepreuve qui vaille rien pour les vérités un peu malaisées àdécouvrir, à cause qu’il est bien plus vraisemblable qu’un hommeseul les ait rencontrées que tout un peuple : je ne pouvais choisirpersonne dont les opinions me semblassent devoir être préférées àcelles des autres, et je me trouvai comme contraint d’entreprendremoi-même de me conduire.
Mais, comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je merésolus d’aller si lentement, et d’user de tant de circonspectionen toutes choses, que, si je n’avançais que fort peu, je megarderais bien, au moins, de tomber. Même je ne voulus pointcommencer à rejeter tout à fait aucune des opinions qui s’étaientpu glisser autrefois en ma créance sans y avoir été introduites parla raison, que je n’eusse auparavant employé assez de temps à fairele projet de l’ouvrage que j’entreprenais, et à chercher la vraieméthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dontmon esprit serait capable.
J’avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les parties de laphilosophie, à la logique, et entre les mathématiques, à l’analysedes géomètres et à l’algèbre, trois arts ou sciences qui semblaientdevoir contribuer quelque chose à mon dessein. Mais, en lesexaminant, je pris garde que, pour la logique, ses syllogismes etla plupart de ses autres instructions servent plutôt à expliquer àautrui les choses qu’on sait ou même, comme l’art de Lulle, àparler, sans jugement, de celles qu’on ignore, qu’à les apprendre.Et bien qu’elle contienne, en effet, beaucoup de préceptes trèsvrais et très bons, il y en a toutefois tant d’autres, mêlés parmi,qui sont ou nuisibles ou superflus, qu’il est presque aussi malaiséde les en séparer, que de tirer une Diane ou une Minerve hors d’unbloc de marbre qui n’est point encore ébauché. Puis, pour l’analysedes anciens et l’algèbre des modernes, outre qu’elles ne s’étendentqu’à des matières fort abstraites, et qui ne semblent d’aucunusage, la première est toujours si astreinte à la considération desfigures, qu’elle ne peut exercer l’entendement sans fatiguerbeaucoup l’imagination; et on s’est tellement assujetti, en ladernière, à certaines règles et à certains chiffres, qu’onen a fait un art confus et obscur, qui embarrasse l’esprit, au lieud’une science qui le cultive. Ce qui fut cause que je pensai qu’ilfallait chercher quelque autre méthode, qui, comprenant lesavantages de ces trois, fût exempte de leurs défauts. Et comme lamultitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sortequ’un État est bien mieux réglé lorsque, n’en ayant que fort peu,elles y sont fort étroitement observées; ainsi, au lieu de ce grandnombre de préceptes dont la logique est composée, je crus quej’aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une fermeet constante résolution de ne manquer pas une seule fois à lesobserver.
Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie,que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire,d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention; et de necomprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui seprésenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que jen’eusse aucune occasion de le mettre en doute.
Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais,en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requispour les mieux résoudre.
Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençantpar les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pourmonter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance desplus composés; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne seprécèdent point naturellement les uns les autres.
Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, etdes revues si générales, que je fusse assuré de ne rienomettre.
Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dontles géomètres ont coutume de se servir, pour parvenir à leurs plusdifficiles démonstrations, m’avaient donné occasion de m’imaginerque toutes les choses, qui peuvent tomber sous la connaissance deshommes, s’entre-suivent en même façon et que, pourvu seulementqu’on s’abstienne d’en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit,et qu’on garde toujours l’ordre qu’il faut pour les déduire lesunes des autres, il n’y en peut avoir de si éloignées auxquellesenfin on ne parvienne, ni de si cachées qu’on ne découvre. Et je nefus pas beaucoup en peine de chercher par lesquelles il étaitbesoin de commencer : car je savais déjà que c’était par lesplus simples et les plus aisées à connaître; et considérantqu’entre tous ceux qui ont ci-devant recherché la vérité dans lessciences, il n’y a eu que les seuls mathématiciens qui ont putrouver quelques démonstrations, c’est-à-dire quelques raisonscertaines et évidentes, je ne doutais point que ce ne fût par lesmêmes qu’ils ont examinées; bien que je n’en espérasse aucune autreutilité, sinon qu’elles accoutumeraient mon esprit à se repaître devérités, et ne se contenter point de fausses raisons. Mais je n’euspas dessein, pour cela, de tâcher d’apprendre toutes ces sciencesparticulières, qu’on nomme communément mathématiques, et voyantqu’encore que leurs objets soient différents, elles ne laissent pasde s’accorder toutes, en ce qu’elles n’y considèrent autre choseque les divers rapports ou proportions qui s’y trouvent, je pensaiqu’il valait mieux que j’examinasse seulement ces proportions engénéral, et sans les supposer que dans les sujets qui serviraient àm’en rendre la connaissance plus aisée; même aussi sans les yastreindre aucunement, afin de les pouvoir d’autant mieux appliqueraprès à tous les autres auxquels elles conviendraient. Puis, ayantpris garde que, pour les connaître, j’aurais quelquefois besoin deles considérer chacune en particulier, et quelquefois seulement deles retenir, ou de les comprendre plusieurs ensemble, je pensaique, pour les considérer mieux en particulier, je les devaissupposer en des lignes, à cause que je ne trouvais rien de plussimple, ni que je pusse plus distinctement représenter à monimagination et à mes sens; mais que, pour les retenir, ou lescomprendre plusieurs ensemble, il fallait que je les expliquassepar quelques chiffres, les plus courts qu’il serait possible, etque, par ce moyen, j’emprunterais tout le meilleur de l’analysegéométrique et de l’algèbre, et corrigerais tous les défauts del’une par l’autre.
Comme, en effet, j’ose dire que l’exacte observation de ce peude préceptes que j’avais choisis, me donna telle facilité à démêlertoutes les questions auxquelles ces deux sciences s’étendent, qu’endeux ou trois mois que j’employai à les examiner, ayant commencépar les plus simples et plus générales, et chaque vérité que jetrouvais étant une règle qui me servait après à en trouverd’autres, non seulement je vins à bout de plusieurs que j’avaisjugées autrefois très difficiles, mais il me sembla aussi, vers lafin, que je pouvais déterminer, en celles même que j’ignorais, parquels moyens, et jusques où, il était possible de les résoudre. Enquoi je ne vous paraîtrai peut-être pas être fort vain, si vousconsidérez que, n’y ayant qu’une vérité de chaque chose, quiconquela trouve en sait autant qu’on en peut savoir; et que, par exemple,un enfant instruit en l’arithmétique, ayant fait une additionsuivant ses règles, se peut assurer d’avoir trouvé, touchant lasomme qu’il examinait, tout ce que l’esprit humain saurait trouver.Car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, et àdénombrer exactement toutes les circonstances de ce qu’on cherche,contient tout ce qui donne de la certitude aux règlesd’arithmétique.
Mais ce qui me contentait le plus de cette méthode était que,par elle, j’étais assuré d’user en tout de ma raison, sinonparfaitement, au moins le mieux, qui fût en mon pouvoir; outre queje sentais, en la pratiquant, que mon esprit s’accoutumait peu àpeu à concevoir plus nettement et plus distinctement ses objets, etque, ne l’ayant point assujettie à aucune matière particulière, jeme promettais de l’appliquer aussi utilement aux difficultés desautres sciences, que j’avais fait à celles de l’algèbre. Non que,pour cela, j’osasse entreprendre d’abord d’examiner toutes cellesqui se présenteraient; car cela même eût été contraire à l’ordrequ’elle prescrit. Mais, ayant pris garde que leurs principesdevaient tous être empruntés de la philosophie, en laquelle je n’entrouvais point encore de certains, je pensai qu’il fallait, avanttout, que je tâchasse d’y en établir; et que, cela étant la chosedu monde la plus importante, et où la précipitation et laprévention étaient le plus à craindre, je ne devais pointentreprendre d’en venir à bout, que je n’eusse atteint un âge bienplus mûr que celui de vingt-trois ans, que j’avais alors; et que jen’eusse, auparavant, employé beaucoup de temps à m’y préparer, tanten déracinant de mon esprit toutes les mauvaises opinions que j’yavais reçues avant ce temps-là, qu’en faisant amas de plusieursexpériences, pour être après la matière de mes raisonnements, et enm’exerçant toujours en la méthode que je m’étais prescrite, afin dem’y affermir de plus en plus.
Partie 3
Et enfin, comme ce n’est pas assez, avant de commencer à rebâtirle logis où on demeure, que de l’abattre, et de faire provision dematériaux et d’architectes, ou s’exercer soi-même à l’architecture,et outre cela d’en avoir soigneusement tracé le dessin; mais qu’ilfaut aussi s’être pourvu de quelque autre, où on puisse être logécommodément pendant le temps qu’on y travaillera; ainsi, afin queje ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que laraison m’obligerait de l’être en mes jugements, et que je nelaissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que jepourrais, je me formai une morale par provision, qui ne consistaitqu’en trois ou quatre maximes, dont je veux bien vous fairepart.
La première était d’obéir aux lois et aux coutumes de mon pays,retenant constamment la religion en laquelle Dieu m’a fait la grâced’être instruit dès mon enfance, et me gouvernant, en toute autrechose, suivant les opinions les plus modérées, et les pluséloignées de l’excès, qui fussent communément reçues en pratiquepar les mieux sensés de ceux avec lesquels j’aurais à vivre. Car,commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, àcause que je les voulais remettre toutes à l’examen, j’étais assuréde ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés. Etencore qu’il y en ait peut-être d’aussi bien sensés, parmi lesPerses ou les Chinois, que parmi nous, il me semblait que le plusutile était de me régler selon ceux avec lesquels j’aurais à vivre;et que, pour savoir quelles étaient véritablement leurs opinions,je devais plutôt prendre garde à ce qu’ils pratiquaient qu’à cequ’ils disaient; non seulement à cause qu’en la corruption de nosmœurs il y a peu de gens qui veuillent dire tout ce qu’ils croient,mais aussi à cause que plusieurs l’ignorent eux-mêmes, car l’actionde la pensée par laquelle on croit une chose, étant différente decelle par laquelle on connaît qu’on la croit, elles sont souventl’une sans l’autre. Et entre plusieurs opinions également reçues,je ne choisissais que les plus modérées : tant à cause que ce sonttoujours les plus commodes pour la pratique, et vraisemblablementles meilleures, tous excès ayant coutume d’être mauvais; commeaussi afin de me détourner moins du vrai chemin, en cas que jefaillisse, que si, ayant choisi l’un des extrêmes, c’eût étél’autre qu’il eût fallu suivre. Et, particulièrement, je mettaisentre les excès toutes les promesses par lesquelles on retranchequelque chose de sa liberté. Non que je désapprouvasse les loisqui, pour remédier à l’inconstance des esprits faibles, permettent,lorsqu’on a quelque bon dessein, ou même, pour la sûreté ducommerce, quelque dessein qui n’est qu’indifférent, qu’on fasse desvœux ou des contrats qui obligent à y persévérer; mais à cause queje ne voyais au monde aucune chose qui demeurât toujours en mêmeétat, et que, pour mon particulier, je me promettais deperfectionner de plus en plus mes jugements, et non point de lesrendre pires, j’eusse pensé commettre une grande faute contre lebon sens, si, parce que j’approuvais alors quelque chose, je mefusse obligé de la prendre pour bonne encore après, lorsqu’elleaurait peut-être cessé de l’être, ou que j’aurais cessé del’estimer telle.
Ma seconde maxime était d’être le plus ferme et le plus résoluen mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moinsconstamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m’y seraisune fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitanten ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, nedoivent pas errer en tournoyant, tantôt d’un côté, tantôt d’unautre, ni encore moins s’arrêter en une place, mais marchertoujours le plus droit qu’ils peuvent vers un même côté, et ne lechanger point pour de faibles raisons, encore que ce n’aitpeut-être été au commencement que le hasard seul qui les aitdéterminés à le choisir : car, par ce moyen, s’ils ne vontjustement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelquepart, où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieud’une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souventaucun délai, c’est une vérité très certaine que, lorsqu’il n’estpas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nousdevons suivre les plus probables; et même, qu’encore que nous neremarquions point davantage de probabilité aux unes qu’aux autres,nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, et lesconsidérer après, non plus comme douteuses, en tant qu’elles serapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines,à cause que la raison qui nous y a fait déterminer se trouve telle.Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirset les remords, qui ont coutume d’agiter les consciences de cesesprits faibles et chancelants, qui se laissent allerinconstamment : à pratiquer, comme bonnes, les choses qu’ilsjugent après être mauvaises.
Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincreque la fortune, et à changer mes désirs que l’ordre du monde; etgénéralement, de m’accoutumer à croire qu’il n’y a rien qui soitentièrement en notre pouvoir, que nos pensées, en sorte qu’aprèsque nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sontextérieures, tout ce qui manque de nous réussir est, au regard denous, absolument impossible. Et ceci seul me semblait êtresuffisant pour m’empêcher de rien désirer à l’avenir que jen’acquisse, et ainsi pour me rendre content. Car notre volonté nese portant naturellement à désirer que les choses que notreentendement lui représente en quelque façon comme possibles, il estcertain que, si nous considérons tous les biens qui sont hors denous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n’aurons pasplus de regrets de manquer de ceux qui semblent être dus à notrenaissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nousavons de ne posséder pas les royaumes de la Chine ou du Mexique; etque faisant, comme on dit, de nécessité vertu, nous ne désireronspas davantage d’être sains, étant malades, ou d’être libres, étanten prison, que nous faisons maintenant d’avoir des corps d’unematière aussi peu corruptible que les diamants, ou des ailes pourvoler comme les oiseaux. Mais j’avoue qu’il est besoin d’un longexercice, et d’une méditation souvent réitérée, pour s’accoutumer àregarder de ce biais toutes les choses; et je crois que c’estprincipalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes,qui ont pu autrefois se soustraire de l’empire de la fortune et,malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avecleurs dieux. Car, s’occupant sans cesse à considérer les bornes quileur étaient prescrites par la nature, ils se persuadaient siparfaitement que rien n’était en leur pouvoir que leurs pensées,que cela seul était suffisant pour les empêcher d’avoir aucuneaffection pour d’autres choses; et ils disposaient d’elles siabsolument, qu’ils avaient en cela quelque raison de s’estimer plusriches, et plus puissants, et plus libres, et plus heureux,qu’aucun des autres hommes qui, n’ayant point cette philosophie,tant favorisés de la nature et de la fortune qu’ils puissent être,ne disposent jamais ainsi de tout ce qu’ils veulent.
Enfin, pour conclusion de cette morale, je m’avisai de faire unerevue sur les diverses occupations qu’ont les hommes en cette vie,pour tâcher à faire choix de la meilleure; et sans que je veuillerien dire de celles des autres, je pensai que je ne pouvais mieuxque de continuer en celle-là même où je me trouvais, c’est-à-dire,que d’employer toute ma vie à cultiver ma raison, et m’avancer,autant que je pourrais, en la connaissance de la vérité, suivant laméthode que je m’étais prescrite. J’avais éprouvé de si extrêmescontentements, depuis que j’avais commencé à me servir de cetteméthode, que je ne croyais pas qu’on en pût recevoir de plus doux,ni de plus innocents, en cette vie; et découvrant tous les jourspar son moyen quelques vérités, qui me semblaient assezimportantes, et communément ignorées des autres hommes, lasatisfaction que j’en avais remplissait tellement mon esprit quetout le reste ne me touchait point. Outre que les trois maximesprécédentes n’étaient fondées que sur le dessein que j’avais decontinuer à m’instruire : car Dieu nous ayant donné à chacunquelque lumière pour discerner le vrai d’avec le faux, je n’eussepas cru me devoir contenter des opinions d’autrui un seul moment,si je ne me fusse proposé d’employer mon propre jugement à lesexaminer, lorsqu’il serait temps; et je n’eusse su m’exempter descrupule, en les suivant, si je n’eusse espéré de ne perdre pourcela aucune occasion d’en trouver de meilleures, en cas qu’il y eneût. Et enfin, je n’eusse su borner mes désirs, ni être content, sije n’eusse suivi un chemin par lequel, pensant être assuré del’acquisition de toutes les connaissances dont je serais capable,je le pensais être, par même moyen, de celle de tous les vraisbiens qui seraient jamais en mon pouvoir, d’autant que, notrevolonté ne se portant à suivre ni à fuir aucune chose, que selonque notre entendement « la » lui représente bonne ou mauvaise,il suffit de bien juger pour bien faire, et de juger le mieux qu’onpuisse pour faire aussi tout son mieux, c’est-à-dire pour acquérirtoutes les vertus, et ensemble tous les autres biens qu’on puisseacquérir; et lorsqu’on est certain que cela est, on ne sauraitmanquer d’être content.
Après m’être ainsi assuré de ces maximes, et les avoir mises àpart, avec les vérités de la foi, qui ont toujours été lespremières en ma créance, je jugeai que, pour tout le reste de mesopinions, je pouvais librement entreprendre de m’en défaire. Etd’autant que j’espérais en pouvoir mieux venir à bout, enconversant avec les hommes, qu’en demeurant plus longtemps renfermédans le poêle où j’avais eu toutes ces pensées, l’hiver n’était pasencore bien achevé que je me remis à voyager. Et en toutes les neufannées suivantes, je ne fis autre chose que rouler çà et là dans lemonde, tâchant d’y être spectateur plutôt qu’acteur en toutes lescomédies qui s’y jouent; et faisant particulièrement réflexion, enchaque matière, sur ce qui la pouvait rendre suspecte, et nousdonner occasion de nous méprendre, je déracinais cependant de monesprit toutes les erreurs qui s’y étaient pu glisser auparavant.Non que j’imitasse pour cela les sceptiques, qui ne doutent quepour douter, et affectent d’être toujours irrésolus : car, aucontraire, tout mon dessein ne tendait qu’à m’assurer, et à rejeterla terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou l’argile. Cequi me réussissait, ce me semble, assez bien, d’autant que, tâchantà découvrir la fausseté ou l’incertitude des propositions quej’examinais, non par de faibles conjectures, mais par desraisonnements clairs et assurés, je n’en rencontrais point de sidouteuses, que je n’en tirasse toujours quelque conclusion assezcertaine, quand ce n’eût été que cela même qu’elle ne contenaitrien de certain. Et comme, en abattant un vieux logis, on enréserve ordinairement les démolitions pour servir à en bâtir unnouveau, ainsi, en détruisant toutes celles de mes opinions que jejugeais être mal fondées, je faisais diverses observations etacquérais plusieurs expériences, qui m’ont servi depuis à enétablir de plus certaines. Et, de plus, je continuais à m’exerceren la méthode que je m’étais prescrite; car, outre que j’avais soinde conduire généralement toutes mes pensées selon ses règles, je meréservais de temps en temps quelques heures, que j’employaisparticulièrement à la pratiquer en des difficultés de mathématique,ou même aussi en quelques autres que je pouvais rendre quasisemblables à celles des mathématiques, en les détachant de tous lesprincipes des autres sciences que je ne trouvais pas assez fermes,comme vous verrez que j’ai fait en plusieurs qui sont expliquées ence volume. Et ainsi, sans vivre d’autre façon, en apparence, queceux qui, n’ayant aucun emploi qu’à passer une vie douce etinnocente, s’étudient à séparer les plaisirs des vices, et qui,pour jouir de leur loisir sans s’ennuyer, usent de tous lesdivertissements qui sont honnêtes, je ne laissais pas de poursuivreen mon dessein, et de profiter en la connaissance de la vérité,peut-être plus que si je n’eusse fait que lire des livres, oufréquenter des gens de lettres.
Toutefois, ces neuf ans s’écoulèrent avant que j’eusse encorepris aucun parti, touchant les difficultés qui ont coutume d’êtredisputées entre les doctes, ni commencé à chercher les fondementsd’aucune philosophie plus certaine que la vulgaire. Et l’exemple deplusieurs excellents esprits, qui, en ayant eu ci-devant ledessein, me semblaient n’y avoir pas réussi, m’y faisait imaginertant de difficulté, que je n’eusse peut-être pas encore sitôt osél’entreprendre, si je n’eusse vu que quelques-uns faisaient déjàcourre le bruit que j’en étais venu à bout. je ne saurais pas diresur quoi ils fondaient cette opinion; et si j’y ai contribuéquelque chose par mes discours, ce doit avoir été en confessantplus ingénument ce que j’ignorais, que n’ont coutume de faire ceuxqui ont un peu étudié, et peut-être aussi en faisant voir lesraisons que j’avais de douter de beaucoup de choses que les autresestiment certaines, plutôt qu’en me vantant d’aucune doctrine. Maisayant le cœur assez bon pour ne vouloir point qu’on me prît pourautre que je n’étais, je pensai qu’il fallait que je tâchasse, partous moyens, a me rendre digne de la réputation qu’on me donnait;et il y a justement huit ans, que ce désir me fit résoudre àm’éloigner de tous les lieux où je pouvais avoir des connaissances,et à me retirer ici, en un pays où la longue durée de la guerre afait établir de tels ordres, que les armées qu’on y entretient nesemblent servir qu’à faire qu’on y jouisse des fruits de la paixavec d’autant plus de sûreté, et où parmi la foule d’un grandpeuple fort actif, et plus soigneux de ses propres affaires quecurieux de celles d’autrui, sans manquer d’aucune des commoditésqui sont dans les villes les plus fréquentées, j’ai pu vivre aussisolitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés.
Partie 4
Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditationsque j’y ai faites; car elles sont si métaphysiques et si peucommunes, qu’elles ne seront peut-être pas au goût de tout lemonde. Et toutefois, afin qu’on puisse juger si les fondements quej’ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façoncontraint d’en parler. J’avais dès longtemps remarqué que, pour lesmœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu’on saitfort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables,ainsi qu’il a été dit ci-dessus; mais, parce qu’alors je désiraisvaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu’ilfallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, commeabsolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindredoute afin de voir s’il ne resterait point, après cela, quelquechose en ma créance, qui fût entièrement indubitable. Ainsi, àcause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposerqu’il n’y avait aucune chose qui fût telle qu’ils nous la fontimaginer. Et parce qu’il y a des hommes qui se méprennent enraisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie,et y font des paralogismes, jugeant que j’étais sujet à faillir,autant qu’aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisonsque j’avais prises auparavant pour démonstrations. Et enfin,considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étantéveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous dormons, sans qu’ily en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus defeindre que toutes les choses qui m’étaient jamais entrées enl’esprit n’étaient non plus vraies que les illusions de mes songes.Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulaisainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement quemoi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cettevérité :je pense, donc je suis, était si ferme et siassurée, que toutes les plus extravagantes suppositions dessceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que jepouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de laphilosophie que je cherchais.
Puis, examinant avec attention ce que j’étais, et voyant que jepouvais feindre que je n’avais aucun corps, et qu’il n’y avaitaucun monde, ni aucun lieu où je fusse; mais que je ne pouvais pasfeindre, pour cela, que je n’étais point; et qu’au contraire, decela même que je pensais à douter de la vérité des autres choses,il suivait très évidemment et très certainement que j’étais; aulieu que, si j’eusse seulement cessé de penser, encore que tout lereste de ce que j’avais jamais imaginé eût été vrai, je n’avaisaucune raison de croire que j’eusse été : je connus de là quej’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est quede penser, et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépendd’aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c’est-à-dire l’âmepar laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte ducorps, et même qu’elle est plus aisée à connaître que lui, etqu’encore qu’il ne fût point, elle ne laisserait pas d’être tout cequ’elle est.
Après cela, je considérai en général ce qui est requis à uneproposition pour être vraie et certaine; car, puisque je venaisd’en trouver une que je savais être telle, je pensai que je devaisaussi savoir en quoi consiste cette certitude. Et ayant remarquéqu’il n’y a rien du tout en ceci : je pense, donc je suis,qui m’assure que je dis la vérité, sinon que je vois trèsclairement que, pour penser, il faut être : je jugeai que jepouvais prendre pour règle générale, que les choses que nousconcevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies;mais qu’il y a seulement quelque difficulté à bien remarquerquelles sont celles que nous concevons distinctement.
En suite de quoi, faisant réflexion sur ce que je doutais, etque, par conséquent, mon être n’était pas tout parfait, car jevoyais clairement que c’était une plus grande perfection deconnaître que de douter, je m’avisai de chercher d’où j’avaisappris à penser à quelque chose de plus parfait que je n’étais; etje connus évidemment que ce devait être de quelque nature qui fûten effet plus parfaite. Pour ce qui est des pensées que j’avais deplusieurs autres choses hors de moi, comme du ciel, de la terre, dela lumière, de la chaleur, et de mille autres, je n’étais pointtant en peine de savoir d’où elles venaient, à cause que, neremarquant rien en elles qui me semblât les rendre supérieures àmoi, je pouvais croire que, si elles étaient vraies, c’étaient desdépendances de ma nature, en tant qu’elle avait quelque perfection;et si elles ne l’étaient pas, que je les tenais du néant,c’est-à-dire qu’elles étaient en moi, parce que j’avais du défaut.Mais ce ne pouvait être le même de l’idée d’un être plus parfaitque le mien : car, de la tenir du néant, c’était chosemanifestement impossible; et parce qu’il n’y a pas moins derépugnance que le plus parfait soit une suite et une dépendance dumoins parfait, qu’il y en a que de rien procède quelque chose, jene la pouvais tenir non plus de moi-même. De façon qu’il restaitqu’elle eût été mise en moi par une nature qui fût véritablementplus parfaite que je n’étais, et même qui eût en soi toutes lesperfections dont je pouvais avoir quelque idée, c’est-à-dire, pourm’expliquer en un mot, qui fût Dieu. A quoi j’ajoutai que, puisqueje connaissais quelques perfections que je n’avais point, jen’étais pas le seul être qui existât (j’userai, s’il vous plaît,ici librement des mots de l’École), mais qu’il fallait, denécessité, qu’il y en eût quelque autre plus parfait, duquel jedépendisse, et duquel j’eusse acquis tout ce que j’avais. Car, sij’eusse été seul et indépendant de tout autre, en sorte que j’eusseeu, de moi-même, tout ce peu que je participais de l’être parfait,j’eusse pu avoir de moi, par même raison, tout le surplus que jeconnaissais me manquer, et ainsi être moi-même infini, éternel,immuable, tout connaissant, tout-puissant, et enfin avoir toutesles perfections que je pouvais remarquer être en Dieu. Car, suivantles raisonnements que je viens de faire, pour connaître la naturede Dieu, autant que la mienne en était capable, je n’avais qu’àconsidérer de toutes les choses dont je trouvais en moi quelqueidée, si c’était perfection, ou non, de les posséder, et j’étaisassuré qu’aucune de celles qui marquaient quelque imperfectionn’était en lui, mais que toutes les autres y étaient. Comme jevoyais que le doute, l’inconstance, la tristesse, et chosessemblables, n’y pouvaient être, vu que j’eusse été moi-même bienaise d’en être exempt. Puis, outre cela, j’avais des idées deplusieurs choses sensibles et corporelles : car, quoique jesupposasse que je rêvais, et que tout ce que je voyais ou imaginaisétait faux, je ne pouvais nier toutefois que les idées n’en fussentvéritablement en ma pensée; mais parce que j’avais déjà connu enmoi très clairement que la nature intelligente est distincte de lacorporelle, considérant que toute composition témoigne de ladépendance, et que la dépendance est manifestement un défaut, jejugeais de là, que ce ne pouvait être une perfection en Dieu d’êtrecomposé de ces deux natures, et que, par conséquent, il ne l’étaitpas; mais que, s’il y avait quelques corps dans le monde, ou bienquelques intelligences, ou autres natures, qui ne fussent pointtoutes parfaites, leur être devait dépendre de sa puissance, entelle sorte qu’elles ne pouvaient subsister sans lui un seulmoment.
Je voulus chercher, après cela, d’autres vérités, et m’étantproposé l’objet des géomètres, que je concevais comme un corpscontinu, ou un espace indéfiniment étendu en longueur, largeur ethauteur ou profondeur, divisible en diverses parties, qui pouvaientavoir diverses figures et grandeurs, et être mues ou transposées entoutes sortes, car les géomètres supposent tout cela du leur objet,je parcourus quelques-unes de leurs plus simples démonstrations. Etayant pris garde que cette grande certitude, que tout le monde leurattribue, n’est fondée que sur ce qu’on les conçoit évidemment,suivant la règle que j’ai tantôt dite, je pris garde aussi qu’iln’y avait rien du tout en elles qui m’assurât de l’existence deleur objet. Car, par exemple, je voyais bien que, supposant untriangle, il fallait que ses trois angles fussent égaux à deuxdroits; mais je ne voyais rien pour cela qui m’assurât qu’il y eûtau monde aucun triangle. Au lieu que, revenant à examiner l’idéeque j’avais d’un Être parfait, je trouvais que l’existence y étaitcomprise, en même façon qu’il est compris en celles d’un triangleque ses trois angles sont égaux à deux droits, ou en celle d’unesphère que toutes ses parties sont également distantes de soncentre, ou même encore plus évidemment; et que, par conséquent, ilest pour le moins aussi certain, que Dieu, qui est cet Êtreparfait, est ou existe, qu’aucune démonstration de géométrie lesaurait être.
Mais ce qui fait qu’il y en a plusieurs qui se persuadent qu’ily a de la difficulté à le connaître, et même aussi à connaître ceque c’est que leur âme, c’est qu’ils n’élèvent jamais leur espritau delà des choses sensibles, et qu’ils sont tellement accoutumés àne rien considérer qu’en l’imaginant, qui est une façon de penserparticulière pour les choses matérielles, que tout ce qui n’est pasimaginable leur semble n’être pas intelligible. Ce qui est assezmanifeste de ce que même les philosophes tiennent pour maxime, dansles écoles, qu’il n’y a rien dans l’entendement qui n’aitpremièrement été dans le sens, où toutefois il est certain que lesidées de Dieu et de l’âme n’ont jamais été. Et il me semble queceux qui veulent user de leur imagination, pour les comprendre,font tout de même que si, pour ouïr les sons, ou sentir les odeurs,ils se voulaient servir de leurs yeux : sinon qu’il y a encorecette différence, que le sens de la vue ne nous assure pas moins dela vérité de ses objets, que font ceux de l’odorat ou de l’ouïe; aulieu que ni notre imagination ni nos sens ne nous sauraient jamaisassurer d’aucune chose, si notre entendement n’y intervient.
Enfin, s’il y a encore des hommes qui ne soient pas assezpersuadés de l’existence de Dieu et de leur âme, par les raisonsque j’ai apportées, je veux bien -qu’ils sachent que toutes lesautres choses, dont ils se pensent peut-être plus assurés, commed’avoir un corps, et qu’il y a des astres et une terre, et chosessemblables, sont moins certaines. Car encore qu’on ait uneassurance morale de ces choses, qui est telle, qu’il semble qu’àmoins que d’être extravagant, on n’en peut douter, toutefois aussi,à moins que d’être déraisonnable, lorsqu’il est question d’unecertitude métaphysique, on ne peut nier que ce ne soit assez desujet, pour n’en être pas entièrement assuré, que d’avoir prisgarde qu’on peut, en même façon, s’imaginer, étant endormi, qu’on aun autre corps, et qu’on voit d’autres astres, et une autre terre,sans qu’il en soit rien. Car d’où sait-on que les pensées quiviennent en songe sont plutôt fausses que les autres, vu quesouvent elles ne sont pas moins vives et expresses ? Et queles meilleurs esprits y étudient tant qu’il leur plaira, je necrois pas qu’ils puissent donner aucune raison qui soit suffisantepour ôter ce doute, s’ils ne présupposent l’existence de Dieu. Car,premièrement, cela même que j’ai tantôt pris pour une règle, àsavoir que les choses que nous concevons très clairement et trèsdistinctement sont toutes vraies, n’est assuré qu’à cause que Dieuest ou existe, et qu’il est un être parfait, et que tout ce qui esten nous vient de lui. D’où il suit que nos idées ou notions, étantdes choses réelles, et qui viennent de Dieu, en tout ce en quoielles sont claires et distinctes, ne peuvent en cela être quevraies. En sorte que, si nous en avons assez souvent quicontiennent de la fausseté, ce ne peut être que de celles qui ontquelque chose de confus et obscur, à cause qu’en cela ellesparticipent du néant, c’est-à-dire, qu’elles ne sont en nous ainsiconfuses, qu’à cause que nous ne sommes pas tout parfaits. Et ilest évident qu’il n’y a pas moins de répugnance que la fausseté oul’imperfection procède de Dieu, en tant que telle, qu’il y en a quela vérité ou la perfection procède du néant. Mais si nous nesavions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vientd’un être parfait et infini, pour claires et distinctes que fussentnos idées, nous n’aurions aucune raison qui nous assurât qu’elleseussent la perfection d’être vraies.
Or, après que la connaissance de Dieu et de l’âme nous a ainsirendus certains de cette règle, il est bien aisé à connaître queles rêveries que nous imaginons étant endormis ne doiventaucunement nous faire douter de la vérité des pensées que nousavons étant éveillés. Car, s’il arrivait, même en dormant, qu’oneût quelque idée fort distincte, comme, par exemple, qu’un géomètreinventât quelque nouvelle démonstration, son sommeil nel’empêcherait pas d’être vraie. Et pour l’erreur la plus ordinairede nos songes, qui consiste en ce qu’ils nous représentent diversobjets en même façon que font nos sens extérieurs, n’importe pasqu’elle nous donne occasion de nous défier de la vérité de tellesidées, à cause qu’elles peuvent aussi nous tromper assez souvent,sans que nous dormions : comme lorsque ceux qui ont la jaunissevoient tout de couleur jaune, ou que les astres ou autres corpsfort éloignes nous paraissent beaucoup plus petits qu’ils ne sont.Car enfin, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous nenous devons jamais laisser persuader qu’à. l’évidence de notreraison. Et il est à remarquer que je dis, de notre raison, et nonpoint, de notre imagination ni de nos sens. Comme, encore que nousvoyons le soleil très clairement, nous ne devons pas juger pourcela qu’il ne soit que de la grandeur que nous le voyons; et nouspouvons bien imaginer distinctement une tête de lion entée sur lecorps d’une chèvre, sans qu’il faille conclure, pour cela, qu’il yait au monde une chimère : car la raison ne nous dicte point que ceque nous voyons ou imaginons ainsi soit véritable. Mais elle nousdicte bien que toutes nos idées ou notions doivent avoir quelquefondement de vérité; car il ne serait pas possible que Dieu, quiest tout parfait et tout véritable, les eût mises en nous sanscela. Et parce que nos raisonnements ne sont jamais si évidents nisi entiers pendant le sommeil que pendant la veille, bien quequelquefois nos imaginations soient alors autant ou plus vives etexpresses, elle nous dicte aussi que nos pensées ne pouvant êtretoutes vraies, à cause que nous ne sommes pas tout parfaits, cequ’elles ont de vérité doit infailliblement se rencontrer en cellesque nous avons étant éveillés, plutôt qu’en nos songes.
Partie 5
Je serais bien aise de poursuivre, et de faire voir ici toute lachaîne des autres vérités que j’ai déduites de ces premières. Mais,à cause que, pour cet effet, il serait maintenant besoin que jeparlasse de plusieurs questions, qui sont en controverse entre lesdoctes, avec lesquels je ne désire point me brouiller, je croisqu’il sera mieux que je m’en abstienne, et que je dise seulement engénéral quelles elles sont, afin de laisser juger aux plus sagess’il serait utile que le public en fût plus particulièrementinformé. Je suis toujours demeuré ferme en la résolution quej’avais prise, de ne supposer aucun autre principe que celui dontje viens de me servir pour démontrer l’existence de Dieu et del’âme, et de ne recevoir aucune chose pour vraie, qui ne me semblâtplus claire et plus certaine que n’avaient fait auparavant lesdémonstrations des géomètres. Et néanmoins j’ose dire que, nonseulement j’ai trouvé moyen de me satisfaire en peu de temps,touchant toutes les principales difficultés dont on a coutume detraiter en la Philosophie, mais aussi que j’ai remarqué certaineslois, que Dieu a tellement établies en la nature, et dont il aimprimé de telles notions en nos âmes, qu’après y avoir fait assezde réflexion, nous ne saurions douter qu’elles ne soient exactementobservées, en tout ce qui est ou qui se fait dans le monde. Puis,en considérant la suite de ces lois, il me semble avoir découvertplusieurs vérités plus utiles et plus importantes que tout ce quej’avais appris auparavant, ou même espéré d’apprendre.
Mais parce que j’ai tâché d’en expliquer les principales dans untraité, que quelques considérations m’empêchent de publier, je neles saurais mieux faire connaître, qu’en disant ici sommairement cequ’il contient. J’ai eu dessein d’y comprendre tout ce que jepensais savoir, avant que de l’écrire, touchant la nature deschoses matérielles. Mais, tout de même que les peintres, ne pouvantégalement bien représenter dans un tableau plat toutes les diversesfaces d’un corps solide, en choisissent une des principales qu’ilsmettent seule vers le jour, et ombrageant les autres, ne les fontparaître qu’en tant qu’on les peut voir en la regardant : ainsi,craignant de ne pouvoir mettre en mon discours tout ce que j’avaisen la pensée, j’entrepris seulement d’y exposer bien amplement ceque je concevais de la lumière; puis, à son occasion, d’y ajouterquelque chose du soleil et des étoiles fixes, à cause qu’elle enprocède presque toute; des cieux, à cause qu’ils la transmettent;des planètes, des comètes et de la terre, à cause qu’elles la fontréfléchir; et en particulier de tous les corps qui sont sur laterre, à cause qu’ils sont ou colorés, ou transparents, oulumineux; et enfin de l’Homme, à cause qu’il en est le spectateur.Même, pour ombrager un peu toutes ces choses, et pouvoir dire pluslibrement ce que j’en jugeais, sans être obligé de suivre ni deréfuter les opinions qui sont reçues entre les doctes, je merésolus de laisser tout ce Monde ici à leurs disputes, et de parierseulement de ce qui arriverait dans un nouveau, si Dieu créaitmaintenant quelque part, dans les espaces imaginaires, assez dematière pour le composer, et qu’il agitât diversement et sans ordreles diverses parties de cette matière, en sorte qu’il en composâtun chaos aussi confus que les poètes en puissent feindre, et que,par après, il ne fît autre chose que prêter son concours ordinaireà la nature, et la laisser agir suivant les lois qu’il a établies.Ainsi, premièrement, je décrivis cette matière et tâchai de lareprésenter telle qu’il n’y a rien au monde ce Me semble, de plusclair ni plus intelligible, excepté ce qui a tantôt été dit de Dieuet de l’âme : car même je supposai, expressément, qu’il n’yavait en elle aucune de ces formes ou qualités dont on dispute dansles écoles, ni généralement aucune chose, dont la connaissance nefût si naturelle à nos âmes, qu’on ne pût pas même feindre del’ignorer. De plus, je fis voir quelles étaient les lois de lanature; et, sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe quesur les perfections infinies de Dieu, je tâchai à démontrer toutescelles dont on eût pu avoir quelque doute, et à faire voir qu’ellessont telles, qu’encore que Dieu aurait créé plusieurs mondes, iln’y en saurait avoir aucun où elles manquassent d’être observées.Après cela, je montrai comment la plus grande part de la matière dece chaos devait, en suite de ces lois, se disposer et s’arrangerd’une certaine façon qui la rendait semblable à nos cieux; comment,cependant, quelques-unes de ses parties devaient composer uneterre, et quelques-unes des planètes et des comètes, et quelquesautres un soleil et des étoiles fixes. Et ici, m’étendant sur lesujet de la lumière, j’expliquai bien au long quelle était cellequi se devait trouver dans le soleil et les étoiles, et comment delà elle traversait en un instant les immenses espaces des cieux, etcomment elle se réfléchissait des planètes et des comètes vers laterre. J’y ajoutai aussi plusieurs choses, touchant la substance,la situation, les mouvements et toutes les diverses qualités de cescieux et de ces astres; en sorte que je pensais en dire assez, pourfaire connaître qu’il ne se remarque rien en ceux de ce monde, quine dût, ou du moins qui ne pût, paraître tout semblable en ceux dumonde que je décrivais. De là je vins à parler particulièrement dela Terre: comment, encore que j’eusse expressément supposé que Dieun’avait mis aucune pesanteur en la matière dont elle étaitcomposée, toutes ses parties ne laissaient pas de tendre exactementvers son centre; comment, y ayant de l’eau et de l’air sur sasuperficie, la disposition des cieux et des astres, principalementde la lune, y devait causer un flux et reflux, qui fût semblable,en toutes ses circonstances, à celui qui se remarque dans nos mers;et outre cela un certain cours, tant de l’eau que de l’air, dulevant vers le couchant tel qu’on le remarque aussi entre lestropiques; comment les montagnes, les mers, les fontaines et lesrivières pouvaient naturellement s’y former, et les métaux y venirdans les mines, et les plantes y croître dans les campagnes etgénéralement tous les corps qu’on nomme mêlés ou composés s’yengendrer. Et entre autres choses, à cause qu’après les astres jene connais rien au monde que le feu qui produise de la lumière, jem’étudiai à faire entendre bien clairement tout ce qui appartient àsa nature, comment il se fait, comment il se nourrit; comment iln’a quelquefois que de la chaleur sans lumière, et quelquefois quede la lumière sans chaleur; comment il peut introduire diversescouleurs en divers corps, et diverses autres qualités; comment ilen fond quelques-uns, et en durcit d’autres; comment il les peutconsumer presque tous, ou convertir en cendres et en fumée; etenfin, comment de ces cendres, par la seule violence de son action,il forme du verre; car cette transmutation de cendres en verre mesemblant être aussi admirable qu’aucune autre qui se fasse -en lanature, je pris particulièrement plaisir à la décrire.
Toutefois, je ne voulais pas inférer, de toutes ces choses, quece monde ait été créé en la façon que je proposais; car il est bienplus vraisemblable que, dès le commencement, Dieu l’a rendu telqu’il devait être. Mais il est certain, et c’est une opinioncommunément reçue entre les théologiens, que l’action, par laquellemaintenant il le conserve, est toute la même que celle par laquelleil l’a créé; de façon qu’encore qu’il ne lui aurait point donné, aucommencement, d’autre forme que celle du chaos, pourvu qu’ayantétabli les lois de la nature, il lui prêtât son concours, pour agirainsi qu’elle a de coutume, on peut croire, sans faire tort aumiracle de la création, que par cela seul toutes les choses quiSont purement matérielles auraient pu, avec le temps, s’y rendretelles que nous les voyons à présent. Et leur nature est bien plusaisée à concevoir, lorsqu’on les voit naître peu à peu en cettesorte, que lorsqu’on ne les considère que toutes faites.
De la description des corps inanimés et des plantes, je passai àcelle des animaux et particulièrement à celle des hommes. Maisparce que je n’en avais pas encore assez de connaissance pour enparler du même style que du reste, c’est-à-dire en démontrant leseffets par les causes, et faisant voir de quelles semences, et enquelle façon, la nature les doit produire, je me contentai desupposer que Dieu formât le corps d’un homme, entièrement semblableà l’un des nôtres, tant en la figure extérieure de ses membresqu’en la conformation intérieure de ses organes, sans le composerd’autre matière que de celle que j’avais décrite, et sans mettre enlui, au commencement, aucune âme raisonnable, ni aucune autre chosepour y servir d’âme végétante ou sensitive sinon qu’il excitât enson cœur un de ces feux sans lumière, que j’avais déjà expliqués,et que je ne concevais point d’autre nature que celui qui échauffele foin, lorsqu’on l’a renfermé avant qu’il fût sec, ou qui faitbouillir les vins nouveaux, lorsqu’on les laisse cuver sur la râpe.Car, examinant les fonctions qui pouvaient en suite de cela être ence corps, j’y trouvais exactement toutes celles qui peuvent être ennous sans que nous y pensions, ni par conséquent que notre âme,c’est-à-dire cette partie distincte du corps dont il a été ditci-dessus que la nature n’est que de penser, y contribue, et quisont toutes les mêmes, en quoi on peut dire que les animaux sansraison nous ressemblent : sans que j’y en pusse pour cela trouveraucune de celles qui, étant dépendantes de la pensée, sont lesseules qui nous appartiennent en tant qu’hommes, au lieu que je lesy trouvais toutes par après, ayant supposé que Dieu créât une âmeraisonnable, et qu’il la joignît à ce corps en certaine façon queje décrivais.
Mais, afin qu’on puisse voir en quelle sorte j’y traitais cettematière, je veux mettre ici l’explication du mouvement du cœur etdes artères, qui, étant le premier et le plus général qu’on observedans les animaux, on jugera facilement de lui ce qu’on doit penserde tous les autres. Et afin qu’on ait moins de difficulté àentendre ce que j’en dirai, je voudrais que ceux qui ne sont pointversés dans l’anatomie prissent la peine, avant que de lire ceci,de faire couper devant eux le cœur de quelque grand animal qui aitdes poumons, car il est en tous assez semblable à celui de l’homme,et qu’il se fissent montrer les deux chambres ou concavités qui ysont. Premièrement, celle qui est dans son côté droit, à laquellerépondent deux tuyaux fort larges : à savoir la veine cave, qui estle principal réceptacle du sang, et comme le tronc de l’arbre donttoutes les autres veines du corps sont les branches, et la veineartérieuse, qui a été ainsi mal nommée, parce que c’est en effetune artère, laquelle, prenant son origine du cœur, se divise, aprèsen être sortie, en plusieurs branches qui se vont répandre partoutdans les poumons. Puis, celle qui est dans son côté gauche, àlaquelle répondent en même façon deux tuyaux, qui sont autant ouplus larges que les précédents : à savoir l’artère veineuse, qui aété aussi mal nommée, à cause qu’elle n’est autre chose qu’uneveine, laquelle vient des poumons, où elle est divisée en plusieursbranches, entrelacées avec celles de la veine artérieuse, et cellesde ce conduit qu’on nomme le sifflet, par où entre l’air de larespiration; et la grande artère, qui, sortant du cœur, envoie sesbranches par tout le corps. Je voudrais aussi qu’on leur montrâtsoigneusement les onze petites peaux, qui, comme autant de petitesportes, ouvrent et ferment les quatre ouvertures qui sont en cesdeux concavités : à savoir, trois à l’entrée de la veine cave, oùelles sont tellement disposées, qu’elles ne peuvent aucunementempêcher que le sang qu’elle contient ne coule dans la concavitédroite du cœur, et toutefois empêchent exactement qu’il n’en puissesortir; trois à l’entrée de la veine artérieuse, qui, étantdisposées tout au contraire, permettent bien au sang, qui est danscette concavité, de passer dans les poumons, mais non pas à celuiqui est dans les poumons d’y retourner; et ainsi deux autres àl’entrée de l’artère veineuse, qui laissent couler le sang despoumons vers la concavité gauche du cœur, mais s’opposent à sonretour; et trois à l’entrée de la grande artère, qui lui permettentde sortir du cœur, mais l’empêchent d’y retourner. Et il n’estpoint besoin de chercher d’autre raison du nombre de ces peaux,sinon que l’ouverture de l’artère veineuse, étant en ovale à causedu lieu où elle se rencontre, peut être commodément fermée avecdeux, au lieu que les autres, étant rondes, le peuvent mieux êtreavec trois. De plus, je voudrais qu’on leur fît considérer que lagrande artère et la veine artérieuse sont d’une compositionbeaucoup plus dure et plus ferme que ne sont l’artère veineuse etla veine cave; et que ces deux dernières s’élargissent avant qued’entrer dans le cœur, et y font comme deux bourses, nommées lesoreilles du cœur, qui sont composées d’une chair semblable à lasienne; et qu’il y a toujours plus de chaleur dans le cœur qu’enaucun autre endroit du corps, et, enfin, que cette chaleur estcapable de faire que, s’il entre quelque goutte de sang en sesconcavités, elle s’enfle promptement et se dilate, ainsi que fontgénéralement toutes les liqueurs, lorsqu’on les laisse tombergoutte à goutte en quelque vaisseau qui est fort chaud.
Car, après cela, je n’ai besoin de dire autre chose pourexpliquer le mouvement du cœur, sinon que, lorsque ses concavitésne sont pas pleines de sang, il y en coule nécessairement de laveine cave dans la droite, et de l’artère veineuse dans la gauche;d’autant que ces deux vaisseaux en sont toujours pleins, et queleurs ouvertures, qui regardent vers le cœur, ne peuvent alors êtrebouchées; mais que, sitôt qu’il est entré ainsi deux gouttes desang, une en chacune de ses concavités, ces gouttes, qui ne peuventêtre que fort grosses, à cause que les ouvertures par où ellesentrent sont fort larges, et les vaisseaux d’où elles viennent fortpleins de sang, se raréfient et se dilatent, à cause de la chaleurqu’elles y trouvent, au moyen de quoi, faisant enfler tout le cœur,elles poussent et ferment les cinq petites portes qui sont auxentrées des deux vaisseaux d’où elles viennent, empêchant ainsiqu’il ne descende davantage de sang dans le cœur; et continuant àse raréfier de plus en plus, elles poussent et ouvrent les sixautres petites portes qui sont aux entrées des deux autresvaisseaux par où elles sortent, faisant enfler par ce moyen toutesles branches de la veine artérieuse et de la grande artère, quasiau même instant que le cœur; lequel, incontinent après, sedésenfle, comme font aussi ces artères, à cause que le sang qui yest entré s’y refroidit, et leurs six petites portes se referment,et les cinq de la veine cave et de l’artère veineuse se rouvrent,et donnent passage à deux autres gouttes de sang, qui font derechefenfler le cœur et les artères, tout de même que les précédentes. Etparce que le sang, qui entre ainsi dans le cœur, passe par ces deuxbourses qu’on nomme ses oreilles, de là vient que leur mouvementest contraire au sien, et qu’elles se désenflent lorsqu’il s’enfle.Au reste, afin que ceux qui ne connaissent pas la force desdémonstrations mathématiques, et ne sont pas accoutumés àdistinguer les vraies raisons des vraisemblables, ne se hasardentpas de nier ceci sans l’examiner, je les veux avertir que cemouvement, que je viens d’expliquer, suit aussi nécessairement dela seule disposition des organes qu’on peut voir à l’œil dans lecœur, et de la chaleur qu’on y peut sentir avec les doigts, et dela nature du sang qu’on peut connaître par expérience, que faitcelui d’une horloge, de la force, de la situation et de la figurede ses contrepoids et de ses roues.
Mais si on demande comment le sang des veines ne s’épuise point,en coulant ainsi continuellement dans le cœur, et comment lesartères n’en sont point trop remplies, puisque tout celui qui passepar le cœur s’y va rendre, je n’ai pas besoin d’y répondre autrechose que ce qui a déjà été écrit par un médecin d’Angleterre,auquel il faut donner la louange d’avoir rompu la glace en cetendroit, et d’être le premier qui a enseigné qu’il y a plusieurspetits passages aux extrémités des artères, par où le sang qu’ellesreçoivent du cœur entre dans les petites branches des veines, d’oùil se va rendre derechef vers le cœur, en sorte que son cours n’estautre chose qu’une circulation perpétuelle. Ce qu’il prouve fortbien, par l’expérience ordinaire des chirurgiens, qui ayant lié lebras médiocrement fort, au-dessus de l’endroit où ils ouvrent laveine, font que le sang en sort plus abondamment que s’ils nel’avaient point lié. Et il arriverait tout le contraire, s’ils leliaient au-dessous, entre la main et l’ouverture, ou bien qu’ils leliassent très fort au-dessus. Car il est manifeste que le lienmédiocrement serré, pouvant empêcher que le sang qui est déjà dansle bras ne retourne vers le cœur par les veines, n’empêche pas pourcela qu’il n’y en vienne toujours de nouveau par les artères, àcause qu’elles sont situées au-dessous des veines, et que leurspeaux, étant plus dures, sont moins aisées à presser, et aussi quele sang qui vient du cœur tend avec plus de force à passer parelles vers la main, qu’il ne fait à retourner de là vers le cœurpar les veines. Et, puisque ce sang sort du bras par l’ouverturequi est en l’une des veines, il doit nécessairement y avoirquelques passages au-dessous du lien, c’est-à-dire vers lesextrémités du bras, par où il y puisse venir des artères. Il prouveaussi fort bien ce qu’il dit du cours du sang, par certainespetites Peaux> qui sont tellement disposées en divers lieux lelong des veines, qu’elles ne lui permettent point d’y passer dumilieu du corps vers les extrémités, mais seulement de retournerdes extrémités vers le cœur; et, de plus, par l’expérience quimontre que tout celui qui est dans le corps en peut sortir en fortpeu de temps par une seule artère, lorsqu’elle est coupée, encoremême qu’elle fût étroitement liée fort proche du cœur, et coupéeentre lui et le lien, en sorte qu’on n’eût aucun sujet d’imaginerque le sang qui en sortirait vînt d’ailleurs.
Mais il y a plusieurs autres choses qui témoignent que la vraiecause de ce mouvement du sang est celle que j’ai dite. Comme,premièrement, la différence qu’on remarque entre celui qui sort desveines et celui qui sort des artères, ne peut procéder que de cequ’étant raréfié, et comme distillé, en passant par le cœur, il estplus subtil et plus vif et plus chaud incontinent après en êtresorti, c’est-à-dire, étant dans les artères, qu’il n’est un peudevant que d’y entrer, c’est-à-dire, étant dans les veines. Et, sion y prend garde, on trouvera que cette différence ne paraît bienque vers le cœur, et non point tant aux lieux qui en sont les pluséloignés. Puis la dureté des peaux, dont la veine artérieuse et lagrande artère sont composées, montre assez que le sang bat contreelles avec plus de force que contre les veines. Et pourquoi laconcavité gauche du cœur et la grande artère seraient-elles plusamples et plus larges que la concavité droite et la veineartérieuse ? Si ce n’était que le sang de l’artère veineuse,n’ayant été que dans les poumons depuis qu’il a passé par le cœur,est plus subtil et se raréfie plus fort et plus aisément que celuiqui vient immédiatement de la veine cave. Et qu’est-ce que lesmédecins peuvent deviner, en tâtant le pouls, s’ils ne savent que,selon que le sang change de nature, il peut être raréfié par lachaleur du cœur plus ou moins fort, et plus ou moins vitequ’auparavant ? Et si on examine comment cette chaleur secommunique aux autres membres, ne faut-il pas avouer que c’est parle moyen du sang, qui passant par le cœur s’y réchauffe, et serépand de là par tout le corps ? D’où vient que, si on ôte lesang de quelque partie, on en ôte par même moyen la chaleur; etencore que le cœur fût aussi ardent qu’un fer embrasé, il nesuffirait pas pour réchauffer les pieds et les mains tant qu’ilfait, s’il n’y envoyait continuellement de nouveau sang. Puis aussion connaît de là que le vrai usage de la respiration est d’apporterassez d’air frais dans le poumon, pour faire que le sang, qui yvient de la concavité droite du cœur, où il a été raréfié et commechangé en vapeurs, s’y épaississe et convertisse en sang derechef,avant que de retomber dans la gauche, sans quoi il ne pourrait êtrepropre à servir de nourriture au feu qui y est. Ce qui se confirme,parce qu’on voit que les animaux qui n’ont point de poumons n’ontaussi qu’une seule concavité dans le cœur, et que les enfants, quin’en peuvent user pendant qu’ils sont renfermés au ventre de leursmères, ont une ouverture par où il coule du sang de la veine caveen la concavité gauche du cœur, et un conduit par où il en vient dela veine artérieuse en la grande artère, sans passer par le poumon.Puis la coction, comment se ferait-elle en l’estomac, si le cœurn’y envoyait de la chaleur par les artères, et avec celaquelques-unes des plus coulantes parties du sang, qui aident àdissoudre les viandes qu’on y a mises ? Et l’action quiconvertit le suc de ces viandes en sang n’est-elle pas aisée àconnaître, si on considère qu’il se distille, en passant etrepassant par le cœur, peut-être par plus de cent ou deux centsfois en chaque jour ? Et qu’a-t-on besoin d’autre chose, pourexpliquer la nutrition, et la production des diverses humeurs quisont dans le corps, sinon de dire que la force, dont le sang en seraréfiant passe du cœur vers les extrémités des artères, fait quequelques-unes de ses parties s’arrêtent entre celles des membres oùelles se trouvent, et y prennent la place de quelques autresqu’elles en chassent; et que, selon la situation, ou la figure, oula petitesse des pores qu’elles rencontrent, les unes se vontrendre en certains lieux plutôt que les autres, en même façon quechacun peut avoir vu divers cribles qui, étant diversement percés,servent à séparer divers grains les uns des autres ? Et enfince qu’il y a de plus remarquable en tout ceci, c’est la générationdes esprits animaux, qui sont comme un vent très subtil, ou plutôtcomme une flamme très pure et très vive qui, montantcontinuellement en grande abondance du cœur dans le cerveau, se varendre de là par les nerfs dans les muscles, et donne le mouvementà tous les membres; sans qu’il faille imaginer d’autre cause, quifasse que les parties du sang qui, étant les plus agitées et lesplus pénétrantes, sont les plus propres à composer ces esprits, sevont rendre plutôt vers le cerveau que vers ailleurs; sinon que lesartères, qui les y portent, sont celles qui viennent du cœur leplus en ligne droite de toutes, et que, selon les règles desmécaniques, qui sont les mêmes que celles de la nature, lorsqueplusieurs choses tendent ensemble à se mouvoir vers un même côté,où il n’y a pas assez de place pour toutes, ainsi que les partiesdu sang qui sortent de la concavité gauche du cœur tendent vers lecerveau, les plus faibles et moins agitées en doivent êtredétournées par les plus fortes, qui par ce moyen s’y vont rendreseules.
J’avais expliqué assez particulièrement toutes ces choses dansle traité que j’avais eu ci-devant dessein de publier. Et ensuitej’y avais montré quelle doit être la fabrique des nerfs et desmuscles du corps humain, pour faire que les esprits animaux, étantdedans, aient la force de mouvoir ses membres : ainsi qu’on voitque les têtes, un peu après être coupées, se remuent encore, etmordent la terre, nonobstant qu’elles ne soient plus animées; quelschangements se doivent faire dans le cerveau, pour causer laveille, et le sommeil, et les songes; comment la lumière, les sons,les odeurs, les goûts, la chaleur, et toutes les autres qualitésdes objets extérieurs y peuvent imprimer diverses idées parl’entremise des sens; comment la faim, la soif, et les autrespassions intérieures, y peuvent aussi envoyer les leurs; ce quidoit y être pris pour le sens commun, où ces idées sont reçues;pour la mémoire, qui les conserve; et pour la fantaisie, qui lespeut diversement changer et en composer de nouvelles, et par mêmemoyen, distribuant les esprits animaux dans les muscles, fairemouvoir les membres de ce corps en autant de diverses façons, etautant à propos des objets qui se présentent à ses sens, et despassions intérieures qui sont en lui, que les nôtres se puissentmouvoir, sans que la volonté les conduise. Ce qui ne sembleranullement étrange à ceux qui, sachant combien de divers automates,ou machines mouvantes, l’industrie des hommes peut faire, sans yemployer que fort peu de pièces, à comparaison de la grandemultitude des os, des muscles, des nerfs, des artères, des veines,et de toutes les autres parties qui sont dans le corps de chaqueanimal, considéreront ce corps comme une machine, qui, ayant étéfaite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée, et aen soi des mouvements plus admirables, qu’aucune de celles quipeuvent être inventées par les hommes.
Et je m’étais ici particulièrement arrêté à faire voir que, s’ily avait de telles machines, qui eussent les organes et la figured’un singe, ou de quelque autre animal sans raison, nous n’aurionsaucun moyen pour reconnaître qu’elles ne seraient pas en tout demême nature que ces animaux; au lieu que, s’il y en avait quieussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nosactions que moralement il serait possible, nous aurions toujoursdeux moyens très certains pour reconnaître qu’elles ne seraientpoint pour cela de vrais hommes. Dont le premier est que jamaiselles ne pourraient user de paroles, ni d’autres signes en lescomposant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées.Car on peut bien concevoir qu’une machine soit tellement faitequ’elle profère des paroles, et même qu’elle en profèrequelques-unes à propos des actions corporelles qui causerontquelque changement en ses organes : comme, si on la touche enquelque endroit, qu’elle demande ce qu’on lui veut dire; si en unautre, qu’elle crie qu’on lui fait mal, et choses semblables; maisnon pas qu’elle les arrange diversement, pour répondre au sens detout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plushébétés peuvent faire. Et le second est que, bien qu’elles fissentplusieurs choses aussi bien, ou peut-être mieux qu’aucun de nous,elles manqueraient infailliblement en quelques autres, parlesquelles on découvrirait qu’elles n’agiraient pas parconnaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes.Car, au lieu que la raison est un instrument universel, qui peutservir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin dequelque particulière disposition pour chaque action particulière;d’où vient qu’il est moralement impossible qu’il y en ait assez dedivers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrencesde la vie, de même façon que notre raison nous fait agir.
Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître ladifférence qui est entre les hommes et les bêtes. Car c’est unechose bien remarquable, qu’il n’y a point d’hommes si hébétés et sistupides, sans en excepter même les insensés, qu’ils ne soientcapables d’arranger ensemble diverses paroles, et d’en composer undiscours par lequel ils fassent entendre leurs pensées; et qu’aucontraire, il n’y a point d’autre animal, tant parlait et tantheureusement né qu’il puisse être, qui fasse le semblable. Ce quin’arrive pas de ce qu’ils ont faute d’organes, car on voit que lespies et les, perroquets peuvent proférer des paroles ainsi quenous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c’est-à-direen témoignant qu’ils pensent ce qu’ils disent; au lieu que leshommes qui, étant nés sourds et muets, sont privés des organes quiservent aux autres pour parler, autant ou plus que les bêtes, ontcoutume d’inventer d’eux-mêmes quelques signes, par lesquels ils sefont entendre à ceux qui, étant ordinairement avec eux, ont loisird’apprendre leur langue. Et ceci ne témoigne pas seulement que lesbêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu’elles n’en ontpoint du tout. Car on voit qu’il n’en faut que fort peu pour savoirparler; et d’autant qu’on remarque de. l’inégalité entre lesanimaux d’une même espèce, aussi bien qu’entre les hommes, et queles uns sont plus aisés à dresser que les autres, il n’est pascroyable qu’un singe ou un perroquet, qui serait des plus parfaitsde son espèce, n’égalât en cela un enfant des plus stupides, ou dumoins un enfant qui aurait le cerveau troublé, si leur âme n’étaitd’une nature du tout différente de la nôtre. Et on ne doit pasconfondre les paroles avec les mouvements naturels, qui témoignentles passions, et peuvent être imités par des machines aussi bienque par les animaux; ni penser, comme quelques anciens, que lesbêtes parlent, bien que nous n’entendions pas leur langage : cars’il était vrai, puisqu’elles ont plusieurs organes qui serapportent aux nôtres, elles pourraient aussi bien se faireentendre à nous qu’à leurs semblables. C’est aussi une chose fortremarquable que, bien qu’il y ait plusieurs animaux qui témoignentplus d’industrie que nous en quelques-unes de leurs actions, onvoit toutefois que les mêmes n’en témoignent point du tout enbeaucoup d’autres : de façon que ce qu’ils font mieux que nous neprouve pas qu’ils ont de l’esprit; car, à ce compte, ils enauraient plus qu’aucun de nous et feraient mieux en toute chose;mais plutôt qu’ils n’en ont point, et que c’est la Nature qui agiten eux, selon la disposition de leurs organes : ainsi qu’on voitqu’une horloge, qui n’est composée que de roues et de ressorts,peut compter les heures, et mesurer le temps, plus justement quenous avec toute notre prudence.
J’avais décrit, après cela, l’âme raisonnable, et fait voirqu’elle ne peut aucunement être tirée de la puissance de lamatière, ainsi que les autres choses dont j’avais parlé, maisqu’elle doit expressément être créée; et comment il ne suffit pasqu’elle soit logée dans le corps humain, ainsi qu’un pilote en sonnavire, sinon peut-être pour mouvoir ses membres, mais qu’il estbesoin qu’elle soit jointe et unie plus étroitement avec lui pouravoir, outre cela, des sentiments et des appétits semblables auxnôtres, et ainsi composer un vrai homme. Au reste, je me suis iciun peu étendu sur le sujet de l’âme, à cause qu’il est des plusimportants; car, après l’erreur de ceux qui nient Dieu, laquelle jepense avoir ci-dessus assez réfutée, il n’y en a point qui éloigneplutôt les esprits faibles du droit chemin de la vertu, qued’imaginer que l’âme des bêtes soit de même nature que la nôtre, etque, par conséquent, nous n’avons rien à craindre, ni à espérer,après cette vie, non plus que les mouches et les fourmis; au lieuque, lorsqu’on sait combien elles diffèrent, on comprend beaucoupmieux les raisons, qui prouvent que la nôtre est d’une natureentièrement indépendante du corps et, par conséquent, qu’elle n’estpoint sujette à mourir avec lui; puis, d’autant qu’on ne voit pointd’autres causes qui la détruisent, on est naturellement porté àjuger de là qu’elle est immortelle.
Partie 6
Or, il y a maintenant trois ans que j’étais parvenu à la fin dutraité qui contient toutes ces choses, et que je commençais à lerevoir, afin de le mettre entre les mains d’un imprimeur, lorsquej’appris que des personnes, à qui je défère et dont l’autorité nepeut guère moins sur mes actions que ma propre raison sur mespensées, avaient désapprouvé une opinion de physique, publiée unpeu auparavant par quelque autre, de laquelle je ne veux pas direque je fusse, mais bien que je n’y avais rien remarqué, avant leurcensure, que je pusse imaginer être préjudiciable ni à la religionni à l’État, ni, par conséquent, qui m’eût empêché de l’écrire, sila raison me l’eût persuadée, et que cela me fit craindre qu’il nes’en trouvât tout de même quelqu’une entre les miennes, en laquelleje me fusse mépris, nonobstant le grand soin que j’ai toujours eude n’en point recevoir de nouvelles en ma créance, dont je n’eussedes démonstrations très certaines, et de n’en point écrire quipussent tourner au désavantage de personne. Ce qui a été suffisantpour m’obliger à changer la résolution que j’avais eue de lespublier. Car, encore que les raisons, pour lesquelles je l’avaisprise auparavant, fussent très fortes, mon inclination, qui m’atoujours fait haïr le métier de faire des livres, m’en fitincontinent trouver assez d’autres pour m’en excuser. Et cesraisons de part et d’autre sont telles, que non seulement j’ai iciquelque intérêt de les dire, mais peut-être aussi que le publie ena de les avoir.
Je n’ai jamais fait beaucoup d’état des choses qui venaient demon esprit, et pendant que je n’ai recueilli d’autres fruits de laméthode dont je me sers, sinon que je me suis satisfait, touchantquelques difficultés qui appartiennent aux sciences spéculatives,ou bien que j’ai tâché de régler mes mœurs par les raisons qu’ellem’enseignait, je n’ai point cru être obligé d’en rien écrire. Car,pour ce qui touche les mœurs, chacun abonde si fort en son sens,qu’il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes, s’ilétait permis à d’autres qu’à ceux que Dieu a établis poursouverains sur ses peuples, ou bien auxquels il a donné assez degrâce et de zèle pour être prophètes, d’entreprendre d’y rienchanger; et bien que mes spéculations me plussent fort, j’ai cruque les autres en avaient aussi qui leur plaisaient peut-êtredavantage. Mais, sitôt que j’ai eu acquis quelques notionsgénérales touchant la physique, et que, commençant à les éprouveren diverses difficultés particulières, j’ai remarqué jusques oùelles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principesdont on s’est servi jusques à présent, j’ai cru que je ne pouvaisles tenir cachées, sans pécher grandement contre la loi qui nousoblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général detous les hommes. Car elles m’ont fait voir qu’il est possible deparvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, etqu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dansles écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle,connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, desastres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent,aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nosartisans, nous les pourrions employer en même façon à tous lesusages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre commemaîtres et possesseurs de la Nature. Ce qui n’est pas seulement àdésirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraientqu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et detoutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussipour la conservation de la santé, laquelle est sans doute lepremier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie;car même l’esprit dépend si fort du tempérament, et de ladisposition des organes du corps que, s’il est possible de trouverquelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plushabiles qu’ils n’ont été jusques ici, je crois que c’est dans lamédecine qu’on doit le chercher. Il est vrai que celle qui estmaintenant en usage contient peu de choses dont l’utilité soit siremarquable; mais, sans que j’aie aucun dessein de la mépriser, jem’assure qu’il n’y a personne, même de ceux qui en font profession,qui n’avoue que tout ce qu’on y sait n’est presque rien, acomparaison de ce qui reste à y savoir, et qu’on se pourraitexempter d’une infinité de maladies, tant du corps que de l’esprit,et même aussi peut-être de l’affaiblissement de la vieillesse, sion avait assez de connaissance de leurs causes, et de tous lesremèdes dont la Nature nous a pourvus. Or, ayant dessein d’employertoute ma vie à la recherche d’une science si nécessaire, et ayantrencontré un chemin qui me semble tel qu’on doit infailliblement latrouver, en le suivant, si ce n’est qu’on en soit empêché, ou parla brièveté de la vie, ou par le défaut des expériences, je jugeaisqu’il n’y avait point de meilleur remède contre ces deuxempêchements que de communiquer fidèlement au public tout le peuque j’aurais trouvé, et de convier les bons esprits à tâcher depasser plus outre, en contribuant, chacun selon son inclination etson pouvoir, aux expériences qu’il faudrait faire, et communiquantaussi au public toutes les choses qu’ils apprendraient, afin queles derniers commençant où les précédents auraient achevé, etainsi, joignant les vies et les travaux de plusieurs, nousallassions tous ensemble beaucoup plus loin que chacun enparticulier ne saurait faire.
Même je remarquais, touchant les expériences, qu’elles sontd’autant plus nécessaires qu’on est plus avancé en connaissance.Car, pour le commencement, il vaut mieux ne se servir que de cellesqui se présentent d’elles-mêmes a nos Sens, et que nous ne saurionsignorer, pourvu que nous y fassions tant soit peu de réflexion, qued’en chercher de plus rares et étudiées : dont la raison est queces plus rares trompent souvent, lorsqu’on ne sait pas encore lescauses des plus communes, et que les circonstances dont ellesdépendent sont quasi toujours si particulières et si petites, qu’ilest très malaisé de les remarquer. Mais l’ordre que j’ai tenu enceci a été tel. Premièrement, j’ai tâché de trouver en général lesprincipes, ou premières causes, de tout ce qui est, ou qui peutêtre, dans le monde, sans rien considérer, pour cet effet, que Dieuseul, qui l’a créé, ni les tirer d’ailleurs que de certainessemences de vérités qui sont naturellement en nos âmes. Après cela,j’ai examiné quels étaient les premiers et plus ordinaires effetsqu’on pouvait déduire de ces causes : et il me semble que, par là,j’ai trouvé des cieux, des astres, une Terre, et même, sur laterre, de l’eau, de l’air, du feu, des minéraux, et quelques autrestelles choses qui sont les plus communes de toutes et les plussimples, et par conséquent les plus aisées à connaître. Puis,lorsque j’ai voulu descendre à celles qui étaient plusparticulières, il s’en est tant présenté à moi de diverses, que jen’ai pas cru qu’il fût possible à l’esprit humain de distinguer lesformes ou espèces de corps qui sont sur la terre d’une infinitéd’autres qui pourraient y être, si c’eût été le vouloir de Dieu deles y mettre, ni, par conséquent, de les rapporter à notre usage,si ce n’est qu’on vienne au-devant des causes par les effets, etqu’on se serve de plusieurs expériences particulières. En suite dequoi, repassant mon esprit sur tous les objets qui s’étaient jamaisprésentés à mes sens, j’ose bien dire que je n’y ai remarqué aucunechose que je ne pusse assez commodément expliquer par les principesque j’avais trouvés. Mais il faut aussi que j’avoue que lapuissance de la Nature est si ample et si vaste, et que cesprincipes sont si simples et si généraux, que je ne remarque quasiplus aucun effet particulier, que d’abord je ne connaisse qu’ilpeut en être déduit en plusieurs diverses façons, et que ma plusgrande difficulté est d’ordinaire de trouver en laquelle de cesfaçons il en dépend. Car à cela je ne sais point d’autre expédient,que de chercher derechef quelques expériences, qui soient telles,que leur événement ne soit pas le même, si c’est en l’une de cesfaçons qu’on doit l’expliquer, que si c’est en l’autre. Au reste,j’en suis maintenant là, que je vois, ce me semble, assez bien dequel biais on se doit prendre à faire la plupart de celles quipeuvent servir à cet effet; mais je vois aussi qu’elles sonttelles, et en si grand nombre, que ni mes mains, ni mon revenu,bien que j’en eusse mille fois plus que je n’en ai, ne sauraientsuffire pour toutes; en sorte que, selon que j’aurai désormais lacommodité d’en faire plus ou moins, j’avancerai aussi plus ou moinsen la connaissance de la Nature. Ce que je me promettais de faireconnaître, par le traité que j’avais écrit, et d’y montrer siclairement l’utilité que le public en peut recevoir, quej’obligerais tous ceux qui désirent en général le bien des hommes,c’est-à-dire tous ceux qui sont en effet vertueux, et non point parfaux semblant, ni seulement par opinion, tant à me communiquercelles qu’ils ont déjà faites, qu’à m’aider en la recherche decelles qui restent à faire.
Mais j’ai eu, depuis ce temps-là, d’autres raisons qui m’ontfait changer d’opinion, et penser que je devais véritablementcontinuer d’écrire toutes les choses que je jugerais de quelqueimportance, à mesure que j’en découvrirais la vérité, et y apporterle même soin que si je les voulais faire imprimer : tant afind’avoir d’autant plus d’occasion de les bien examiner, comme sansdoute on regarde toujours de plus près à ce qu’on croit devoir êtrevu par plusieurs, qu’à ce qu’on ne fait que pour soi-même, etsouvent les choses qui m’ont semblé vraies lorsque j’ai commencé àles concevoir, m’ont paru fausses lorsque je les ai voulu mettresur le papier; qu’afin de ne perdre aucune occasion de profiter aupublic, si j’en suis capable, et que, si mes écrits valent quelquechose, ceux qui les auront après ma mort en puissent user ainsiqu’il sera le plus à propos; mais que je ne devais aucunementconsentir qu’ils fussent publiés pendant ma vie, afin que ni lesoppositions et controverses, auxquelles ils seraient peut-êtresujets, ni même la réputation telle quelle, qu’ils me pourraientacquérir, ne me donnassent aucune occasion de perdre le temps quej’ai dessein d’employer à m’instruire. Car, bien qu’il soit vraique chaque homme est obligé de procurer, autant qu’il est en lui,le bien des autres, et que c’est proprement ne valoir rien que den’être utile à personne, toutefois il est vrai aussi que nos soinsse doivent étendre plus loin que le temps présent, et qu’il est bond’omettre les choses qui apporteraient peut-être quelque profit àceux qui vivent, lorsque c’est à dessein d’en faire d’autres qui enapportent davantage à nos neveux. Comme, en effet, je veux bienqu’on sache que le peu que j’ai appris jusqu’ici n’est presquerien, à comparaison de ce que j’ignore, et que je ne désespère pasde pouvoir apprendre; car c’est quasi le même de ceux quidécouvrent peu à peu la vérité dans les sciences, que de ceux qui,commençant à devenir riches, ont moins de peine à faire de grandesacquisitions, qu’ils n’ont eu auparavant, étant plus pauvres, à enfaire de beaucoup moindres. Ou bien on peut les comparer aux chefsd’armée, dont les forces ont coutume de croître à proportion deleurs victoires, et qui ont besoin de plus de conduite, pour semaintenir après la perte d’une bataille, qu’ils n’ont, aprèsl’avoir gagnée, à prendre des villes et des provinces. Car c’estvéritablement donner des batailles, que de tâcher à vaincre toutesles difficultés et les erreurs qui nous empêchent de parvenir à laconnaissance de la vérité, et c’est en perdre une, que de recevoirquelque fausse opinion touchant une matière un peu générale etimportante; il faut, après, beaucoup plus d’adresse, pour seremettre au même état qu’on était auparavant, qu’il ne faut à fairede grands progrès, lorsqu’on a déjà des principes qui sont assurés.Pour moi, si j’ai ci-devant trouvé quelques vérités dans lessciences (et j’espère que les choses qui sont contenues en cevolume feront juger que j’en ai trouvé quelques-unes), je puis direque ce ne sont que des suites et des dépendances de cinq ou sixprincipales difficultés que j’ai surmontées, et que je compte pourautant de batailles où j’ai eu l’heur de mon côté. Même je necraindrai pas de dire que je pense n’avoir plus besoin d’en gagnerque deux ou trois autres semblables pour venir entièrement à boutde mes desseins; et que mon âge n’est point si avancé que, selon lecours ordinaire de la Nature, je ne puisse encore avoir assez deloisir pour cet effet. Mais je crois être d’autant plus obligé àménager le temps qui me reste, que j’ai plus d’espérance de lepouvoir bien employer; et j’aurais sans doute plusieurs occasionsde le perdre, si je publiais les fondements de ma Physique. Car,encore qu’ils soient presque tous si évidents, qu’il ne faut queles entendre pour les croire, et qu’il n’y en ait aucun, dont je nepense pouvoir donner des démonstrations, toutefois, à cause qu’ilest impossible qu’ils soient accordants avec toutes les diversesopinions des autres hommes, je prévois que je serais souventdiverti par les oppositions qu’ils feraient naître.
On peut dire que ces oppositions seraient utiles, tant afin deme faire connaître mes fautes, qu’afin que, si j’avais quelquechose de bon, les autres en eussent par ce moyen plusd’intelligence, et, comme plusieurs peuvent plus voir qu’un hommeseul, que commençant dès maintenant à s’en servir, ils m’aidassentaussi de leurs inventions. Mais, encore que je me reconnaisseextrêmement sujet à faillir, et que je ne me fie quasi jamais auxpremières pensées qui me viennent, toutefois l’expérience que j’aides objections qu’on me peut faire m’empêche d’en espérer aucunprofit : car j’ai déjà souvent éprouvé les jugements, tant de ceuxque j’ai tenus pour mes amis, que de quelques autres à qui jepensais être indifférent, et même aussi de quelques-uns dont jesavais que la malignité et l’envie tâcheraient assez à découvrir ceque l’affection cacherait à mes amis; mais il est rarement arrivéqu’on m’ait objecté quelque chose que je n’eusse point du toutprévue, si ce n’est qu’elle fût fort éloignée de mon sujet; ensorte que je n’ai quasi jamais rencontré aucun censeur de mesopinions, qui ne me semblât ou moins rigoureux, ou moins équitableque moi-même. Et je n’ai jamais remarqué non plus que, par le moyendes disputes qui se pratiquent dans les écoles, on ait découvertaucune vérité qu’on ignorât auparavant; car, pendant que chacuntâche de vaincre, on s’exerce bien plus à faire valoir lavraisemblance, qu’à peser les raisons de part et d’autre; et ceuxqui ont été longtemps bons avocats ne sont pas pour cela, paraprès, meilleurs juges.
Pour l’utilité que les autres recevraient de la communication demes pensées, elle ne pourrait aussi être fort grande, d’autant queje ne les ai point encore conduites si loin, qu’il ne soit besoind’y ajouter beaucoup de choses avant que de les appliquer àl’usage. Et je pense pouvoir dire, sans vanité, que, s’il y aquelqu’un qui en soit capable, ce doit être plutôt moi qu’aucunautre: non pas qu’il ne puisse y avoir au monde plusieurs espritsincomparablement meilleurs que le mien; mais pour ce qu’on nesaurait si bien concevoir une chose, et la rendre sienne, lorsqu’onl’apprend de quelque autre, que lorsqu’on l’invente soi-même. Cequi est si véritable, en cette matière, que, bien que j’aie souventexpliqué quelques-unes de mes opinions à des personnes de très bonesprit, et qui, pendant que je leur parlais, semblaient lesentendre fort distinctement, toutefois, lorsqu’ils les ont redites,j’ai remarqué qu’ils. les ont changées presque toujours en tellesorte que je ne les pouvais plus avouer pour miennes. A l’occasionde quoi je suis bien aise de prier ici nos neveux de ne croirejamais que les choses qu’on leur dira viennent de moi, lorsque jene les aurai point moi-même divulguées. Et je ne m’étonneaucunement des extravagances qu’on attribue à tous ces anciensPhilosophes, dont nous n’avons point les écrits, ni ne juge pas,pour cela, que leurs pensées aient été fort déraisonnables, vuqu’ils étaient des meilleurs esprits de leurs temps, mais seulementqu’on nous les a mal rapportées, Comme on voit aussi que presquejamais il n’est arrivé qu’aucun de leurs sectateurs les aitsurpassés; et je m’assure que les plus passionnés de ceux quisuivent maintenant Aristote se croiraient heureux, s’ils avaientautant de connaissance de la nature qu’il a en eu, encore même quece fût à condition qu’ils n’en auraient jamais davantage. Ils sontcomme le lierre, qui ne tend point à monter plus haut que lesarbres qui le soutiennent, et même souvent qui redescend, aprèsqu’il est parvenu jusques à leur faîte; car il me semble aussi queceux-la redescendent, c’est-à-dire se rendent en quelque façonmoins savants que s’ils s’abstenaient d’étudier, lesquels, noncontents de savoir tout ce qui est, intelligiblement expliqué dansleur auteur, veulent, outre cela, y trouver la solution deplusieurs difficultés, dont il ne dit rien et auxquelles il n’apeut-être jamais pensé. Toutefois, leur façon de philosopher estfort commode, pour ceux qui n’ont que des esprits fort médiocres;car l’obscurité des distinctions et des principes dont ils seservent est cause qu’ils peuvent parler de toutes choses aussihardiment que s’ils les savaient, et soutenir tout ce qu’ils endisent contre les plus subtils et les plus habiles sans qu’on aitmoyen de les convaincre. En quoi ils me semblent pareils à unaveugle qui, pour se battre sans désavantage contre un qui voit,l’aurait fait venir dans le fond de quelque cave fort obscure; etje puis dire que ceux-ci ont intérêt que je m’abstienne de publierles principes de la philosophie dont je me sers: car étant trèssimples et très évidents, comme ils sont, je ferais quasi le même,en les publiant, que si j’ouvrais quelques fenêtres, et faisaisentrer du jour dans cette cave, où ils sont descendus pour sebattre. Mais même les meilleurs esprits n’ont pas occasion desouhaiter de les connaître : car, s’ils veulent savoir parler detoutes choses et acquérir la réputation d’être doctes, ils yparviendront plus aisément en se contentant de la vraisemblance,qui peut être trouvée sans grande peine en toutes sortes dematières, qu’en cherchant la vérité, qui ne se découvre que peu àpeu en quelques-unes, et qui, lorsqu’il est question de parler desautres, oblige à confesser franchement qu’on les ignore. Que s’ilspréfèrent la connaissance de quelque peu de vérités à la vanité deparaître n’ignorer rien, comme sans doute elle est bien préférable,et qu’ils veuillent suivre un dessein semblable au mien, ils n’ontpas besoin, pour cela, que je leur dise rien davantage que ce quej’ai dit en ce discours. Car, s’ils sont capables de passer plusoutre que je n’ai fait, ils le seront aussi, à plus forte raison,de trouver d’eux-mêmes tout ce que je pense avoir trouvé. D’autantque, n’ayant jamais rien examiné que par ordre, il est certain quece qui me reste encore à découvrir, est de soi plus difficile etplus caché que ce que j’ai pu ci-devant rencontrer, et ils auraientbien moins de plaisir à l’apprendre de moi que d’eux-mêmes; outreque l’habitude qu’ils acquerront, en cherchant premièrement deschoses faciles, et passant peu à peu par degrés à d’autres plusdifficiles, leur servira plus que toutes mes instructions nesauraient faire. Comme, pour moi, je me persuade que, si on m’eûtenseigné, dès ma jeunesse, toutes les vérités dont j’ai cherchédepuis les démonstrations, et que je n’eusse eu aucune peine à lesapprendre, je n’en aurais peut-être jamais su aucunes autres, et dumoins que jamais je n’aurais acquis l’habitude et la facilité, queje pense avoir, d’en trouver toujours de nouvelles, à mesure que jem’applique à les chercher. Et en un mot, s’il y a au monde quelqueouvrage qui ne puisse être si bien achevé par aucun autre que parle même qui l’a commencé, c’est celui auquel je travaille.
Il est vrai que, pour ce qui est des expériences qui peuvent yservir, un homme seul ne saurait suffire à les faire toutes; maisil n’y saurait aussi employer utilement d’autres mains que lessiennes, sinon celles des artisans, ou telles gens qu’il pourraitpayer, et à qui l’espérance du gain, qui est un moyen trèsefficace, ferait faire exactement toutes les choses qu’il leurprescrirait. Car, pour les volontaires, qui, par curiosité ou désird’apprendre, s’offriraient peut-être de lui aider, outre qu’ils ontpour l’ordinaire plus de promesses que d’effet, et qu’ils ne fontque de belles propositions dont aucune jamais ne réussit, ilsvoudraient infailliblement être payés par l’explication de quelquesdifficultés, ou du moins par des compliments et des entretiensinutiles, qui ne lui sauraient coûter si peu de son temps qu’il n’yperdît. Et pour les expériences que les autres ont déjà faites,quand bien même ils les lui voudraient communiquer, ce que ceux quiles nomment des secrets ne feraient jamais, elles sont, pour laplupart, composées de tant de circonstances, ou d’ingrédientssuperflus, qu’il lui serait très malaisé d’en déchiffrer la vérité;outre qu’il les trouverait presque toutes si mai expliquées, oumême si fausses, à cause que ceux qui les ont faites se sontefforcés de les faire paraître conformes à leurs principes, que,S’il y en avait quelques-unes qui lui servissent, elles nepourraient derechef valoir le temps qu’il lui faudrait employer àles choisir. De façon que, s’il y avait au monde quelqu’un, qu’onsût assurément être capable de trouver les plus grandes choses etles plus utiles au public qui puissent être, et que, pour cettecause, les autres hommes s’efforçassent, par tous moyens, del’aider à venir à bout de ses desseins, je ne vois pas qu’ilspussent autre chose pour lui, sinon fournir aux frais desexpériences dont il aurait besoin et, du reste, empêcher que sonloisir ne lui fût ôté par l’importunité de personne. Mais, outreque je ne présume pas tant de moi-même, que de vouloir rienpromettre d’extraordinaire, ni ne me repais point de pensées sivaines, que de m’imaginer que le public se doive beaucoupintéresser en mes desseins, je n’ai pas aussi l’âme si basse, queje voulusse accepter de qui que ce fût aucune faveur, qu’on pûtcroire que je n’aurais pas méritée.
Toutes ces considérations jointes ensemble furent cause, il y atrois ans, que je ne voulus point divulguer le traité que j’avaisentre les mains, et même que je fus en résolution de n’en fairevoir aucun autre, pendant ma vie, qui fût si général, ni duquel onpût entendre les fondements de ma Physique. Mais il y a eu depuisderechef deux autres raisons, qui m’ont obligé à mettre iciquelques essais particuliers, et à rendre au public quelque comptede mes actions et de mes desseins. La première est que, si j’ymanquais, plusieurs, qui ont su l’intention que j’avais eueci-devant de faire imprimer quelques écrits, pourraient s’imaginerque les causes pour lesquelles je m’en abstiens seraient plus à mondésavantage qu’elles ne sont. Car, bien que je n’aime pas la gloirepar excès, ou même, si je l’ose dire, que je la haïsse, en tant queje la juge contraire au repos, lequel j’estime sur toutes choses,toutefois aussi je n’ai jamais tâché de cacher mes actions commedes crimes, ni n’ai usé de beaucoup de précautions pour êtreinconnu; tant à cause que j’eusse cru me faire tort, qu’à cause quecela m’aurait donne quelque espèce d’inquiétude, qui eût derechefété contraire au parfait repos d’esprit que je cherche. Et parceque, m’étant toujours ainsi tenu indifférent entre le soin d’êtreconnu ou ne l’être pas, je n’ai pu empêcher que je n’acquissequelque sorte de réputation, j’ai pensé que je devais faire monmieux pour m’exempter au moins de l’avoir mauvaise. L’autre raison,qui m’a obligé à écrire ceci, est que, voyant tous les jours deplus en plus le retardement que souffre le dessein que j’ai dem’instruire, à cause d’une infinité d’expériences dont j’ai besoin,et qu’il est impossible que je fasse sans l’aide d’autrui, bien queje ne me flatte pas tant que d’espérer que le public prenne grandepart en mes intérêts, toutefois je ne veux pas aussi me défaillirtant à moi-même, que de donner sujet a ceux qui me survivront de mereprocher quelque jour, que j’eusse pu leur laisser plusieurschoses beaucoup meilleures que je n’aurai fait, si je n’eusse pointtrop négligé de leur faire entendre en quoi ils pouvaientcontribuer à mes desseins.
Et j’ai pensé qu’il m’était aisé de choisir quelques matièresqui, sans être sujettes à beaucoup de controverses, ni m’obliger àdéclarer davantage de mes principes que je ne désire, nelaisseraient Pas de faire voir assez clairement ce que je puis, oune puis pas, dans les sciences. En quoi je ne saurais dire si j’airéussi, et je ne veux point prévenir les jugements de personne, enparlant moi-même de mes écrits; mais je serai bien aise qu’on lesexamine, et afin qu’on en ait d’autant plus d’occasion, je supplietous ceux qui auront quelques objections à y faire de prendre lapeine de les envoyer à mon libraire, par lequel en étant averti, jetâcherai d’y joindre ma réponse en même temps ; et par cemoyen les lecteurs, voyant ensemble l’un et l’autre, jugerontd’autant plus aisément de la vérité. Car je ne promets pas d’yfaire jamais de longues réponses, mais seulement d’avouer mesfautes fort franchement, si je les connais, ou bien, si je ne lespuis apercevoir, de dire simplement ce que je croirai être requispour la défense des choses que j’ai écrites, sans y ajouterl’explication d’aucune nouvelle matière afin de ne me pas engagersans fin de l’une en l’autre.
Que si quelques-unes de celles dont j’ai parlé, au commencementde la Dioptrique et des Météores, choquent d’abord, à cause que jeles nomme des suppositions, et que je ne semble pas avoir envie deles prouver, qu’on ait la patience de lire le tout avec attention,et j’espère qu’on s’en trouvera satisfait. Car il me semble que lesraisons s’y entre-suivent en telle sorte que, comme les dernièressont démontrées par les premières, qui sont leurs causes, cespremières le sont réciproquement par les dernières, qui sont leurseffets. Et on ne doit pas imaginer que je commette en ceci la fauteque les logiciens nomment un cercle; car l’expérience rendant laplupart de ces effets très certains, les causes dont je les déduisne servent pas tant à les prouver qu’à les expliquer; mais, tout aucontraire, ce sont elles qui sont prouvées par eux. Et je ne les ainommées des suppositions, qu’afin qu’on sache que je pense lespouvoir déduire de ces premières vérités que j’ai ci-dessusexpliquées, mais que j’ai voulu expressément ne le pas faire, pourempêcher que certains esprits, qui s’imaginent qu’ils savent en unjour tout ce qu’un autre a pensé en vingt années, sitôt qu’il leuren a seulement dit deux ou trois mots, et qui sont d’autant plussujets à faillir, et moins capables de la vérité, qu’ils sont pluspénétrants et plus vifs, ne puissent de là prendre occasion debâtir quelque philosophie extravagante sur ce qu’ils croiront êtremes principes, et qu’on m’en attribue la faute. Car, pour lesopinions, qui sont toutes miennes, je ne les excuse point commenouvelles, d’autant que, si on en considère bien les raisons, jem’assure qu’on les trouvera si simples et si conformes au senscommun, qu’elles sembleront moins extraordinaires, et moinsétranges, qu’aucunes autres qu’on puisse avoir sur mêmes sujets. Etje ne me vante point d’être le premier inventeur d’aucunes, maisbien, que je ne les ai jamais reçues, ni parce Welles avaient étédites par d’autres, ni parce qu’elles ne l’avaient point été, maisseulement parce que la raison me les a persuadées.
Que si les artisans ne peuvent si tôt exécuter l’invention quiest expliquée en la Dioptrique, je ne crois pas qu’on puisse dire,pour cela, qu’elle soit mauvaise : car, d’autant qu’il faut del’adresse et de l’habitude, pour faire et pour ajuster les machinesque j’ai décrites, sans qu’il y manque aucune circonstance, je nem’étonnerais pas moins, s’ils rencontraient du premier coup, que siquelqu’un pouvait apprendre, en un jour, à jouer du luthexcellemment, par cela seul qu’on lui aurait donné de la tablaturequi serait bonne. Et si j’écris en français, qui est la langue demon pays, plutôt qu’en latin, qui est celle de mes précepteurs,c’est à cause que j’espère que ceux qui ne se servent que de leurraison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceuxqui ne croient qu’aux livres anciens. Et pour ceux qui joignent lebon sens avec l’étude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges,ils ne seront point, je m’assure, si partiaux pour le latin, qu’ilsrefusent d’entendre mes raisons, parce que je les explique enlangue vulgaire.
Au reste, je ne veux point parler ici, en particulier, desprogrès que j’ai espérance de faire à l’avenir dans les sciences,ni m’engager envers le public d’aucune promesse que je ne sois pasassuré d’accomplir; mais je dirai seulement que j’ai résolu den’employer le temps qui me reste à vivre à autre chose qu’à tâcherd’acquérir quelque connaissance de la Nature, qui soit telle qu’onen puisse tirer des règles pour la médecine, plus assurées quecelles qu’on a eues jusques à présent, et que mon inclinationm’éloigne si fort de toute sorte d’autres desseins, principalementde ceux qui ne sauraient être utiles aux uns qu’en nuisant auxautres, que, si quelques occasions me contraignaient de m’yemployer, je ne crois point que je fusse capable d’y réussir. Dequoi je fais ici une déclaration, que je sais bien ne pouvoirservir à me rendre considérable dans le monde, mais aussi n’ai-jeaucunement envie de l’être; et je me tiendrai toujours plus obligéà ceux par la faveur desquels je jouirai sans empêchement de monloisir, que je ne ferais à ceux qui m’offriraient les plushonorables emplois de la terre.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 15 Juillet 2015 à 11:01
Du contrat social ou Principes du droit politique
de Jean-Jacques RousseauAvertissement Ce petit traité est extrait d’un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu’on pouvait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable, et m’a paru le moins indigne d’être offert au public. Le reste n’est déjà plus. Partie 1 Je veux chercher si, dans l’ordre civil, il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles peuvent être. Je tâcherai d’allier toujours, dans cette recherche, ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées. J’entre en matière sans prouver l’importance de mon sujet. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c’est pour cela que j’écris sur la politique. Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais. Né citoyen d’un État libre, et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d’y voter suffit pour m’imposer le devoir de m’en instruire : heureux, toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d’aimer celui de mon pays ! Chapitre 1 Sujet de ce premier livre L’homme est né libre, et partout il est dans les fers, Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore.Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considérais que la force et l’effet qui en dérive, je dirais : « Tant qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug,et qu’il le secoue, il fait encore mieux : car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l’était point à la lui ôter ». Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d’en venir là, je dois établir ce que je viens d’avancer.
Chapitre 2 Des premières sociétés
La plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule naturelle,est celle de la famille : encore les enfants ne restent-ils liés au père qu’aussi longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout.Les enfants, exempts de l’obéissance qu’ils devaient au père ;le père, exempt des soins qu’il devait aux enfants, rentrent tous également dans l’indépendance. S’ils continuent de rester unis, ce n’est plus naturellement, c’est volontairement ; et la famille elle-même ne se maintient que par convention. Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation,ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à lui-même ; et sitôt qu’il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là son propre maître. La famille est donc, si l’on veut, le premier modèle des sociétés politiques : le chef est l’image du père, le peuple est l’image des enfants ; et tous, étant nés égaux et libres,n’aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que, dans la famille, l’amour du père pour ses enfants le paye des soins qu’il leur rend ; et que, dans l’État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n’a pas pour ses peuples. Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés : il cite l’esclavage en exemple. Sa plus constante manière de raisonner est d’établir toujours le droit par le fait (a). On pourrait employer une méthode plus conséquente,mais non plus favorable aux tyrans. Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain appartient à une centaine d’hommes, ou si cette centaine d’hommes appartient au genre humain : et il paraît, dans tout son livre, pencher pour le premier avis : c’est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi voilà l’espèce humaine divisée en troupeaux de bétail, dont chacun a son chef, qui le garde pour le dévorer. Comme un pâtre est d’une nature supérieure à celle de son troupeau, les pasteurs d’hommes, qui sont leurs chefs, sont aussi d’une nature supérieure à celle de leurs peuples. Ainsi raisonnait,au rapport de Philon, l’empereur Caligula, concluant assez bien de cette analogie que les rois étaient des dieux, ou que les peuples étaient des bêtes. Le raisonnement de ce Caligula revient à celui de Hobbes et de Grotius. Aristote, avant eux tous, avait dit aussi que les hommes ne sont point naturellement égaux, mais que les uns naissent pour l’esclavage et les autres pour la domination. Aristote avait raison ; mais il prenait l’effet pour la cause. Tout homme né dans l’esclavage naît pour l’esclavage, rien n’est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers,jusqu’au désir d’en sortir ; ils aiment leur servitude comme les compagnons d’Ulysse aimaient leur abrutissement (b). S’il y adonc, des esclaves par nature, c’est parce qu’il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. Je n’ai rien dit du roi Adam, ni de, l’empereur Noé, père de trois grands monarques qui se partagèrent l’univers, comme firent les enfants de Saturne, qu’on a cru reconnaître en eux. J’espère qu’on me saura gré de cette modération ; car, descendant directement de l’un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que sais-je si, par la vérification des titres, je ne me trouverais point le légitime roi du genre humain ? Quoi qu’il en soit, on ne peut disconvenir qu’Adam. n’ait été souverain du monde, comme Robinson de son île, tant qu’il en fut le seul habitant, et ce qu’il y avait de commode dans cet empire était que le monarque, assuré sur son trône, n’avait à craindre ni rébellion,ni guerres, ni conspirateurs.Chapitre 3 Du droit du plus fort
Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu’il n’en résulte qu’un galimatias inexplicable ; car, sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause : toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu’on peut désobéir impunément, on le peut légitimement ; et, puisque le plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le plus fort. Or, qu’est-ce qu’un droit qui périt quand la force cesse ? S’il faut obéir par force, on n’a pas besoin d’obéir par devoir ; et si l’on n’est plus forcé d’obéir, on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout. Obéissez aux puissances. Si cela veut dire : Cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu ; je réponds qu’il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l’avoue ; mais toute maladie en vient aussi : est-ce à dire qu’il soit défendu d’appeler le médecin ? Qu’un brigand me surprenne au coin d’un bois, non seulement il faut par force donner sa bourse ; mais, quand je pourrais la soustraire,suis-je en conscience obligé de la donner ? Car, enfin, le pistolet qu’il tient est une puissance. Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes. Ainsi ma question primitive revient toujours.Chapitre 4 De l’esclavage
Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Si un particulier, dit Grotius, peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d’un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait -il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d’un roi ? Il y a là bien des mots équivoques qui auraient besoin d’explication ;mais tenons-nous-en à celui d’aliéner. Aliéner, c’est donner ou vendre. Or, un homme qui se fait esclave d’un autre ne se donne pas ; il se vend tout au moins pour sa subsistance : mais un peuple, pourquoi se vend-il ? Bien loin qu’un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d’eux ; et, selon Rabelais, un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne, à condition qu’on prendra aussi leur bien ? Je ne vois pas ce qu’il leur reste à conserver. On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile ; soit : mais qu’y gagnent-ils, si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne feraient leurs dissensions ? Qu’y gagnent-ils, si cette tranquillité même est une de leurs misères ? On vit tranquille aussi dans les cachots : en est-ce assez pour s’y trouver bien ? Les Grecs enfermés dans l’antre du Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que leur tour vînt d’être dévorés. Dire qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable ; un tel acte est illégitime et nul,par cela seul que celui qui le fait n’est pas dans son bon sens.Dire la même chose de tout un peuple, c’est supposer un peuple de fous ; la folie ne fait pas droit. Quand chacun pourrait s’aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants ; ils naissent hommes et libres ; leur liberté leur appartient, nul n’a droit d’en disposer qu’eux. Avant qu’ils soient en âge de raison, le père peut, en leur nom, stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être, mais non les donner irrévocablement et sans condition ; car un tel don est contraire aux fins de la nature, et passe les droits de la paternité. Il faudrait donc, pour qu’un gouvernement arbitraire fût légitime, qu’à chaque génération le peuple fût le maître de l’admettre ou de le rejeter : mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire. Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. Enfin c’est une convention vaine et contradictoire de stipuler d’une part une autorité absolue, et de l’autre une obéissance sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger ? Et cette seule condition, sans équivalent, sans échange, n’entraîne-t-elle pas la nullité de l’acte ? Car, quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appartient et que,son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n’a aucun sens ? Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit d’esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens de sa liberté ; convention d’autant plus légitime qu’elle tourne au profit de tous deux. Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l’état de guerre. Par cela seul, que les hommes, vivant dans leur primitive indépendance, n’ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l’état de paix ni l’état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis.C’est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre ; et l’état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée ou d’homme à homme ne peut exister ni dans l’état de nature, où il n’y a point de propriété constante, ni dans l’état social, où tout est sous l’autorité des lois. Les combats particuliers, les duels, les rencontres, sont des actes qui ne constituent point un état ; et à l’égard des guerres privées, autorisées par les Établissements de Louis IX, roide France, et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde, s’il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel et à toute bonne politise. La guerre n’est donc point une relation d’homme à homme, mais une relation d’État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens (a), mais comme soldats ; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque État ne peut avoir pour ennemis que d’autres États, et non pas des hommes,attendu qu’entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport. Ce principe est même conforme aux maximes établies de tous les temps et à la pratique constante de tous les peuples policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu’à leurs sujets. L’étranger, soit roi, soit particulier, soit peuple, qui vole, tue, ou détient les sujets, sans déclarer la guerre au prince, n’est pas un ennemi, c’est un brigand. Même en pleine guerre, un prince juste s’empare bien, en pays ennemi, de tout ce qui appartient au public ; mais il respecte la personne et les biens des particuliers ; il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l’État ennemi, on a droit d’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se rendent, cessant d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et l’on n’a plus de droit sur leur vie. Quelquefois, on peut tuer l’État sans tuer un seul de ses membres : or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius ; ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes ; mais ils dérivent de la nature des choses, et sont fondés sur la raison. A l’égard du droit de conquête, il n’a d’autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu’il n’a pas ne peut fonder celui de les asservir. On n’a le droit de tuer l’ennemi que quand on ne peut le faire esclave ; le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer : c’est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie,sur laquelle on n’a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le droit d’esclavage, et le droit d’esclavage sur le droit de vie et de mort, n’est-il pas clair qu’on tombe dans le cercle vicieux ? En supposant même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu’un esclave fait à la guerre, ou un peuple conquis, n’est tenu à rien du tout envers son maître, qu’à lui obéir autant qu’il y est forcé.En prenant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a point fait grâce : au lieu de le tuer sans fruit, il l’a tué utilement. Loin donc qu’il ait acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l’état de guerre subsiste entre eux comme auparavant,leur relation même en est l’effet ; et l’usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait une convention ; soit : mais cette convention, loin de détruire l’état de guerre, en suppose la continuité. Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit d’esclavage est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclave et droit, sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement.Soit d’un homme à un homme, soit d’un homme à un peuple, ce discours sera toujours également insensé : « Je fais avec toi une convention toute à ta charge et toute à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu observeras tant qu’il me plaira. »Chapitre 5 Qu’il faut toujours remonter à une première convention
Quand j’accorderais tout ce que j’ai réfuté jusqu’ici, les fauteurs du despotisme n’en seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu’ils puissent être, je ne vois là qu’un maître et des esclaves, je n’y vois point un peuple et son chef : c’est, si l’on veut, une agrégation, mais non pas une association ; il n’y a là ni bien public, ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n’est toujours qu’un particulier ; son intérêt, séparé de celui des autres, n’est toujours qu’un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, -son empire, après lui, reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres, après que le feu l’a consumé. Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un roi. Selon Grotius,un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil ; il suppose une délibération publique.Avant donc que d’examiner l’acte par lequel un peuple élit un roi,il serait bon d’examiner l’acte par lequel un peuple est un peuple ; car cet acte, étant nécessairement antérieur à l’autre, est le vrai fondement de la société. En effet, s’il n’y avait point de convention antérieure, où serait, à moins que l’élection ne fût unanime, l’obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand ? et d’où cent qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour dix qui n’en veulent point ? La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un, établissement de convention et suppose, au moins une fois, l’unanimité.Chapitre 6 Du pacte social
Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de nature l’emportent, parleur résistance, sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister ; et le genre humain périrait s’il ne changeait de manière d’être. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces,mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen, pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs ; mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu’il se doit ? Cette difficulté, ramenée à mon sujet, peut s’énoncer en ces termes : « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé,et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant. » Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l’acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu’à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits, et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. Ces clauses, bien entendues, se réduisent toutes à une seule -savoir, l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous ; et la condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l’aliénation se faisant sans réserve, l’union est aussi parfaite qu’elle peut l’être, et nul associé n’a plus rien à réclamer : car, s’il restait quelques droits aux particuliers,comme il n’y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun, étant en quelque point son propre juge,prétendrait bientôt l’être en tous ; l’état de nature subsisterait, et l’association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne ; et comme il n’y a pas un associé sur lequel on n’acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force pour conserver ce qu’on a. Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il se réduit aux termes suivants :« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ;et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. » A l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix,lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité (a), et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l’égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple,et s’appellent en particulier citoyens, comme participant à l’autorité souveraine, et sujets, comme soumis aux lois de l’État.Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision.Chapitre 7 Du souverain
On voit, par cette formule, que l’acte d’association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport : savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l’État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même ;car il y a bien de la différence entre s’obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie. Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d’eux est envisagé, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-même et que, par conséquent, il est contre la nature du corps politique que le souverain s’impose une Ici qu’il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport, il est alors dans le cas d’un particulier contractant avec soi-même ;par où l’on voit qu’il n’y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s’engager envers autrui, en ce qui ne déroge point à ce contrat ; car, à l’égard de l’étranger, il devient un être simple, un individu. Mais le corps politique ou le souverain, ne tirant son être que de la sainteté du contrat, ne peut jamais s’obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d’aliéner quelque portion de lui-même, ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l’acte par lequel il existe, serait s’anéantir ; et qui n’est rien ne produit rien. Sitôt que cette multitude est ainsi réunie en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps, encore moins offenser le corps sans que les membres s’en ressentent. Ainsi le devoir et l’intérêt obligent également les deux parties contractantes à s’entraider mutuellement ; et les mêmes hommes doivent chercher à réunir, sous ce double rapport, tous les avantages qui en dépendent. Or, le souverain, n’étant formé que des particuliers qui le composent, n’a ni ne peut avoir d’intérêt contraire au leur ;par conséquent, la puissance souveraine n’a nul besoin de les sujets, parce qu’il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres ; et nous verrons ci-après qu’il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être. Mais il n’en est pas ainsi des sujets envers le souverain,auquel, malgré l’intérêt commun, rien ne répondrait de leurs engagements, s’il ne trouvait des moyens de s’assurer de leur.fidélité. En effet, chaque individu peut, comme homme, avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu’il a comme citoyen ; son intérêt particulier peut lui parler tout autrement que l’intérêt commun ; son existence absolue, et naturellement indépendante, peut lui faire envisager ce qu’il doit à la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le payement ne sera onéreux pour lui ; et regardant la personne morale qui constitue l’État comme un être de raison, parce que ce n’est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet ; injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique. Afin donc que ce pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement, qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps ; ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera à être libre, car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle, condition qui fait l’artifice et le Jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes les engagements civils, lesquels, sans cela, seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.Chapitre 8 De l’état civil
Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que,la voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, et de consulter sa raison amant d’écoute, ses penchants. Quoiqu’il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu’il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses. idées s’étendent, ses sentiments s’ennoblissent, son âme tout entière s’élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais et qui, d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer ; ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale ; et la possession, qui n’est que l’effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété, qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale qui seule rend l’homme vraiment maître de lui ; car l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté. Mais je n’en ai déjà que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n’est pas ici de mon sujet.Chapitre 9 Du domaine réel
Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu’elle se forme, tel qu’il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu’il possède font partie. Ce n’est pas que,par cet acte, la possession change de nature en changeant de mains,et devienne propriété dans celles du souverain ; mais comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que celles d’un particulier, la possession publique est aussi, dans le fait,plus forte et plus irrévocable, sans être plus légitime, au moins pour les étrangers : car l’État, à l’égard de ses membres, est maître de tous leurs biens, par le contrat social, qui, dans l’État, sert de base à tous les droits, mais il ne l’est, à l’égard des autres puissances, que par le droit de premier occupant, qu’il tient des particuliers. Le droit de premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu’après l’établissement de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire ; mais l’acte positif qui le rend propriétaire de quelque bien l’exclut de tout le reste. Sa par tétant faite, il doit s’y borner, et n’a plus aucun droit à la communauté. Voilà pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l’état de nature, est respectable à tout homme civil. On respecte moins dans ce droit ce qui est à autrui que ce qui n’est pas à soi. En général, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes :premièrement, que ce terrain ne soit encore habité par personne,secondement, qu’on n’en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister ; en troisième lieu, qu’on en prenne possession, non par une vainc cérémonie, mais par le travail et la culture, seul signe de propriété qui, à défaut de titres juridiques, doive être respecté d’autrui. En effet accorder au besoin et au travail le droit de premier occupant, n’est-ce pas l’étendre aussi loin qu’il peut aller ?Peut-on ne pas donner des bornes à ce droit ? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s’en prétendre aussitôt le maître ? Suffira-t-il d’avoir la force d’en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le droit d’y jamais revenir ? Comment un homme ou un peuple peut-il s’emparer d’un territoire immense et en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu’elle ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun ?Quand Nuñez Balbao prenait, sur le rivage, possession de la mer du Sud et de toute l’Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille. était-ce assez pour en déposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde ? Sur ce pied-là, ces cérémonies se multipliaient assez vainement ; et le roi catholique n’avait tout d’un coup qu’à prendre possession de tout l’univers, sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes. On conçoit comment les terres des particuliers réunies et contiguës deviennent le territoire public, et comment le droit de souveraineté, s’étendant des sujets au terrain qu’ils occupent,devient à la fois réel et personnel ; ce qui met les possesseurs dans une plus grande dépendance, et fait de leurs forces mêmes les garants de leur fidélité ; avantage qui ne paraît pas avoir été bien senti des anciens monarques, qui, ne s’appelant que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens,semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme les maîtres du pays. Ceux d’aujourd’hui s’appellent plus habilement rois de France, d’Espagne, d’Angleterre, etc. ; en tenant ainsi le terrain, ils sont bien sûrs d’en tenir les habitants. Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que, loin qu’en acceptant les biens des particuliers, la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession,changer l’usurpation en un véritable droit et la jouissance en propriété. Alors, les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien publie, leurs droits étant respectés de tous les membres de l’État et maintenus de toutes ses forces contre l’étranger, par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes, ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu’ils ont donné : paradoxe qui s’explique aisément par la distinction des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le même fonds, comme on verra ci-après. Il peut arriver aussi que les hommes commencent à s’unir avant que de rien posséder, et que, s’emparant ensuite d’un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu’ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous ; sans quoi il n’y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l’exercice de la souveraineté. Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout système social ; c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue, au contraire, une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit.Partie 2
Chapitre 1 Que la souveraineté est inaliénable
La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis, est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun ; car, si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social ;et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne saurait exister. Or, c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. Je dis donc que la souveraineté, n’étant que l’exercice de la volonté générale, ne peut jamais s’aliéner, et que le souverain,qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même ; le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. En effet, s’il n’est pas impossible qu’une volonté particulière s’accorde sur quelque point avec la volonté générale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant ;car la volonté particulière tend, par sa nature, aux préférences,et la volonté générale à l’égalité. Il est plus impossible encore qu’on ait un garant de cet accord, quand même il devrait toujours exister ; ce ne serait pas un effet de l’art, mais du hasard.Le souverain peut bien dire : « Je veux actuellement ce que veut un tel homme, ou du moins ce qu’il dit vouloir » ; mais il ne peut pas dire : « Ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore », puisqu’il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l’avenir, et puisqu’il ne dépend d’aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l’être qui veut. Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l’instant qu’il y a un maître, il n’y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit. Ce n’est point à dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales, tant que le souverain, libre de s’y opposer, ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel on doit présumer le consentement du peuple. Ceci s’expliquera plus au long.Chapitre 2 Que la souveraineté est indivisible
Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible ; car la volonté est générale (a), ou elle ne l’est pas ; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie. Dans le premier cas, cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi ; dans le second, ce n’est qu’une volonté particulière, ou un acte de magistrature ;c’est un décret tout au plus. Mais nos politiques Il ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet : ils la divisent en for-ce et en volonté, en puissance législative et en puissance,exécutive ; en droits d’impôt, de justice et de guerre ;en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l’étranger : tantôt ils confondent toutes ces parties, et tantôt ils les séparent. Ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées ; c’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs corps, dont l’un aurait des yeux, l’autre des bras, l’autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon dépècent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs ; puis,jetant en l’air tous ses membres l’un après l’autre, ils font retomber l’enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à peu près les tours de gobelets de nos politiques ; après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment. Cette erreur vient de ne s’être pas fait des notions exactes de l’autorité souveraine, et d’avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui n’en était que des émanations. Ainsi, par exemple,on a regardé l’acte de déclarer la guerre et celui de faire la paix comme des actes de souveraineté ; ce qui n’est pas puisque chacun de ces actes n’est point une loi, mais seulement une application de la loi, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l’idée attachée au mot loi sera fixée. En suivant de même les autres divisions, on trouverait que,toutes les fois qu’on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe ; que les droits qu’on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l’exécution. On ne saurait dire combien ce défaut d’exactitude a jeté d’obscurité sur les décisions des auteurs en matière de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois et des peuples sur les principes qu’ils avaient établis. Chacun peut voir, dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius, comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s’enchevêtrent, s’embarrassent dans leurs sophismes, crainte d’en dire trop ou de n’en dire pas assez selon leurs vues, et de choquer les intérêts qu’ils avaient à concilier. Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n’épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l’art possible. C’eût bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d’Angleterre Georges 1er. Mais,malheureusement, l’expulsion de Jacques II, qu’il appelle abdication, le forçait à se tenir sur la réserve, à gauchir, à tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes, toutes les difficultés étaient levées, et ils eussent été toujours conséquents ; mais ils auraient tristement dit la vérité, et n’auraient fait leur cour qu’au peuple. Or, la vérité ne mène point à la fortune, et le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions.Chapitre 3 Si la volonté générale peut errer
Il s’ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique : mais il ne s’ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours : jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c’est alors seulement qu’il paraît vouloir ce qui est mal. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun ; l’autre regarde à l’intérêt privé, et n’est qu’une somme de volontés particulières : mais ôtez de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s’entre-détruisent (a), reste pour somme des différences la volonté générale. Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n’avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l’État : on peut dire alors qu’il n’y a plus autant de votants que d’hommes, mais seulement autant que d’associations. Les différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat moins général. Enfin quand une de ces associations est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique ; alors il n’y a plus de volonté générale, et l’avis qui l’emporte n’est qu’un avis particulier. Il importe donc, pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale, qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’État, et que chaque citoyen n’opine que d’après lui (a) ; telle fut l’unique et sublime institution du grand Lycurgue. Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l’inégalité, comme firent Solon, Numa, Servius. Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée, et que le peuple ne se trompe point.Chapitre 4 Des bornes du pouvoir souverain
Si l’État ou la cité n’est qu’une personne morale dont la vie consiste dans l’union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens ; et c’est ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, comme j’ai dit, le nom de souveraineté. Mais, outre la personne publique, nous avons à considérer les personnes privées qui la composent, et dont la vie et la liberté sont naturellement indépendantes d’elle. Il s’agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain (b),et les devoirs qu’ont à remplir les premiers en qualité de sujets,du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d’hommes. On convient que tout ce que chacun aliène, par le pacte social,de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c’est seulement la partie de tout cela dont l’usage importe à la communauté ;mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance. Tous les services qu’un citoyen peut rendre à l’État, il les lui doit sitôt que le souverain les demande ; mais le souverain,de son côté, ne peut charger les sujets d’aucune chaîne inutile à la communauté : il ne peut pas même le vouloir ; car,sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels ; et leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’approprie ce mot, chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? Ce qui prouve que l’égalité de droit et la notion de justice qu’elle produit dérivent de la préférence que chacun se donne, et par conséquent de la nature de l’homme ;que la volonté générale, pour être vraiment telle, doit l’être dans son objet ainsi que dans son essence ; qu’elle doit partir de tous pour s’appliquer à tous ; et qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend à quelque objet individuel et déterminé,parce qu’alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n’avons aucun vrai principe d’équité qui nous guide. En effet, sitôt qu’il s’agit d’un fait ou d’un droit particulier sur un point qui n’a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l’affaire devient contentieuse : c’est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties, et le publie l’autre, mais où je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de vouloir alors s’en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l’une des parties, et qui par conséquent n’est pour l’autre qu’une volonté étrangère,particulière, portée en cette occasion à l’injustice et sujette à l’erreur. Ainsi, de même qu’une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale à son tour change de nature, ayant un objet particulier, et ne peut, comme générale, prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d’Athènes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs à l’un, imposait des peines à l’autre, et, par des multitudes de décrets particuliers, exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n’avait plus de volonté générale proprement dite ; il n’agissait plus comme souverain,mais comme magistrat. Ceci paraîtra contraire aux idées communes ; mais il faut me laisser le temps d’exposer les miennes. On doit concevoir par là que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l’intérêt commun qui les unit ;car, dans cette institution, chacun se soumet nécessairement aux conditions qu’il impose aux autres ; accord admirable de l’intérêt et de la justice, qui donne aux délibérations communes un caractère d’équité qu’on voit s’évanouir dans la discussion de toute affaire particulière, faute d’un intérêt commun qui unisse et identifie la règle du juge avec celle de la partie. Par quelque côté qu’on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion ; savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité, qu’ils s’engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, parla nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens ; en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation, et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté ? Ce n’est pas une convention du supérieur avec l’inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres ; convention légitime, parce qu’elle a pour base le contrat social ; équitable, parce qu’elle est commune à tous ; utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien général ; et solide, parce qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu’à de telles conventions, ils n’obéissent’ à personne, mais seulement à leur propre volonté : et demander jusqu’où s’étendent les droits respectifs du souverain et des citoyens,c’est demander jusqu’à quel point ceux-ci peuvent s’engager avec eux-mêmes, chacun envers tous, et tous envers chacun d’eux. On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions ; de sorte que le souverain n’est jamais en droit de charger un sujet plus qu’un autre, parce qu’alors,l’affaire devenant particulière, son pouvoir n’est plus compétent. Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l’effet de ce contrat, se trouve réellement préférable à ce qu’elle était auparavant, et qu’au lieu d’une aliénation ils n’ont fait qu’un échange avantageux d’une manière d’être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre, de l’indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de leur force, que d’autres pouvaient surmonter, contre un droit que l’union sociale rend invincible.Leur vie même, qu’ils ont dévouée à l’État, en est continuellement protégée ; et lorsqu’ils l’exposent pour sa défense, que font-ils alors que lui rendre ce qu’ils ont reçu de lui ? Que font-ils qu’ils ne fissent plus fréquemment et avec plus de danger dans l’état de nature, lorsque, livrant des combats inévitables,ils défendraient au péril de leur vie ce qui leur sert à la conserver ? Tous ont à combattre, au besoin, pour la patrie,il est vrai ; mais aussi nul n’a jamais à combattre pour soi.Ne gagne-t-on pas encore à courir, pour ce qui fait notre sûreté,une partie des risques qu’il faudrait courir pour nous-mêmes sitôt qu’elle nous serait ôtée ?Chapitre 5 Du droit de vie et de mort
On demande comment les particuliers, n’ayant point droit de disposer de leur propre vie, peuvent transmettre au souverain ce même droit qu’ils n’ont pas. Cette question ne paraît difficile à résoudre que parce qu’elle est mal posée. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie soit coupable de suicide ? A-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s’embarquant il n’ignorait pas le danger ? Le traité social a pour fin la conservation des contractants.Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen n’est plus juge du péril auquel la loi veut qu’il s’expose ; et quand le prince lui adit : « Il est expédient à l’État que tu meures »,il doit mourir, puisque ce n’est qu’à cette condition qu’il a vécu en sûreté jusqu’alors, et que sa vie n’est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’État. La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue- c’est pour n’être pas la victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient.Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu’à la garantir, et il n’est pas à présumer qu’aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre. D’ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie ; il cesse d’en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne ; il faut qu’un des deux périsse ; et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le traité social, et par conséquent qu’il n’est plus membre de l’État. Or, comme il s’est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l’exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public ; car un tel ennemi n’est pas une personne morale, c’est un homme ;et c’est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu. Mais, dira-t-on, la condamnation d’un criminel est un acte particulier. D’accord : aussi cette condamnation n’appartient-elle point au souverain ; c’est un droit qu’il peut conférer sans pouvoir l’exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les exposer toutes à la fois. Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n’y a point de méchant qu’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger. À l’égard du droit de faire grâce ou d’exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n’appartient qu’à celui qui est au-dessus du juge et de la loi,c’est-à-dire au souverain ; encore son droit en ceci n’est-il pas bien net, et les cas d’en user sont-ils très rares. Dans un État bien gouverné, il y a peu de punitions, non parce qu’on fait beaucoup de grâces, mais parce qu’il y a peu de criminels : la multitude des crimes en assure l’impunité lorsque l’État dépérit.Sous la république romaine, jamais le sénat ni les consuls ne tentèrent de faire grâce ; le peuple même n’en faisait pas,quoiqu’il révoquât quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces annoncent que, bientôt les forfaits n’en auront plus besoin,et chacun voit où cela mène. Mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume : laissons discuter ces questions à l’homme juste qui n’a point failli, et qui jamais n’eut lui-même besoin de grâce.Chapitre 6 De la loi
Par le pacte social, nous avons donné l’existence et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver. Ce qui est bien et conforme à l’ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source ; mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n’aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule ; mais cette justice, pour être admise entre nous, doit être réciproque. À considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes ; elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet. Dans l’état de nature, où tour est commun,je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis ; je ne reconnais pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est pas ainsi dans l’état civil, où tous les droits sont fixés par la loi. Mais qu’est-ce donc enfin qu’une loi ? Tant qu’on se contentera de n’attacher à ce mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans s’entendre, et quand on aura dit ce que c’est qu’une loi de la nature, on n’en saura pas mieux ce que c’est qu’une loi de l’État. J’ai déjà dit qu’il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier. En effet, cet objet particulier est dans l’État ou hors de l’État. S’il est hors de l’État, une volonté qui lui est étrangère n’est point générale par rapport à lui ; et si cet objet est dans l’État, il en fait partie : alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l’un, et le tout, moins cette même partie, est l’autre. Mais le tout moins une partie n’est point le tout ; et tant que ce rapport subsiste, il n’y a plus de tout ; mais deux parties inégales : d’où il suit que la volonté de l’une n’est point non plus générale par rapport à l’autre. Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même ; et s’il se forme alors un rapport,c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi. Quand je dis que l’objet des lois est toujours général,j’entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulière. Ainsi la loi peut bien statuer qu’il y aura des privilèges, mais elle n’en peut donner nommément à personne ;la loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y être admis ; elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale : en un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient point à la puissance législative. Sur cette idée, on voit à l’instant qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale ; ni si le prince est au-dessus des lois,puisqu’il est membre de l’État ; ni si la loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même ; ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que des registres de nos volontés. On voit encore que, la loi réunissant l’universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un homme, quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi : ce qu’ordonne même le souverain sur un objet particulier n’est pas non plus une loi, mais un décret ; ni un acte de souveraineté, mais de magistrature. J’appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain(a) : j’expliquerai ci-après ce que c’est que gouvernement. Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le peuple, soumis aux lois, en doit être l’auteur ; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société. Mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés ? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d’avance ? ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon,exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ? De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais, le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des séductions des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l’attrait des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés.Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent ; le public veut le bien qu’il ne voit pas, Tous ont également besoin de guides. Il faut obliger les uns à conformer leurs volontés à leur raison ; il faut apprendre à l’autre à connaître ce qu’il veut. Alors des lumières publiques résulte l’union de l’entendement et de la volonté dans le corps social ; de là l’exact concours des parties, et, enfin la plus grande force du tout. Voilà d’où naît la nécessité d’un législateur.Chapitre 7 Du législateur
Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes, et qui n’en éprouvât aucune ; qui n’eût aucun rapport avec notre nature, et qui la connût à fond ; dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant voulût bien s’occuper du nôtre ; enfin, qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre (a). Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. Le même raisonnement que faisait Caligula quant au fait, Platon le faisait quant au droit pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche dans son livre du Règne. Mais s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. « Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l’institution et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des républiques. » Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être ; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer ; de substituer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons reçue de la nature. Il faut, en un mot,qu’il ôte à l’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l’institution est solide et parfaite : en sorte que si chaque citoyen n’est rien, ne peut rien que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre. Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l’État. S’il doit l’être par son génie, il ne l’est pas moins par son emploi. Ce n’est point magistrature, ce n’est point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la république, n’entre point dans sa constitution ; c’est une fonction particulière et supérieure qui n’a rien de commun avec l’empire humain ;car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes : autrement ces lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices ; jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n’altérassent la sainteté de son ouvrage. Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l’établissement des leurs. Les républiques modernes de l’Italie imitèrent souvent cet usage ;celle de Genève en fit autant et s’en trouva bien.(a) Rome, dans son plus bel âge, vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit prête à périr, pour avoir réuni sur les mêmes têtes l’autorité législative et le pouvoir souverain. Cependant les décemvirs eux-mêmes ne s’arrogèrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorité.« Rien de ce que nous vous proposons, disaient-ils au peuple,ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les auteurs des’ lois qui doivent faire votre bonheur. » Celui qui rédige les lois n’a donc ou ne doit avoir aucun droit législatif, et le peuple même ne peut, quand il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable, parce que, selon le pacte fondamental, il n’y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et qu’on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particulière est conforme à la volonté générale qu’après l’avoir soumise aux suffrages libres du peuple : j’ai déjà dit cela ; mais il n’est pas inutile de le répéter. Ainsi l’on trouve à la fois dans l’ouvrage de la législation deux choses qui semblent incompatibles ; une entreprise au-dessus de la force humaine, et, pour l’exécuter, une autorité qui n’est rien. Autre difficulté qui mérite attention. Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n’en sauraient être entendus. Or, il y a mille sortes d’idées qu’il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée : chaque individu, ne goûtant d’autre plan de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois. Pour qu’un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d’État, il faudrait que l’effet pût devenir la cause ; que l’esprit social, qui doit être l’ouvrage de l’institution, présidât à l’institution même ; et que les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi donc le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations de recourir à l’intervention du ciel et d’honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples soumis aux lois de l’État comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté, et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui s’élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine (a). Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, ni d’en être cru quand il s’annonce pour être leur interprète. Le grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission.Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle,ou feindre un secret commerce avec quelque divinité,’ ou dresser un oiseau’ pour lui parler à l’oreille, ou trouver d’autres moyens grossiers d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard une troupe d’insensés -mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De vains prestiges forment un lien passager ; il n’y a que la sagesse qui le rende durable. La loi judaïque, toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaël, qui depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont dictées ; et tandis que l’orgueilleuse philosophie ou l’aveugle esprit de parti ne voit en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables. Il ne faut pas, de tout ceci, conclure avec Warburton, que la politique et la religion aient parmi nous un objet commun, mais que, dans l’origine des nations, l’une sert d’instrument à l’autre.Chapitre 8 Du peuple
Comme, avant d’élever un grand édifice, l’architecte observe et sonde le sol pour voir s’il en peut soutenir le poids, le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois elles-mêmes,mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. C’est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux Arcadiens et aux Cyréniens, sachant que ces deux peuples étaient riches et ne pouvaient souffrir l’égalité :c’est pour cela qu’on vit en Crète de bonnes lois et de méchants hommes, parce que Minos n’avait discipliné qu’un peuple chargé de vices. Mille nations ont brillé sur la terre, qui n’auraient jamais pu souffrir de bonnes lois ; et celles même qui l’auraient pu n’ont eu, dans toute leur durée, qu’un temps fort court pour cela.La plupart des peuples, ainsi que des hommes, ne sont dociles que dans leur jeunesse ; ils deviennent incorrigibles envieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c’est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer ; le peuple ne peut pas même souffrir qu’on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l’aspect du médecin. Ce n’est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques violentes où les révolutions font Sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l’horreur du passé tient heu d’oubli, et où l’État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue, telle fut Rome après les Tarquins, et telles ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l’expulsion des tyrans. Mais ces événements sont rares ; ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l’État excepté. Elles ne sauraient même avoir lieu deux fois pour le même peuple : car il peut se rendre libre tant qu’il n’est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé. Alors les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir ; et, sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars et n’existe plus : il lui faut désormais un maître et non pas un libérateur. Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime : « On peut acquérir la liberté, mais en ne la recouvre jamais. » La jeunesse n’est pas l’enfance. Il est pour les nations comme pour les hommes un temps de jeunesse ou, si l’on veut, de maturité,qu’il faut attendre avant de les soumettre à des lois : mais la maturité d’un peuple n’est pas toujours facile à connaître ; et si on la prévient, l’ouvrage est manqué. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l’est pas au bout de dix siècles. Les Russes ne seront jamais vraiment policés,parce qu’ils l’ont été trop tôt. Pierre avait le génie imitatif ; il n’avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu’il fit étaient bien,la plupart étaient déplacées. Il a vu que son peuple était barbare,il n’a point vu qu’il n’était pas mûr pour la police ; il a voulu civiliser quand il ne fallait que l’aguerrir. Il a d’abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer par faire des Russes : il a empêché ses sujets de devenir jamais ce qu’ils pourraient être, en leur persuadant qu’ils étaient ce qu’ils ne sont pas. C’est ainsi qu’un précepteur français forme son élève pour briller au moment de son enfance, et puis n’être jamais rien. L’empire de Russie voudra subjuguer l’Europe, et sera subjugué lui-même. Les Tartares, ses sujets ou ses voisins,deviendront ses maîtres et les nôtres, cette révolution me paraît infaillible. Tous les rois de l’Europe travaillent de concert à l’accélérer.Chapitre 9 Suite
Comme la nature a donné des termes à la stature d’un homme bien conformé, passé lesquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d’un État, des bornes à l’étendue qu’il peut avoir, afin qu’il ne soit ni trop grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a, dans tout corps politique, un maximum de force qu’il ne saurait passer, et duquel souvent il s’éloigne à force de s’agrandir. Plus le lien social s’étend, plus il se relâche ; et en général un petit État est proportionnelle. ment plus fort qu’un grand. Mille raisons démontrent cette maxime. Premièrement,l’administration devient plus pénible dans les grandes distances,comme un poids devient plus lourd au bout d’un plus grand levier.Elle devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient : car chaque ville a d’abord la sienne, que le peuple paye ; chaque district la sienne, encore payée par le peuple ; ensuite chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice-royautés, qu’il faut toujours payer plus cher à mesure qu’on monte, et toujours aux dépens du malheureux peuple ; enfin vient l’administration suprême, qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets : loin d’être mieux gouvernés par tous ces différents ordres, ils le sont bien moins que s’il n’y en avait qu’un seul au-dessus d’eux. Cependant à peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires ; et quand il y faut recourir, l’État est toujours à la veille de sa ruine. Ce n’est pas tout : non seulement le gouvernement a moins de vigueur et de célérité pour faire observer les lois, empêcher les vexations, corriger les abus, prévenir les entreprises séditieuses qui peuvent se faire dans des lieux éloignés ;mais le peuple a moins d’affection pour ses chefs, qu’il ne voit jamais, pour la patrie, qui est à ses yeux comme le monde, et pour ses concitoyens, dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de provinces ; diverses qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous des climats opposés, et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement. Des lois différentes n’engendrent que trouble et confusion parmi des.peuples qui, vivant sous les mêmes chefs et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns chez les autres, sont soumis à d’autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux. Les talents sont enfouis, les vertus ignorées, les vices impunis, dans cette multitude d’hommes inconnus les uns aux autres, que le siège de l’administration suprême rassemble dans un même lieu. Les chefs, accablés d’affaires, ne voient rien par eux-mêmes ; des commis gouvernent l’État. Enfin les mesures qu’il faut prendre pour maintenir l’autorité générale, à laquelle tant d’officiers éloignés veulent se soustraire ou en imposer,absorbent tous les soins publics ; il n’en reste plus pour le bonheur du peuple, à peine en reste-t-il pour sa défense, au besoin ; et c’est ainsi qu’un corps trop grand pour sa constitution s’affaisse et périt écrasé sous son propre poids. D’un autre côté, l’État doit se donner une certaine base pour avoir de la solidité, pour résister aux secousses qu’il ne manquera pas d’éprouver, et aux efforts qu’il sera contraint de faire pour se soutenir : car tous les peuples ont une espèce de force centrifuge, par laquelle ils agissent continuellement les uns contre les autres, et tendent à s’agrandir aux dépens de leurs voisins, comme les tourbillons de Descartes. Ainsi les faibles risquent d’être bientôt engloutis ; et nul ne peut guère se conserver qu’en se mettant avec tous dans une espèce d’équilibre qui rende la compression partout à peu près égale. On voit par là qu’il y a des raisons de s’étendre et des raisons de se resserrer ; et ce n’est pas le moindre talent du politique de trouver entre les unes et les autres la proportion la plus avantageuse à la conservation de l’État. On peut dire en général que les premières n’étant qu’extérieures et relatives,doivent être subordonnées aux autres, qui sont internes et absolues. Une saine et forte constitution est la première chose qu’il faut rechercher ; et l’on doit plus compter sur la vigueur qui naît d’un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire. Au reste, on a vu des États tellement constitués, que la nécessité des conquêtes entrait dans leur constitution même, et que, pour se maintenir, ils étaient forcés de s’agrandir sans cesse. Peut-être se félicitaient-ils beaucoup de cette heureuse nécessité, qui leur montrait pourtant, avec le terme de leur grandeur, l’inévitable moment de leur chute.Chapitre 10 Suite
On peut mesurer un corps politique de deux manières,savoir : par l’étendue du territoire, et par le nombre du peuple ; et il y a entre l’une et l’autre de ces mesures un rapport convenable pour donner à l’État sa véritable grandeur. Ce sont les hommes qui font l’État, et c’est le terrain qui nourrit les hommes : ce rapport est donc que la terre suffise à l’entretien de ses habitants, et qu’il y ait autant d’habitants que la terre en peut nourrir. C’est dans cette proportion. que se trouve le maximum d’un nombre donné de peuple ; car s’il y a du terrain de trop, la garde en est onéreuse, la culture insuffisante, le produit superflu ; c’est la cause prochaine des guerres défensives : s’il n’y en a pas assez, l’État se trouve pour le supplément à la discrétion de ses voisins ;c’est la cause prochaine des guerres offensives. Tout peuple qui n’a, par sa position, que l’alternative entre le commerce ou la guerre, est faible en lui-même ; il dépend de ses voisins, il,dépend des événements ; il n’a jamais qu’une existence incertaine et courte. Il subjugue et change de situation, ou il est subjugué et n’est rien. Il ne peut se conserver libre qu’à force de petitesse ou de grandeur. On ne peut donner en calcul un rapport fixe entre l’étendue de terre et le nombre d’hommes qui se suffisent l’un à l’autre, tant à cause des différences qui se trouvent dans les qualités du terrain,dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses productions,dans l’influence des climats, que de celles qu’on remarque dans les tempéraments des hommes qui les habitent, dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol ingrat. Il faut encore avoir égard à la plus grande ou moindre fécondité des femmes, à ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable à la population, à la quantité dont lie législateur peut espérer d’y concourir par ses établissements, de sorte qu’il ne doit pas fonder son jugement sur ce qu’il voit, mais sur ce qu’il prévoit, ni s’arrêter autant à l’état actuel de la population qu’à celui où elle doit naturellement parvenir. Enfin, il y a mille occasions où les accidents particuliers du lieu exigent ou permettent qu’on embrasse plus de terrain qu’il ne pariait nécessaire. Ainsi l’on s’étendra beaucoup dans un pays de montagnes, où les productions naturelles, savoir, les biais, les pâturages, demandent moins de travail, où l’expérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les Plaines, et où un grand sol incliné ne donne qu’une petite base horizontale, la seule qu’il faut compter pour la végétation. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer,même dans des rochers et des sables presque stériles, parce que la pêche y peut suppléer en grande partie aux productions de la terre,que les hommes doivent être plus rassemblés pour repousser les pirates, et qu’on a d’ailleurs plus de facilité pour délivrer le pays, par les colonies, des habitants dont il est surchargé. À ces conditions pour instituer un peuple, il en faut ajouter une qui ne peut suppléer à nulle autre, mais sans laquelle elles sont toutes inutiles : c’est qu’on jouisse de l’abondance et de la paix ; car le temps où s’ordonne un État est, comme celui où se forme un bataillon, l’instant où le corps est le moins capable de résistance et le plus facile à détruire. On résisterait mieux dans un désordre absolu que dans un moment de fermentation,où chacun s’occupe de son rang et non du péril. Qu’une guerre, une famine, une sédition survienne en ce temps de crise, l’État est infailliblement renversé. Ce n’est pas qu’il n’y ait beaucoup de gouvernements établis durant ces orages ; mais alors ce sont ces gouvernements mêmes qui détruisent l’État. Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de trouble pour faire passer, à la faveur de l’effroi public, des lois destructives que le peuple n’adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l’institution est un des caractères les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l’œuvre du législateur d’avec celle du tyran. Quel peuple est donc propre à la législation ? Celui qui,se trouvant déjà lié par quelque union d’origine, d’intérêt ou de convention, n’a point encore porté le vrai joug des lois ;celui qui n’a ni coutumes, ni superstitions bien enracinées ;celui qui ne craint pas d’être accablé par une invasion subite ; qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins,peut résister seul à chacun d’eux, ou s’aider de l’un pour repousser l’autre ; celui dont chaque membre peut être connu de tous et où l’on n’est point forcé de charger un homme d’un plus grand fardeau qu’un homme ne peut porter ; celui qui peut se passer des autres peuples, et dont tout autre peuple peut se passer(a) ; celui qui n’est ni riche ni pauvre, et peut se suffire à lui-même ; enfin celui qui réunit la consistance d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l’ouvrage de la législation est moins ce qu’il faut établir que ce qu’il faut détruire ; et ce qui rend le succès si rare, c’est l’impossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions, il est vrai, se trouvent difficilement rassemblées : aussi voit-on peu d’États bien constitués. Il est encore en Europe un pays capable de législation ;c’est l’île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériteraient bien que quelque homme sage lui apprit à la conserver. J’ai quelque pressentiment qu’un jour cette petite île étonnera l’Europe.Chapitre 11 Des divers systèmes de législation
Si l’on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation,on trouvera qu’il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l’égalité : la liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l’État ;l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. J’ai déjà dit ce que c’est que la liberté civile : à l’égard de l’égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes ; mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessus de toute violence, et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois ; et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un, autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre (b) : ce qui suppose, du côté des grands, modération de biens et de crédit, et, du côté des petits,modération d’avarice et de convoitise. Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l’abus est inévitable,s’ensuit-il qu’il ne faille pas au moins le régler ? C’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité, que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Mais ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports qui naissent, tant de la situation locale que du caractère des habitants, et c’est sur ces rapports qu’il faut assigner à chaque peuple un système particulier d’institution, qui soit le meilleur, non peut-être en lui-même,mais pour l’État auquel il est destiné. Par exemple, le sol est-il ingrat et stérile, ou le pays trop serré pour les habitants ?tournez-vous du côté de l’industrie et des arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des coteaux fertiles dans un bon terrain, manquez-vous d’habitants donnez tous vos soins à l’agriculture, qui multiplie les hommes, et chassez les arts, quine feraient qu’achever de dépeupler le pays en attroupant sur quelques points du territoire le peu d’habitants qu’il y a (a). Occupez-vous des rivages étendus et Commodes, couvrez la mer de vaisseaux, cultivez le commerce et la navigation, vous aurez une existence brillante et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que, des rochers presque inaccessibles ? Restez barbares et ichthyophages ; vous en vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-être, et sûrement plus heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelque cause qui les ordonne d’une manière particulière, et rend sa législation propre à lui seul. C’est ainsi qu’autrefois les Hébreux, et récemment les Arabes, ont eu pour principal objet la religion, les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre, et Rome la vertu. L’auteur de l’Esprit des lois a montré dans des foules d’exemples par quel art le législateur dirige l’institution vers chacun de ces objets. Ce qui rend la constitution d’un État véritablement solide et durable, c’est quand les convenances sont tellement observées, que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mêmes points, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire,qu’assurer, accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses que l’un tende à la servitude et l’autre à la liberté l’un aux richesses, l’autre à la population ; l’un à la paix, l’autre aux conquêtes :on verra les lois s’affaiblir insensiblement, la constitution s’altérer, et l’État ne cessera d’être agité jusqu’à ce qu’il soit détruit ou changé, et que l’invincible nature ait repris son empire.Chapitre 12 Division des lois
Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer.Premièrement, l’action du corps entier agissant sur lui-même,c’est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l’État ; et ce rapport est composé de celui des termes intermédiaires, comme nous le verrons ci-après. Les lois qui règlent ce rapport partent le nom de lois politiques, et s’appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages ; car, s’il n’y a dans chaque État qu’une bonne manière de l’ordonner, le peuple qui l’a trouvée doit s’y tenir : mais si l’ordre établi est mauvais,pourquoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui l’empêchent d’être bon ? D’ailleurs, en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures ;car, s’il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui adroit de l’en empêcher ? La seconde relation est celle des membres entre eux, ou avec le corps entier ; et ce rapport doit être au premier égard aussi petit. et au second aussi grand qu’il est possible ; en sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres, et dans une excessive dépendance de la cité : ce qui se fait toujours par les mêmes moyens ; car il n’y a que la force de l’État qui fasse la liberté de ses membres. C’est de ce deuxième rapport que naissent les lois civiles. On peut considérer une troisième sorte de relation entre l’homme et la loi, savoir, celle de la désobéissance à la peine ; et celle-ci donne lieu à l’établissement des lois criminelles, qui,dans le fond, sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres. À ces trois sortes de lois il s’en joint une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur l’airain, mais dans les cœurs des citoyens ; qui fait la véritable constitution de l’État ; qui prend tous les Jours de nouvelles forces ; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s’éteignent, les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l’esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l’habitude à celle de l’autorité. Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l’opinion ; partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres ; partie dont le grand législateur s’occupe en secret,tandis qu’il paraît se borner à des règlements particuliers, qui ne sont que le cintre de la voûte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l’inébranlable clef. Entre ces diverses classes, les lois politiques, qui constituent la forme du gouvernement, sont la seule relative à mon sujet.Partie 3
Avant de parler des diverses formes de gouvernement, tâchons de fixer le sens précis de ce mot qui n’a pas encore été fort bien expliqué.Chapitre 1 Du gouvernement en général
J’avertis le lecteur que ce chapitre doit être lu posément, et que je ne sais pas l’art d’être clair pour qui ne veut pas être attentif. Toute action libre a deux causes qui concourent à la produire : l’une morale, savoir : la volonté qui détermine l’acte ; l’autre physique, savoir : la puissance qui l’exécute. Quand je marche vers un objet, il faut premièrement que j’y veuille aller ; en second lieu, que mes pieds m’y portent. Qu’un paralytique veuille courir, qu’un homme agile ne le veuille pas, tous deux resteront en place. Le corps politique a les mêmes, mobiles : on y distingue de même la force et la volonté ; celle-ci sous le nom de puissance législative, l’autre sous le nom de puissance exécutive. Rien ne s’y fait ou ne doit s’y faire sans leur concours. Nous avons vu que la puissance législative appartient au peuple,et ne peut appartenir qu’à lui. Il est aisé de voir, au contraire,par les principes ci-devant établis, que la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine,parce que cette puissance ne consiste qu’en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni par conséquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent être que des lois. Il faut donc à la force publique un agent propre qui la réunisse et la mette en œuvre selon les directions de la volonté générale,qui serve à la communication de l’État et du souverain, qui fasse en quelque sorte dans la personne publique ce que fait dans l’homme l’union de l’âme et du corps. Voilà quelle est, dans l’État, la raison du gouvernement, confondu mal à propos avec le souverain,dont il n’est que le ministre. Qu’est-ce donc que le gouvernement ? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l’exécution des lois et du maintien de la liberté tant civile que politique. Les membres de ce corps s’appellent magistrats ou rois,c’est-à-dire gouverneurs et le corps entier porte le nom de prince(a). Ainsi ceux qui prétendent que l’acte par lequel un peuple se soumet à des chefs n’est point un contrat ont grande raison. Ce n’est absolument qu’une commission, un emploi, dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu’il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plaît. L’aliénation d’un tel droit, étant incompatible avec la nature du corps social, est contraire au but de l’association. J’appelle donc gouvernement ou suprême administration,l’exercice légitime de la puissance exécutive, et prince ou magistrat, l’homme ou le corps chargé de cette administration. C’est dans le gouvernement que se trouvent les forces intermédiaires, dont les rapports composent celui du tout au tout du souverain à l’État. On peut représenter ce dernier rapport par celui des extrêmes d’une proportion continue, dont la moyenne proportionnelle est le gouvernement. Le gouvernement reçoit du souverain les ordres qu’il donne au peuple ; et, pour que l’État soit dans un bon équilibre, il faut, tout compensé, qu’il y ait égalité entre le produit ou la puissance du gouvernement pris en lui-même, et le produit ou la puissance des citoyens, qui sont souverain d’un côté et sujets de l’autre. De plus, on ne saurait altérer aucun des trois termes sans rompre à l’instant la proportion. Si le souverain veut gouverner,ou si le magistrat veut donner des lois, ou si les sujets refusent d’obéir, le désordre succède à la règle, la force et la volonté n’agissent plus de concert, et l’État dissous tombe ainsi dans le despotisme ou dans l’anarchie. Enfin, comme il n’y a qu’une moyenne proportionnelle entre chaque rapport, il n’y a non plus qu’un bon gouvernement possible dans un État : mais, comme mille événements peuvent changer les rapports d’un peuple, non seulement différents gouvernements peuvent être bons à divers peuples, mais au même peuple en différents temps. Pour tâcher de donner une idée des divers rapports qui peuvent régner entre ces deux extrêmes, je prendrai pour exemple le nombre du peuple, comme un rapport plus facile à exprimer. Supposons que l’État soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps ; mais chaque particulier, en qualité de sujet, est considéré comme individu : ainsi le souverain est au sujet comme dix mille est à un ; c’est-à-dire que chaque membre de l’État n’a pour sa part que la dix-millième partie de l’autorité souveraine, quoiqu’il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé de cent mille hommes, l’état des sujets ne change pas,et chacun porte également tout l’empire des lois, tandis que son suffrage, réduit à un cent-millième, a dix fois moins d’influence dans leur rédaction. Alors, le sujet, restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D’où il suit que, plus l’État s’agrandit, plus la liberté diminue. Quand je dis que le rapport augmente, j’entends qu’il s’éloigne de l’égalité. Ainsi, plus le rapport est grand dans l’acception des géomètres, moins il y a de rapport dans l’acception commune :dans la première, le rapport, considéré selon la quantité, se mesure par l’exposant ; et dans l’autre, considéré selon l’identité, il s’estime par la similitude. Or, moins les volontés particulières se rapportent à la volonté générale, c’est-à-dire les mœurs aux lois, plus la force réprimante doit augmenter. Donc le gouvernement, pour être bon, doit être relativement plus fort à mesure que le peuple est plus nombreux. D’un autre côté, l’agrandissement de l’État donnant aux dépositaires de l’autorité publique plus de tentations et de moyens d’abuser de leur pouvoir, plus le gouvernement doit avoir de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour contenir le gouvernement. Je ne parle pas ici d’une force absolue, mais de la force relative des diverses parties de l’État. Il suit de ce double rapport que la proportion continue entre le souverain, le prince et le peuple, n’est point une idée arbitraire,mais une conséquence nécessaire de la nature du corps politique. Il suit encore que l’un des extrêmes, savoir le peuple, comme sujet,étant fixe et représenté par l’unité, toutes les fois que la raison doublée augmente ou diminue, la raison simple augmente ou diminue semblablement, et que par conséquent le moyen terme est changé. Ce qui fait voir qu’il n’y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu’il peut y avoir autant de gouvernements différents en nature que d’États différents en grandeur. Si, tournant ce système en ridicule, on disait que, pour trouver cette moyenne proportionnelle et former le corps du gouvernement,il ne faut, selon moi, que tirer la racine carrée du nombre du peuple, je répondrais que je ne prends ici ce nombre que pour un exemple ; que les rapports dont je parle ne se mesurent pas seulement par le nombre des hommes, mais en général par la quantité d’action, laquelle se combine par des multitudes de causes ;qu’au reste, si pour m’exprimer en moins de paroles, j’emprunte un moment des termes de géométrie, je n’ignore pas cependant que la précision géométrique n’a point lieu dans les quantités morales. Le gouvernement est en petit ce que le corps politique qui le renferme est en grand. C’est une personne morale douée de certaines facultés, active comme le souverain, passive comme l’État, et qu’on peut décomposer en d’autres rapports semblables d’où naît par conséquent une nouvelle proportion une autre encore dans celle-ci,selon l’ordre des tribunaux, jusqu’à ce qu’on arrive à un moyen terme indivisible, c’est-à-dire à un seul chef ou magistrat suprême, qu’on peut se représenter, au milieu de cette progression,comme l’unité entre la série des fractions et celles des nombres. Sans nous embarrasser dans cette multiplication de termes,contentons-nous de considérer le gouvernement comme un nouveau corps dans l’État, distinct du peuple et du souverain, et intermédiaire entre l’un et l’autre. Il y a cette différence essentielle entre ces deux corps, que l’État existe par lui-même, et que le gouvernement n’existe que parle souverain. Ainsi la volonté dominante du prince n’est ou ne doit être que la volonté générale ou la loi ; sa force n’est que la force publique concentrée en lui : sitôt qu’il veut tirer de lui-même quelque acte absolu et indépendant, la liaison du tout commence à se relâcher. S’il arrivait enfin que le prince eût une volonté particulière plus active que celle du souverain, et qu’il usât, pour obéir à cette volonté particulière, de la force publique qui est dans ses mains, en sorte qu’on eût, pour ainsi dire, deux souverains, l’un de droit et l’autre de fait, à l’instant l’union sociale s’évanouirait, et le corps politique serait dissous. Cependant, pour que le corps du gouvernement ait une existence,une vie réelle qui le distingue du corps de l’État ; pour que tous ses membres puissent agir de concert et répondre à la fin pour laquelle il est institué, il lui faut un moi particulier, une sensibilité commune à ses membres, une force, une volonté propre qui tende à sa conservation. Cette existence particulière suppose des assemblées, des conseils, un pouvoir de délibérer, de résoudre,des droits, des titres, des privilèges qui appartiennent au prince exclusivement, et qui rendent la condition du magistrat plus honorable à proportion qu’elle est plus pénible. Les difficultés sont dans la manière d’ordonner dans le tout, ce tout subalterne,de sorte qu’il n’altère point la constitution générale en affermissant la sienne ; qu’il distingue toujours sa force particulière, destinée à sa propre conservation, de la force publique, destinée à la conservation de l’État, et qu’en un mot il soit toujours prêt à sacrifier le gouvernement au peuple, et non le peuple au gouvernement. D’ailleurs, bien que le corps artificiel du gouvernement soit l’ouvrage d’un autre corps artificiel, et qu’il n’ait, en quelque sorte, qu’une vie empruntée et subordonnée, cela n’empêche pas qu’il ne puisse agir avec plus ou moins de vigueur ou de célérité,jouir, pour ainsi dire, d’une santé plus ou moins robuste. Enfin,sans s’éloigner directement du but de son institution, il peut s’en écarter plus ou moins, selon la manière dont il est constitué. C’est de toutes ces différences que naissent les rapports divers que le gouvernement doit avoir avec le corps de l’État, selon les rapports accidentels et particuliers par lesquels ce même État est modifié. Car souvent le gouvernement le meilleur en soi deviendra le plus vicieux, si ses rapports ne sont altérés selon les défauts du corps politique auquel il appartient.Chapitre 2 Du principe qui constitue les diverses formes de gouvernement
Pour exposer la cause générale de ces différences, il faut distinguer ici le principe et le gouvernement, comme j’ai distingué ci-devant l’État et le souverain. Le corps du magistrat peut être composé d’un plus grand ou moindre nombre de membres. Nous avons dit que le rapport du souverain aux sujets était d’autant plus grand que le peuple était plus nombreux ; et, par une évidente analogie, nous en pouvons dire autant du gouvernement à l’égard des magistrats. Or, la force totale du gouvernement, étant toujours celle de l’État, ne varie point : d’où il suit que plus il use de cette force sur ses propres membres, moins il lui en reste pour agir surtout le peuple. Donc, plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. Comme cette maxime est fondamentale, appliquons-nous à la mieux éclaircir. Nous pouvons distinguer dans la personne du magistrat trois volontés essentiellement différentes : premièrement, la volonté propre de l’individu, qui ne tend qu’à son avantage particulier ; secondement, la volonté commune des magistrats,qui se rapporte uniquement à l’avantage du prince, et qu’on peut appeler volonté de corps, laquelle est générale par rapport au gouvernement, et particulière par rapport à l’État, dont le gouvernement fait partie ; en troisième lieu, la volonté du peuple ou la volonté souveraine, laquelle est générale, tant par rapport à l’État considéré comme le tout, que par rapport au gouvernement considéré comme partie du tout. Dans une législation parfaite, la volonté particulière ou individuelle doit être nulle ; la volonté de corps propre au gouvernement très subordonnée ; et par conséquent la volonté générale ou souveraine toujours dominante et la règle unique de toutes les autres. Selon l’ordre naturel, au contraire, ces différentes volontés deviennent plus actives à mesure qu’elles se concentrent. Ainsi la volonté générale est toujours la plus faible, la volonté de corps ale second rang, et là volonté particulière le premier de tous : de sorte que, dans le gouvernement, chaque membre est premièrement soi-même, et puis magistrat, et puis citoyen ;gradation directement opposée à celle qu’exige l’ordre social. Cela posé, que tout le gouvernement soit entre les mains d’un seul homme, voilà la volonté particulière et la volonté de corps parfaitement réunies, et par conséquent celle-ci au plus haut degré d’intensité qu’elle puisse avoir. Or, comme c’est du degré de la volonté que dépend l’usage de la force, et que la force absolue du gouvernement ne varie point, il s’ensuit que le plus actif des gouvernements est celui d’un seul. Au contraire, unissons le gouvernement à l’autorité législative ; faisons le prince du souverain, et de tous les citoyens autant de magistrats : alors la volonté de corps,confondue avec la volonté générale, n’aura pas plus d’activité qu’elle, et laissera la volonté particulière dans toute sa force.Ainsi le gouvernement, toujours avec la même force absolue, sera dans son minimum de force relative ou d’activité. Ces rapports sont incontestables, et d’autres considérations servent encore à les confirmer. On voit, par exemple, que chaque magistrat est plus actif dans son corps que chaque citoyen dans le sien, et que par conséquent la volonté particulière a beaucoup plus d’influence dans les actes du gouvernement que dans ceux du souverain ; car chaque magistrat est presque toujours chargé de quelque fonction du gouvernement ; au lieu que chaque citoyen pris à part n’a aucune fonction de la souveraineté.D’ailleurs, plus l’État s’étend, plus sa force réelle augmente,quoiqu’elle n’augmente pas en raison de son étendue : mais l’État restant le même, les magistrats ont beau se multiplier, le gouvernement n’en acquiert pas une plus grande force réelle, parce que cette force est celle de l’État, dont la mesure est toujours égale. Ainsi, la force relative ou l’activité du gouvernement diminue, sans que sa force absolue ou réelle puisse augmenter. Il est sûr encore que l’expédition des affaires devient plus lente à mesure que plus de gens en sont chargés ; qu’en donnant trop à la prudence ou ne donne pas assez à la fortune ; qu’on laisse échapper l’occasion, et qu’à force de délibérer on perd souvent le fruit de la délibération. Je viens de prouver que le gouvernement se relâche à mesure que les magistrats se multiplient ; et j’ai prouvé ci-devant que plus le peuple est nombreux, plus la force réprimante doit augmenter. D’où il suit que le rapport des magistrats au gouvernement doit être inverse du rapport des sujets au souverain ; c’est-à-dire que, plus l’État s’agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer ; tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l’augmentation du peuple. Au reste, je ne parle ici que de la force relative du gouvernement, et non de sa rectitude : car, au contraire, plus le magistrat est nombreux, plus la volonté de corps se rapproche de la volonté générale ; au lieu que, sous un magistrat unique,cette même volonté de corps n’est, comme je l’ai dit, qu’une volonté particulière. Ainsi, l’on perd d’un côté ce qu’on peut gagner de l’autre, et l’art du législateur est de savoir fixer le point où la force et la volonté du gouvernement, toujours en proportion réciproque, se combinent dans le rapport le plus avantageux à l’État.Chapitre 3 Division des gouvernements
On a vu dans le chapitre précédent pourquoi l’on distingue les diverses espèces ou formes de gouvernements par le nombre des membres qui les composent ; il reste à voir dans celui-ci comment se fait cette division. Le souverain peut, en premier lieu, commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple,en sorte qu’il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de démocratie. Ou bien il peut resserrer le gouvernement entre les mains d’un petit nombre, en sorte qu’il y ait plus de simples citoyens que de magistrats ; et cette forme porte le nom d’aristocratie. Enfin il peut concentrer tout le gouvernement dans les mains d’un magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir.Cette troisième forme est la plus commune, et s’appelle monarchie,ou gouvernement royal. On doit remarquer que toutes ces formes, ou du moins les deux premières, sont susceptibles de plus ou de moins, et ont même une assez grande latitude ; car la démocratie peut embrasser tout le peuple, ou se resserrer jusqu’à la moitié. L’aristocratie, à son tour, peut, de la moitié du peuple, se resserrer jusqu’au plus petit nombre indéterminément. La royauté même est susceptible de quelque partage. Sparte eut constamment deux rois par sa constitution ; et l’on a vu dans l’empire romain jusqu’à huit empereurs à la fois sans qu’on pût dire que l’empire fût divisé.Ainsi il y a un point où chaque forme de gouvernement se confond avec la suivante, et l’on voit que, sous trois seules dénominations, le gouvernement est réellement susceptible d’autant de formes diverses que l’État a de citoyens. Il y a plus : ce même gouvernement pouvant, à certains égards, se subdiviser en d’autres parties, l’une administrée d’une manière et l’autre d’une autre, il peut résulter de ces trois formes combinées une multitude de formes mixtes, dont chacune est multipliable par toutes les formes simples. On a, de tout temps, beaucoup disputé sur la meilleure forme de gouvernement, sans considérer que chacune d’elles est la meilleure en certains cas, et la pire en d’autres. Si, dans les différents États, le nombre des magistrats suprêmes doit être en raison inverse de celui des citoyens, il s’ensuit qu’en général le gouvernement démocratique convient aux petits États, l’aristocratique aux médiocres, et le monarchique aux grands. Cette règle se tire immédiatement du principe. Mais comment compter la multitude de circonstances qui peuvent fournir des exceptions ?Chapitre 4 De la démocratie
Celui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit être exécutée et interprétée. Il semble donc qu’on ne saurait avoir une meilleure constitution que celle où le pouvoir exécutif est joint au législatif : mais c’est cela même qui rend ce gouvernement insuffisant à certains égards, parce que les choses qui doivent être distinguées ne le sont pas, et que le prince et le souverain, n’étant que la même personne, ne forment, pour ainsi dire, qu’un gouvernement sans gouvernement. Il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales pour les donner aux objets particuliers. Rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques, et l’abus des lois par le gouvernement est un mal moindre que la corruption du législateur, suite infaillible des vues particulières. Alors, l’État étant altéré dans sa substance, toute réforme devient impossible. Un peuple qui n’abuserait jamais du gouvernement n’abuserait pas non plus de l’indépendance ; un peuple qui gouvernerait toujours bien n’aurait pas besoin d’être gouverné. A prendre le terme dans la rigueur de l’acception, il n’a jamais existé de véritable démocratie, et il n’en existera jamais. Il est contre l’ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques, et l’on voit aisément qu’il ne saurait établir pour cela des commissions, sans que la forme de l’administration change. En effet, je crois pouvoir poser en principe que, quand les fonctions du gouvernement sont partagées entre plusieurs tribunaux,les moins nombreux acquièrent tôt ou tard la plus grande autorité,ne fût-ce qu’à cause de la facilité d’expédier les affaires, qui les y amène naturellement. D’ailleurs, que de choses difficiles à réunir ne suppose pas ce gouvernement ! Premièrement, un État très petit, où le peuple soit facile à rassembler, et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres ; secondement, une grande simplicité de mœurs qui prévienne la multitude d’affaires et de discussions épineuses ; ensuite beaucoup d’égalité dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi l’égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l’autorité ; enfin peu ou point de luxe,car ou le luxe est l’effet des richesses, ou il les rend nécessaires ; il corrompt à la fois le riche et le pauvre,l’un par la possession, l’autre par la convoitise ; il vend la patrie à la mollesse, à la vanité ; il ôte à l’État tous ses citoyens pour les asservir les uns aux autres, et tous à l’opinion. Voilà pourquoi un auteur célèbre a donné la vertu pour principe à la république, car toutes ces conditions ne sauraient subsister sans la vertu ; mais, faute d’avoir fait les distinctions nécessaires, ce beau génie a manqué souvent de justesse,quelquefois de clarté, et n’a pas vu que l’autorité souveraine étant partout la même, le même principe doit avoir lieu dans tout État bien constitué, plus ou moins, il est vrai, selon la forme du gouvernement. Ajoutons qu’il n’y a pas de gouvernement si sujet, aux guerres civiles et aux agitations intestines que le démocratique ou populaire, parce qu’il n’y en a aucun qui tende si fortement et si continuellement à changer de forme, ni qui demande plus de vigilance et de courage pour être maintenu dans la sienne. C’est surtout dans cette constitution que le citoyen doit s’armer de force et de constance, et dire chaque jour de sa vie au fond de son cœur ce que disait un vertueux Palatin (a) dans la diète de Pologne : Malo periculosam libertatem quam quietumservitium. S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes.Chapitre 5 De l’aristocratie
Nous avons ici deux personnes morales très distinctes, savoir,le gouvernement et le souverain ; et par conséquent deux volontés générales, l’une par rapport à tous les citoyens, l’autre seulement pour les membres de l’administration. Ainsi, bien que le gouvernement puisse régler sa police intérieure comme il lui plaît,il ne peut jamais parler au peuple qu’au nom du souverain,c’est-à-dire au nom du peuple même ; ce qu’il ne faut jamais oublier. Les premières sociétés se gouvernèrent aristocratiquement. Les chefs des familles délibéraient entre eux des affaires publiques.Les jeunes gens cédaient sans peine à l’autorité de l’expérience.De là les noms de prêtres, d’anciens, de sénat, de gérontes. Les sauvages de l’Amérique septentrionale se gouvernent encore ainsi de nos jours et sont très bien gouvernés. Mais, à mesure que l’inégalité d’institution l’emporta sur l’inégalité naturelle, la richesse ou la puissance (a) fut préférée à l’âge, et l’aristocratie devint élective. Enfin la puissance transmise avec les biens du père aux enfants, rendant les familles patriciennes, rendit le gouvernement héréditaire, et l’on vit des sénateurs de vingt ans. Il y a donc trois sortes d’aristocratie : naturelle,élective, héréditaire. La première ne convient qu’à des peuples simples ; la troisième est le pire de tous les gouvernements.La deuxième est le meilleur : c’est l’aristocratie proprement dite. Outre l’avantage de la distinction des deux pouvoirs, elle a celui du choix de ses membres ; car, dans le gouvernement populaire, tous les citoyens naissent magistrats ; mais celui-ci les borne à un petit nombre, et ils ne le deviennent que par élection (b) : moyen par lequel la probité, les lumières,l’expérience, et toutes les autres raisons de préférence et d’estime publique, sont autant de nouveaux garants qu’on sera sagement gouverné. De plus, les assemblées se font plus commodément ; les affaires se discutent mieux, s’expédient avec plus d’ordre et de diligence ; le crédit de l’État est mieux soutenu chez l’étranger par de vénérables sénateurs que par une multitude inconnue ou méprisée. En un mot, c’est l’ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude, quand on est sûr qu’ils la gouverneront pour son profit, et non pour le leur. Il ne faut point multiplier en vain les ressorts, ni faire avec vingt mille hommes ce que cent hommes choisis peuvent encore mieux. Mais il faut remarquer que l’intérêt de corps commence à moins diriger ici la force publique sur la règle de la volonté générale, et qu’une autre pente inévitable enlève aux lois une partie de la puissance exécutive. A l’égard des convenances particulières, il ne faut ni un État si petit, ni un peuple si simple et si droit, que l’exécution des lois suive immédiatement de la volonté publique, comme dans une bonne démocratie. Il ne faut pas non plus une si grande nation, que les chefs épars pour la gouverner puissent trancher du souverain chacun dans son département, et commencer par se rendre indépendants pour devenir enfin les maîtres. Mais si l’aristocratie exige quelques vertus de moins que le gouvernement populaire, elle en exige aussi d’autres qui lui sont propres, comme la modération dans les riches, et le contentement dans les pauvres ; car il semble qu’une égalité rigoureuse y serait déplacée ; elle ne fut pas même observée à Sparte. Au reste, si cette forme comporte une certaine inégalité de fortune, c’est bien pour qu’en général l’administration des affaires publiques soit confiée à ceux qui peuvent le mieux y donner tout leur temps, niais non pas, comme prétend Aristote, pour que les riches soient toujours préférés. Au contraire, il importe qu’un choix opposé apprenne quelquefois au peuple qu’il y a, dans le mérite des hommes, des raisons de préférence plus importantes que la richesse.Chapitre 6 De la monarchie
Jusqu’ici nous avons considéré le prince comme une personne morale et collective, unie par la force des lois, et dépositaire dans l’État de la puissance exécutive. Nous avons maintenant à considérer cette puissance réunie entre les mains d’une personne naturelle, d’un homme réel, qui seul ait droit d’en disposer selon les lois. C’est ce qu’on appelle un monarque ou un roi. Tout au contraire des autres administrations où un être collectif représente un individu, dans celle-ci un individu représente un être collectif ; en sorte que l’unité morale qui constitue le prince est en même temps une unité physique, dans laquelle toutes les facultés que la loi réunit dans l’autre avec tant d’efforts se trouvent naturellement réunies. Ainsi la volonté du peuple, et la volonté du prince, et la force publique de l’État, et la force particulière du gouvernement, tout répond au même mobile, tous les ressorts de la machine sont dans la même main, tout marche au même but ; il n’y a point de mouvements opposés qui s’entre-détruisent, et l’on ne peut imaginer aucune sorte de constitution dans laquelle un moindre effort produise une action plus considérable. Archimède, assis tranquillement sur le rivage et tirant sans peine à flot un grand vaisseau, me représente un monarque habile, gouvernant de son cabinet ses vastes États, et faisant tout mouvoir en paraissant immobile. Mais s’il n’y a point de gouvernement qui ait plus de vigueur,il n’y en a point où la volonté particulière ait plus d’empire et domine plus aisément les autres : tout marche au même but, il est vrai ; mais ce but n’est point celui de la félicité publique, et la force même de l’administration tourne sans cesse au préjudice de l’État. Les rois veulent être absolus, et de loin on leur crie que le meilleur moyen de l’être est de se faire aimer de leurs peuples.Cette maxime est très belle, et même très vraie à certains égards : malheureusement, on s’en moquera toujours dans les cours. La puissance qui vient de l’amour des peuples est sans doute la plus grande ; mais elle est précaire et conditionnelle ; jamais les princes ne s’en contenteront. Les meilleurs rois veulent pouvoir être méchants s’il leur plait, sans cesser d’être les maîtres. Un sermonneur politique aura beau leur dire que, la force du peuple étant la leur, leur plus grand intérêt est que le peuple soit florissant, nombreux, redoutable ; ils savent très bien que cela n’est pas vrai. Leur intérêt personnel est premièrement que le peuple soit faible, misérable, et qu’il ne puisse jamais leur résister. J’avoue que, supposant les sujets toujours parfaitement soumis, l’intérêt du prince serait alors que le peuple fût puissant, afin que cette puissance étant sienne le rendît redoutable à ses voisins ; mais, comme cet intérêt n’est que secondaire et subordonné, et que les deux suppositions sont incompatibles, il est naturel que les princes donnent la préférence à la maxime qui leur est le plus immédiatement utile.C’est ce que Samuel représentait fortement aux Hébreux : c’est ce que Machiavel a fait voir avec évidence. En feignant de donner des leçons aux rois, il en a donné de grandes aux peuples. Le Prince de Machiavel est le livre des républicains (a). Nous avons trouvé, par les rapports généraux, que la monarchie n’est convenable qu’aux grands États ; et nous le trouverons encore en l’examinant en elle-même. Plus l’administration publique est nombreuse, plus le rapport du prince aux sujets diminue et s’approche de l’égalité, en sorte que ce rapport est un ou l’égalité, même dans la démocratie. Ce même rapport augmente à mesure que le gouvernement se resserre. et il est dans son maximum quand le gouvernement est dans les mains d’un seul. Alors il se trouve une trop grande distance entre le prince et le peuple, et l’État manque de liaison. Pour la former, il faut donc des ordres intermédiaires, il faut des princes, des grands, de la noblesse pour les remplir. Or, rien de tout cela ne convient à un petit État, que ruinent tous ces degrés. Mais s’il est difficile qu’un grand État soit bien gouverné, il l’est beaucoup plus qu’il soit bien gouverné par un seul homme ; chacun sait ce qu’il arrive quand le roi se donne des substituts. Un défaut essentiel et inévitable, qui mettra toujours le gouvernement monarchique au-dessous du républicain, est que dans celui-ci la voix publique n’élève presque jamais aux premières places que des hommes éclairés et capables, qui les remplissent avec honneur ; au lieu que ceux qui parviennent dans les monarchies ne sont le plus souvent que de petits brouillons, de petits fripons, de petits intrigants, à qui les petits talents, qui font dans les cours parvenir aux grands places, ne servent qu’à montrer au public leur ineptie aussitôt qu’ils y sont parvenus. Le peuple se trompe bien moins sur ce choix que le prince ; et un homme d’un vrai mérite est presque aussi rare dans le ministère qu’un sot à la tête d’un gouvernement républicain. Aussi, quand,par quelque heureux hasard, un de ces hommes nés pour gouverner prend le timon des affaires dans une monarchie presque abîmée par ces tas de jolis régisseurs, on est tout surpris des ressources qu’il trouve, et cela fait époque dans un pays. Pour qu’un État monarchique pût être bien gouverné, il faudrait que sa grandeur ou son étendue fût mesurée aux facultés de celui qui gouverne. Il est plus aisé de conquérir que de régir. Avec un levier suffisant, d’un doigt l’on peut ébranler le monde ;mais pour le soutenir il faut les épaules d’Hercule. Pour peu qu’un État soit grand, le prince est presque toujours trop petit. Quand,au contraire, il arrive que l’État est trop petit pour son chef, ce qui est très rare, il est encore mal gouverné, parce que le chef,suivant toujours la grandeur de ses vues, oublie les intérêts des peuples, et ne les rend pas moins malheureux par l’abus des talents qu’il a de trop qu’un chef borné par le défaut de ceux qui lui manquent. Il faudrait, pour ainsi dire, qu’un royaume s’étendît ou se resserrât à chaque règne, selon la portée du prince ; au lieu que, les talents d’un sénat ayant des mesures plus fixes,l’État peut avoir des bornes constantes, et l’administration n’aller pas moins bien. Le plus sensible inconvénient du gouvernement d’un seul est le défaut de cette succession continuelle qui forme dans les deux autres une liaison non interrompue. Un roi mort, il en faut un autre ; les élections laissent des intervalles dangereux ; elles sont orageuses ; et à moins que les citoyens ne soient d’un désintéressement, d’une intégrité que ce gouvernement ne compte guère, la brigue et la corruption s’en mêlent. Il est difficile que celui à qui l’État s’est vendu ne le vende pas à son tour, et ne se dédommage pas sur les faibles de l’argent que les puissants lui ont extorqué. Tôt ou tard tout devient vénal sous une pareille administration, et la paix, dont on jouit alors sous les rois, est pire que le désordre des interrègnes. Qu’a-t-on fait pour prévenir ces maux ? On a rendu les couronnes héréditaires dans certaines familles ; et l’on a établi un ordre de succession qui prévient toute dispute à la mort des rois ; c’est-à-dire que, substituant l’inconvénient des régences à celui des élections, on a préféré une apparente tranquillité à une administration sage, et qu’on a mieux aimé risquer d’avoir pour chefs des enfants, des monstres, des imbéciles, que d’avoir à disputer sur le choix des bons rois. On n’a pas considéré qu’en s’exposant ainsi aux risques de l’alternative, on met presque toutes les chances contre soi.C’était un mot très sensé que celui du jeune Denys à qui son père,en lui reprochant une action honteuse, disait : « T’en ai-je donné l’exemple ? Ah ! répondit le fils, votre père n’était pas roi. » Tout concourt à priver de justice et de raison un homme élevé pour commander aux autres. On prend beaucoup de peine, à ce qu’on dit, pour enseigner aux jeunes princes l’art de régner : il ne paraît pas que cette éducation leur profite. On ferait mieux de commencer par leur enseigner l’art d’obéir. Les plus grands rois qu’ait célébrés l’histoire n’ont point été élevés pour régner ; c’est une science qu’on ne possède jamais moins qu’après l’avoir trop apprise, et qu’on acquiert mieux en obéissant qu’en commandant. « Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarummalarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alioprincipe, aut volueris. » Une suite de ce défaut de cohérence est l’inconstance du gouvernement royal, qui, se réglant tantôt sur un plan et tantôt sur un autre, selon le caractère du prince qui règne ou des gens qui règnent pour lui, ne peut avoir longtemps un objet fixe ni une conduite conséquente ; variation qui rend toujours l’État flottant de maxime en maxime, de projet en projet, et qui n’a pas lieu dans les autres gouvernements, où le prince est toujours le même. Aussi voit-on qu’en général, s’il y a plus de ruse dans une cour, il y a plus de sagesse dans un sénat, et que les républiques vont à leurs fins par des vues plus constantes et mieux suivies ; au heu que chaque révolution dans le ministère en produit une dans l’État, la maxime commune à tous les ministres, et presque à tous les rois, étant de prendre en toute chose le contre-pied de leurs prédécesseurs. De cette même incohérence se tire encore la solution d’un sophisme très familier aux politiques royaux ; c’est non seulement de comparer le gouvernement civil au gouvernement domestique, et le prince au père de famille, erreur déjà réfutée,mais encore de donner libéralement à ce magistrat toutes les vertus dont il aurait besoin, et de supposer toujours que le prince est ce qu’il devrait être : supposition à l’aide de laquelle le gouvernement royal est évidemment préférable à tout autre, parce qu’il est incontestablement le plus fort et que, pour être aussi le meilleur, il ne lui manque qu’une volonté du corps plus conforme à la volonté générale. Mais si, selon Platon (a), le roi par nature est un personnage si rare, combien de fois la nature et la fortune concourront-elles à le couronner ? Et si l’éducation royale corrompt nécessairement ceux qui la reçoivent, que doit-on espérer d’une suite d’hommes élevés pour régner ? C’est donc bien vouloir s’abuser que de confondre le gouvernement royal avec celui d’un bon roi. Pour voir ce qu’est ce gouvernement en lui-même, il faut le considérer sous des princes bornés ou méchants ; car ils arriveront tels au trône, ou le trône les rendra tels. Ces difficultés n’ont pas échappé à nos auteurs ; mais ils n’en sont point embarrassés. Le remède est, disent-ils, d’obéir sans murmure ; Dieu donne les mauvais rois dans sa colère, et il faut les supporter comme des châtiments du ciel. Ce discours est édifiant, sans doute ; mais je ne sais s’il ne conviendrait pas mieux en chaire que dans un livre de politique. Que dire d’un médecin qui promet des miracles, et dont tout l’art est d’exhorter son malade à la patience ? On sait bien qu’il faut souffrir un mauvais gouvernement quand on l’a ; la question serait d’en trouver un bon.Chapitre 7 Des gouvernements mixtes
A proprement parler, il n’y a point de gouvernement simple. Il faut qu’un chef unique ait des magistrats subalternes ; il faut qu’un gouvernement populaire ait un chef. Ainsi, dans le partage de la puissance exécutive, il y a toujours gradation du.grand nombre au moindre, avec cette différence que tantôt le grand nombre dépend du petit, et tantôt le petit du grand. Quelquefois il y a partage égal, soit quand les parties constitutives sont dans une dépendance mutuelle, comme dans le gouvernement d’Angleterre ; soit quand l’autorité de chaque partie est indépendante, mais imparfaite, comme en Pologne. Cette dernière forme est mauvaise, parce qu’il n’y a point d’unité dans le gouvernement, et que l’État manque de liaison. Lequel vaut le mieux d’un gouvernement simple ou d’un gouvernement mixte ? Question fort agitée chez les politiques,et à laquelle il faut faire la même réponse que j’ai faite ci-devant sur toute forme de gouvernement. Le gouvernement simple est le, meilleur en soi, par cela seul qu’il est simple. Mais quand la puissance exécutive ne dépend pas assez de la législative, c’est-à-dire quand il y a plus de rapport du prince au souverain que du peuple au prince, il faut remédier à ce défaut de proportion en divisant le gouvernement ; car alors toutes ses parties n’ont pas moins d’autorité sur les sujets,et leur division les rend toutes ensemble moins fortes contre le souverain. On prévient encore le même inconvénient en établissant des magistrats intermédiaires qui, laissant le gouvernement en son entier, servent seulement à balancer les deux puissances et à maintenir leurs droits respectifs. Alors le gouvernement n’est pas mixte, il est tempéré. On peut remédier par des moyens semblables à l’inconvénient opposé et, quand le gouvernement est trop lâche, ériger des tribunaux pour le concentrer ; cela se pratique dans toutes les démocraties. Dans le premier cas, on divise le gouvernement pour l’affaiblir, et dans le second, pour le renforcer ; car les maximum de force et de faiblesse se trouvent également dans les gouvernements simples, au lieu que les formes mixtes donnent une force moyenne.Chapitre 8 Que toute forme de gouvernement n’est pas propre à tout pays
La liberté, n’étant pas un fruit de tous les climats, n’est pas à la portée de tous les peuples. Plus on médite ce principe établi par Montesquieu plus On en sent la vérité ; plus on le conteste, plus on donne occasion de l’établir par de nouvelles preuves. Dans tous les gouvernements du monde, la personne publique consomme et ne produit rien. D’où lui vient donc la substance consommée ? Du travail de ses membres. C’est le superflu des particuliers qui produit le nécessaire du public. D’où il suit que l’État civil ne peut subsister qu’autant que le travail des hommes rend au-delà de leurs besoins. Or, cet excédent n’est pas le même dans tous les pays du monde.Dans plusieurs il est considérable, dans d’autres médiocre, dans d’autres nul, dans d’autres négatif. Ce rapport dépend de la fertilité du climat, de la sorte de travail que la terre exige, de la nature de ses productions, de la force de ses habitants, de la plus ou moins grande consommation qui leur est nécessaire, et de plusieurs autres rapports semblables desquels il est composé. D’autre part, tous les gouvernements ne sont pas de même nature ; il y en a de plus ou moins dévorants ; et les différences sont fondées sur cet autre principe que, plus les contributions publiques s’éloignent de leur source, et plus elles sont onéreuses. Ce n’est pas sur la quantité des impositions qu’il faut mesurer cette charge, mais sur le chemin qu’elles ont à faire pour retourner dans les mains dont elles sont sorties. Quand cette circulation est prompte et bien établie, qu’on paye peu ou beaucoup, il n’importe, le peuple est toujours riche, et les finances vont toujours bien. Au contraire, quelque peu que le peuple donne, quand ce peu ne lui revient point, en donnant toujours, bientôt il s’épuise : l’État n’est jamais riche et le peuple est toujours gueux. Il suit de là que plus la distance du peuple au gouvernement augmente, et plus les tributs deviennent onéreux : ainsi, dans la démocratie’ le peuple est le moins chargé ; dans l’aristocratie, il l’est davantage ; dans la monarchie, il porte le plus grand poids. La monarchie ne convient donc qu’aux nations opulentes ; L’aristocratie, aux États médiocres en richesse ainsi qu’en grandeur ; la démocratie, aux États petits et pauvres. En effet, plus on y réfléchit, plus on trouve en ceci de différence entre les États libres rit les monarchiques. Dans les premiers, tout s’emploie à l’utilité commune ; dans les autres, les forces publiques et particulières sont réciproques ; et l’une s’augmente par l’affaiblissement de l’autre : enfin, au lieu de gouverner les sujets pour les rendre heureux, le despotisme les rend misérables pour les gouverner. Voilà donc, dans chaque climat, des causes naturelles sur lesquelles on peut assigner la forme de gouvernement à laquelle la force du climat l’entraîne, et dire même quelle espèce d’habitants il doit avoir. Les lieux ingrats et stériles, où le produit ne vaut pas le travail, doivent rester incultes et déserts, ou seulement peuplés de sauvages : les lieux où le travail des hommes ne rend exactement que le nécessaire doivent être habités par des peuples barbares ; toute politise y serait impossible ; les lieux où l’excès du produit sur le travail est médiocre conviennent aux peuples libres ; ceux où le terroir abondant et fertile donne beaucoup de produit pour peu de travail veulent être gouvernés monarchiquement, pour consumer par le luxe du prince l’excès du superflu des sujets ; car il vaut mieux que cet excès soit absorbé par le gouvernement que dissipé par les particuliers. Il y a des exceptions, je le sais ; mais ces exceptions mêmes confirment la règle, en ce qu’elles produisent tôt ou tard des révolutions qui ramènent les choses dans l’ordre de la nature. Distinguons toujours les lois générales des causes particulières qui peuvent en modifier l’effet. Quand tout le Midi serait couvert de républiques, et tout le Nord d’États despotiques, il n’en serait pas moins vrai que, par l’effet du climat, le despotisme convient aux pays chauds, la barbarie aux pays froids, et la bonne politie aux régions intermédiaires. Je vois encore qu’en accordant le principe, on pourra disputer sur l’application : on pourra dire qu’il y a des pays froids très fertiles, et des méridionaux très ingrats. Mais cette difficulté n’en est une que pour ceux qui n’examinent pas la chose dans tous ses rapports. Il faut, comme je l’ai déjà dit, compter sur des travaux, des forces, de la consommation, etc. Supposons que de deux terrains égaux l’un rapporte cinq et l’autre dix. Si les habitants du premier consomment quatre et ceux du dernier neuf, l’excès du premier produit sera un cinquième, et celui du second un dixième. Le rapport de ces deux excès étant donc inverse de celui des produits, le terrain qui ne produira que cinq donnera un superflu double de celui du terrain qui produira dix. Mais il n’est pas question d’un produit double, et je ne crois pas que personne ose mettre en général la fertilité des pays froids en égalité même avec celle des pays chauds. Toutefois supposons cette égalité ; laissons, si l’on veut, en balance l’Angleterre avec la Sicile, et la Pologne avec l’Égypte :plus au midi, nous aurons l’Afrique et les Indes ; plus au nord, nous n’aurons plus rien. Pour cette égalité de produit,quelle différence dans la culturel En Sicile, il ne faut que gratter la terre ; en Angleterre, que de soins pour la labourer ! Or, là où il faut plus de bras pour donner le même produit, le superflu doit être nécessairement moindre. Considérez, outre cela, que la même quantité d’hommes consomme beaucoup moins dans les pays chauds. Le climat demande qu’on y soit sobre pour se porter bien : les Européens qui veulent y vivre comme chez eux périssent tous de dysenterie et d’indigestion. « Nous sommes, dit Chardin, des bêtes carnassières, des loups, en comparaison des Asiatiques. Quelques-uns attribuent la sobriété des Persans à ce que leur pays est moins cultivé et moi, je crois au contraire que leur pays abonde moins en denrées parce qu’il en faut moins aux habitants. Si leur frugalité, continue-t-il, était un effet de la disette du pays, il n’y aurait que les pauvres qui mangeraient peu, au lieu que c’est généralement tout le monde ; et on mangerait plus ou moins en chaque province,selon la fertilité du pays, au lieu que la même sobriété se trouve par tout le royaume. Ils se louent fort de leur manière de vivre,disant qu’il ne faut que regarder leur teint pour reconnaître combien elle est plus excellente que celle des chrétiens. En effet,le teint des Persans est uni, ils ont la peau belle, fine et polie ; au lieu que le teint des Arméniens, leurs sujets, qui vivent à l’européenne, est rude, couperosé, et que leurs corps sont gros et pesants. » Plus on approche de la ligne, plus les peuples vivent de peu.Ils ne mangent presque pas de viande ; le riz, le maïs, le cuzcuz, le mil, la cassave, sont leurs aliments ordinaires. Il y a aux Indes des millions d’hommes dont la nourriture ne coûte pas un sou par jour. Nous voyons en Europe même des différences sensibles pour l’appétit entre les peuples du Nord et ceux du Midi. Un Espagnol vivra huit jours du dîner d’un Allemand. Dans les pays où les hommes sont plus voraces, le luxe se tourne aussi vers les choses de consommation : en Angleterre il se montre sur une table chargée de viandes ; en Italie on vous régale de sucre et de fleurs. Le luxe des vêtements offre encore de semblables différences.Dans les climats où les changements de saisons sont prompts et violents, on a des habits meilleurs et plus simples ; dans ceux où l’on ne s’habille que pour la parure, on y cherche plus d’éclat que d’utilité ; les habits eux-mêmes y sont un luxe. À Naples, vous verrez tous les jours se promener, au Pausilippe des hommes en veste dorée, et point de bas. C’est la même chose pour les bâtiments : on donne tout à la magnificence quand on n’a rien à craindre des injures de l’air. À Paris, à Londres, on veut être logé chaudement et commodément ; à Madrid, en a dessalons superbes, mais point de fenêtres qui ferment, et l’on couche dans des nids à rats. Les aliments sont beaucoup plus substantiels et succulents dans les pays chauds ; c’est une troisième différence qui ne peut manquer d’influer sur la seconde. Pourquoi mange-t-on tant de légumes en Italie ? Parce qu’ils y sont bons, nourrissants,d’excellent goût. En France, où ils ne sont nourris que d’eau, ils ne nourrissent point, et sont presque comptés pour rien sur les tables ; ils n’occupent pourtant pas moins de terrain et coûtent du moins autant de peine à cultiver. C’est une expérience faite que les blés de Barbarie, d’ailleurs inférieurs à ceux de France, rendent beaucoup plus en farine et que ceux de France, à leur tour, rendent plus que les blés du Nord. D’où l’on peut inférer qu’une gradation semblable s’observe généralement dans la même direction de la ligne au pôle. Or, n’est-ce pas un désavantage visible d’avoir dans un produit égal une moindre quantité d’aliments ? A toutes ces différentes considérations, j’en puis ajouter une qui en découle et qui les fortifie ; c’est que les pays chauds ont moins besoin d’habitants que les pays froids, et pourraient en nourrir davantage ; ce qui produit un double superflu toujours à l’avantage du despotisme. Plus le même nombre d’habitants occupe une grande surface, plus les révoltes deviennent difficiles, parce qu’on ne peut se concerter ni promptement ni secrètement, et qu’il est toujours facile au gouvernement d’éventer les projets et de couper les communications. Mais plus un peuple nombreux se rapproche, moins le gouvernement peut usurper sur le souverain ; les chefs délibèrent aussi, sûrement dans leurs chambres que le prince dans son conseil, et la foule s’assemble aussitôt dans les places que les troupes dans leurs quartiers.L’avantage d’un gouvernement tyrannique est donc en ceci d’agir à grandes distances. À l’aide des points d’appui qu’il se donne, sa force augmente au loin comme celle des leviers (a). Celle du peuple, au contraire, n’agit que concentrée ; elle s’évapore et se perd en s’étendant, comme l’effet de la poudre éparse à terre, et qui ne prend feu que grain à grain. Les pays les moins peuplés sont ainsi les plus propres à la tyrannie ; les bêtes féroces ne règnent que dans les déserts.Chapitre 9 Des signes d’un bon gouvernement
Quand donc on demande absolument quel est le meilleur gouvernement, on fait une question insoluble comme indéterminée ; ou, si l’on veut, elle a autant de bonnes solutions qu’il y a de combinaisons possibles dans les positions absolues et relatives des peuples. Mais si l’on demandait à quel signe on peut connaître qu’un peuple donné est bien ou mal gouverné, ce serait autre chose, et la question de fait pourrait se résoudre. Cependant on ne la résout point, parce que chacun veut la résoudre à sa manière. Les sujets vantent la tranquillité publique,les citoyens la liberté des particuliers ; l’un préfère la sûreté des possessions, et l’autre celle des personnes ; l’un veut que le meilleur gouvernement soit le plus sévère, l’autre soutient que c’est le plus doux ; celui-ci veut qu’on punisse les crimes, et celui-là qu’on les prévienne ; l’un trouve beau qu’on soit craint des voisins, l’autre aime mieux qu’on en soit ignoré ; l’un est content quand l’argent circule, l’autre exige que le peuple ait du pain. Quand même on conviendrait sur ces points et d’autres semblables, en serait-on plus avancé ? Les qualités morales manquant de mesure précise, fût-on d’accord sur le signe, comment l’être sur l’estimation ? Pour moi, je m’étonne toujours qu’on méconnaisse un signe aussi simple, ou qu’on ait la mauvaise foi de n’en pas convenir. Quelle est la fin de l’association politique ? C’est la conservation et la prospérité de ses membres. Et quel est le signe le plus sûr qu’ils se conservent et prospèrent ? C’est leur nombre et leur population. N’allez donc pas chercher ailleurs ce signe si disputé.Toute chose d’ailleurs égale, le gouvernement sous lequel, sans moyens étrangers, sans naturalisation, sans colonies, les citoyens peuplent et multiplient davantage, est infailliblement le meilleur.Celui sous lequel un peuple diminue et dépérit est le pire.Calculateurs, c’est maintenant votre affaire ; comptez,mesurez, comparez (a).Chapitre 10 De l’abus du gouvernement et de sa pente à dégénérer
Comme la volonté particulière agit sans cesse contre la volonté générale, ainsi le gouvernement fait un effort continuel contre la souveraineté. Plus cet effort augmente, plus la constitution s’altère ; et comme il n’y a point ici d’autre volonté de corps qui, résistant à celle du prince, fasse équilibre avec elle,il doit arriver tôt ou tard que le prince opprime enfin le souverain et rompe le traité social. C’est là le vice inhérent, et inévitable qui, dès la naissance du corps politique, tend sans relâche à le détruire, de même que la vieillesse et la mort détruisent enfin le corps de l’homme. Il y a deux voies générales par lesquelles un gouvernement dégénère : savoir, quand il se resserre, ou quand l’État se dissout. Le gouvernement se resserre quand il passe du grand nombre au petit, c’est-à-dire de la démocratie à l’aristocratie, et de l’aristocratie à la royauté. C’est là son inclinaison naturelle(a). S’il rétrogradait du petit nombre au grand, on pourrait dire qu’il se relâche mais ce progrès inverse est impossible. En effet, jamais le gouvernement ne change de forme que quand son ressort usé le laisse trop affaibli pour pouvoir conserver la sienne. Or, s’il se relâchait encore en s’étendant, sa force deviendrait tout à fait nulle, et il subsisterait encore moins. Il faut donc remonter et serrer le ressort à mesure qu’il cède ;autrement l’État qu’il soutient tomberait en ruine. Le cas de la dissolution de l’État peut arriver de deux manières. Premièrement, quand le prince n’administre plus l’État selon les lois, et qu’il usurpe le pouvoir souverain. Alors il se fait un changement remarquable ; c’est que, non pas le gouvernement,mais l’État se resserre ; je veux dire que le grand État se dissout, et qu’il s’en forme un autre dans celui-là, composé seulement des membres du gouvernement, et qui n’est plus rien au reste du peuple que son maître et son tyran. De sorte qu’à l’instant que le gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte social est rompu ; et tous les simples citoyens, rentrés de droit dans leur liberté naturelle, sont forcés, mais non pas obligés d’obéir. Le même cas arrive aussi quand les membres du gouvernement usurpent séparément le pouvoir qu’ils ne doivent exercer qu’en corps ; ce qui n’est pas une moindre infraction des lois, et produit encore un plus grand désordre. Alors on a, pour ainsi dire,autant de princes que de magistrats ; et l’État, non moins divisé que le gouvernement, périt ou change de forme. Quand l’État se dissout, l’abus du gouvernement, quel qu’il soit, prend le nom commun d’anarchie. En distinguant, la démocratie dégénère en ochlocratie 1, l’aristocratie en oligarchie :j’ajouterais que la royauté dégénère en tyrannie, mais ce dernier mot est équivoque et demande explication. Dans le sens vulgaire, un tyran est un roi qui gouverne avec violence et sans égard à la justice et aux lois. Dans le sens précis, un tyran est un particulier qui s’arroge l’autorité royale sans y avoir droit. C’est ainsi que les Grecs entendaient ce mot de tyran ; ils le donnaient indifféremment aux bons et aux mauvais princes dont l’autorité n’était pas légitime (a). Ainsi tyran et usurpateur sont deux mots parfaitement synonymes. Pour donner différents noms à différentes choses, j’appelle tyran l’usurpateur de l’autorité royale, et despote l’usurpateur du pouvoir souverain. Le tyran est celui qui s’ingère contre les lois à gouverner selon les lois ; le despote est celui qui se met au-dessus des lois mêmes. Ainsi le tyran peut n’être -pas despote,mais le despote est toujours tyran.Chapitre 11 De la mort du corps politique
Telle est la pente naturelle et inévitable des gouvernements les mieux constitués. Si Sparte et Rome ont péri, quel État peut espérer de durer toujours ? Si nous voulons former un établissement durable, ne songeons donc point à le rendre éternel.Pour réussir il ne faut pas tenter l’impossible, ni se flatter de donner à l’ouvrage des hommes une solidité que les choses humaines ne comportent pas. Le corps politique, aussi bien que le corps de l’homme, commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa destruction. Mais l’un et l’autre peut avoir une constitution plus ou moins robuste et propre à le conserver plus ou moins longtemps.La constitution de l’homme est l’ouvrage de la nature ; celle de l’État est l’ouvrage de l’art. Il ne dépend pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend d’eux de prolonger celle de l’État aussi loin qu’il est possible, en lui donnant la meilleure constitution qu’il puisse avoir. Le mieux constitué finira, mais plus tard qu’un autre, si nul accident imprévu n’amène sa perte avant le temps. Le principe de la vie politique est dans l’autorité souveraine.La puissance législative est le cœur de l’État, la puissance exécutive en est le cerveau, qui donne le mouvement à toutes les parties. Le cerveau peut tomber en paralysie et l’individu vivre encore. Un homme reste imbécile et vit ; mais sitôt que le cœur a cessé ses fonctions, l’animal est mort. Ce n’est point par les lois que l’État subsiste, c’est par le pouvoir législatif. La loi d’hier n’oblige pas aujourd’hui :mais le consentement tacite est présumé du silence, et le souverain est censé confirmer incessamment les lois qu’il n’abroge pas,pouvant le faire. Tout ce qu’il a déclaré vouloir une fois, il le veut toujours, à moins qu’il ne le révoque. Pourquoi donc porte-t-on tant de respect aux anciennes lois ? C’est pour cela même. On doit croire qu’il n’y a que l’excellence des volontés antiques qui les ait pu conserver si longtemps ; si le souverain ne les eût reconnues constamment salutaires, il les eût mille fois révoquées. Voilà pourquoi, loin de s’affaiblir, les lois acquièrent sans cesse une force nouvelle dans tout État bien constitué ; le préjugé de l’antiquité les rend chaque jour plus vénérables : au heu que partout où les lois s’affaiblissent en vieillissant, cela prouve qu’il n’y a plus de pouvoir législatif, et que l’État ne vit plus.Chapitre 12 Comment se maintient l’autorité souveraine
Le souverain, n’ayant d’autre force que la puissance législative, n’agit que par des lois ; et les lois n’étant que des actes authentiques de la volonté générale, le souverain ne saurait agir que quand le peuple est assemblé. Le peuple assemblé,dira-t-on, quelle chimère ! C’est une chimère aujourd’hui ; mais ce n’en était pas une il y a deux mille ans. Les hommes ont-ils changé de nature ? Les bornes du possible, dans les choses morales, sont moins étroites que nous ne pensons ; ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés, qui les rétrécissent. Les âmes basses ne croient point aux grands hommes : de vils esclaves sourient d’un air moqueur à ce mot de liberté. Par ce qui s’est fait, considérons ce qui peut se faire. Je ne parlerai pas des anciennes républiques de la Grèce ; mais la république romaine était, ce me semble, un grand État et la ville de Rome une grande ville. Le dernier cens donna dans Rome quatre cent mille citoyens portant armes, et le dernier dénombrement de l’empire plus de quatre millions de citoyens, sans compter les sujets, les étrangers, les femmes, les enfants, les esclaves. Quelle difficulté n’imaginerait-on pas d’assembler fréquemment le peuple immense de cette capitale et de ces environs !Cependant, il se passait peu de semaines que le peuple romain ne fût assemblé, et même plusieurs fois. Non seulement il exerçait les droits de la souveraineté, mais une partie de ceux du gouvernement.Il traitait certaines affaires, il jugeait certaines causes, et tout ce peuple était sur la place publique presque aussi souvent magistrat que citoyen. En remontant aux premiers temps des nations, on trouverait que la plupart des anciens gouvernements, même monarchiques, tels que ceux des Macédoniens et des Francs, avaient de semblables conseils.Quoi qu’il en soit, ce seul fait incontestable répond à toutes les difficultés : de l’existant au possible la conséquence me paraît bonne.Chapitre 13 Suite
Il ne suffit pas que le peuple assemblé ait une fois fixé la constitution de l’État en donnant la sanction à un corps de lois’. il ne suffit pas qu’il ait établi un gouvernement perpétuel, ou qu’il ait pourvu une fois pour toutes à l’élection des magistrats ; outre les assemblées extraordinaires que des cas imprévus peuvent exiger, il faut qu’il y en ait de fixes et de périodiques que rien ne puisse abolir ni proroger, tellement qu’au jour marqué le peuple soit légitimement convoqué par la loi, sans qu’il soit besoin pour cela d’aucune autre convocation formelle. Mais, hors de ces assemblées juridiques par leur seule date,toute assemblée du peuple qui n’aura pas été convoquée par les magistrats préposés à cet effet, et selon les formes prescrites,doit être tenue pour illégitime, et tout ce qui s’y fait pour nul,parce que l’ordre même de s’assembler doit émaner de la loi. Quant aux retours plus ou moins fréquents des assemblées légitimes, ils dépendent de tant de considérations qu’on ne saurait donner là-dessus de règles précises. Seulement, on peut dire en général que plus le gouvernement a de force, plus le souverain doit se montrer fréquemment. Ceci, me dira-t-on, peut-être bon pour une seule ville ;mais que faire quand l’État en comprend plusieurs ?Partagera-t-on l’autorité souveraine ? au bien doit-on la concentrer dans une seule ville et assujettir tout le reste ? Je réponds qu’on ne doit faire ni l’un ni l’autre. Premièrement,l’autorité souveraine est simple et une, et l’on ne peut la diviser sans la détruire, En second lieu, une ville, non plus qu’une nation., ne peut être légitimement sujette d’une autre, parce que l’essence du corps politique est dans l’accord de l’obéissance et de la liberté, et que ces mots de sujet et de souverain sont des corrélations identiques dont l’idée se réunit sous le seul mot de citoyen. Je réponds encore que c’est toujours un mal d’unir plusieurs villes en une seule cité et que, voulant faire cette union, l’on ne doit pas se flatter d’en éviter les inconvénients naturels. Il ne faut point objecter l’abus des grands États à celui qui n’en veut que de petits. Mais comment donner aux petits États assez de force pour résister aux grands ? comme jadis les villes grecques résistèrent au grand roi, et comme plus récemment la Hollande et la Suisse ont résisté à la maison d’Autriche. Toutefois, si l’on ne peut réduire l’État à de justes bornes, il reste encore une ressource ; c’est de n’y point souffrir de capitale, de faire siéger le gouvernement alternativement dans chaque ville, et d’y rassembler aussi tour à tour les états du pays. Peuplez également le territoire, étendez-y partout les mêmes droits, portez-y partout l’abondance et la vie ; c’est ainsi que l’État deviendra tout à la fois le plus fort et le mieux gouverné qu’il soit possible. Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du débris des maisons des champs. À chaque palais que je vois élever dans la capitale, je crois voir mettre en masures tout un pays.Chapitre 14 Suite
A l’instant que le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance exécutive est suspendue, et la personne du dernier citoyen est aussi sacrée et inviolable que celle du premier magistrat, parce qu’ où se trouve le représenté il n’y a plus de représentants. La plupart des tumultes qui s’élevèrent à Rome dans les comices vinrent d’avoir ignoré ou négligé cette règle. Les consuls alors n’étaient que les présidents du peuple ; les tribuns de simples orateurs (a) : le sénat n’était rien du tout. Ces intervalles de suspension où le prince reconnaît ou doit reconnaître un supérieur actuel, lui ont toujours été redoutables ; et ces assemblées du peuple, qui sont l’égide du corps politique et le frein du gouvernement, ont été de tout temps l’horreur des chefs : aussi n’épargnent-ils jamais ni soins,ni objections, mi difficultés, ni promesses, pour en rebuter les citoyens. Quand ceux-ci sont avares, tâches, pusillanimes, plus amoureux du repos que de la liberté, ils ne tiennent pas longtemps contre les efforts redoublés du gouvernement : c’est ainsi que, la force résistante augmentant sans cesse, l’autorité souveraine s’évanouit à la fin, et que la plupart des cités tombent et périssent avant le temps. Mais entre l’autorité souveraine et le gouvernement arbitraire,il s’introduit quelquefois un pouvoir moyen dont il faut parler.Chapitre 15 Des députés ou représentants
Sitôt que le service public cesse d’être la principale affaire des citoyens, et qu’ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l’État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? ils payent des troupes et restent chez eux ;faut-il aller au conseil ? ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d’argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie, et des représentants pour la vendre. C’est le tracas du commerce et des arts, c’est l’avide intérêt du gain, c’est la mollesse et l’amour des commodités, qui changent les services personnels en argent. On cède une partie de son profit pour l’augmenter à son aise. Donnez de l’argent, et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d’esclave, il est inconnu dans la cité. Dans un pays vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras, et rien avec de l’argent ; loin de payer pour s’exempter de leurs devoirs, ils payeraient pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien loin des idées communes ; je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes. Mieux l’État est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur les privées, dans l’esprit des citoyens. Il y a même beaucoup moins d’affaires privées, parce que la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considérable à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. Dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées ; sous un mauvais gouvernement, nul n’aime à faire un pas pour s’y rendre, parce que nul ne prend intérêt à ce qui s’y fait, qu’on prévoit que la volonté générale n’y dominera pas, et qu’enfin les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amènent de pires. Sitôt que quelqu’un dit des affaires de l’État : Que m’importe ? on doit compter que l’État est perdu. L’attiédissement de l’amour de la patrie, l’activité de l’intérêt privé, l’immensité des États, les conquêtes, l’abus du gouvernement, ont fait imaginer la voie des députés ou représentants du peuple dans les assemblées de la nation. C’est ce qu’en certain pays on ose appeler le tiers état. Ainsi l’intérêt particulier de deux ordres est mis au premier et second rang ;l’intérêt public n’est qu’au troisième. La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point :elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi.Le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement : sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il en fait mérite bien qu’il la perde. L’idée des représentants est moderne : elle nous vient du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l’espèce humaine est dégradée, et où le nom d’homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques, et même dans les monarchies, jamais le peuple n’eut des représentants ; en ne connaissait pas ce mot-là. Il est très singulier qu’à Rome, où les tribuns étaient si sacrés, on n’ait pas même imaginé qu’ils pussent usurper les fonctions du peuple, et qu’au milieu d’une si grande multitude ils n’aient jamais tenté de passer de leur chef un seul plébiscite. Qu’on juge cependant de l’embarras que causait quelquefois la foule par ce qui arriva du temps des Gracques, où une partie des citoyens donnait son suffrage de dessus les toits. Où le droit et la liberté sont toutes choses, les inconvénients ne sont rien. Chez ce sage peuple tout était mis à sa juste mesure : il laissait faire à ses licteurs ce que ses tribuns n’eussent osé faire ; il ne craignait pas que ses licteurs voulussent le représenter. Pour expliquer cependant comment les tribuns le représentaient quelquefois, il suffit de concevoir comment le gouvernement représente le souverain. La loi n’étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que, dans la puissance législative,le peuple ne peut être représenté ; mais il peut et doit l’être dans la puissance exécutive, qui n’est que la force appliquée à la loi. Ceci fait voir qu’en examinant bien les choses on trouverait que très peu de nations ont des lois. Quoi qu’il en soit, il est sûr que les tribuns, n’ayant aucune partie du pouvoir exécutif, ne purent jamais représenter le peuple romain par les droits de leurs charges, mais seulement en usurpant sur ceux du sénat. Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même : il était sans cesse assemblé sur la place. Il habitait un climat doux ; il n’était point avide ; des esclaves faisaient ses travaux ; sa grande affaire était sa liberté. N’ayant plus les mêmes avantages, comment conserver les mêmes droits ? Vos climats plus durs vous donnent plus de besoins (a) : six mois de l’année la place publique n’est pas tenable ; vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en plein air ; vous donnez plus à votre gain qu’à votre liberté, et vous craignez bien moins l’esclavage que la misère. – Quoi ! la liberté ne se maintient qu’à l’appui de la servitude ? Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout ce qui n’est point dans la nature a ses inconvénients, et la société civile plus que tout le reste. Il y a telles positions malheureuses où l’on ne peut conserver sa liberté qu’aux dépens de celle d’autrui, et où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l’esclave ne soit extrêmement esclave. Telle était la position de Sparte. Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves,mais vous l’êtes ; vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j’y trouve plus de lâcheté que d’humanité. Je n’entends point par tout cela qu’il faille avoir des esclaves, ni que le droit d’esclavage soit légitime, puisque j’ai prouvé le contraire : je dis seulement les raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient libres ont des représentants,et pourquoi les peuples anciens n’en avaient pas. Quoi qu’il en soit, à l’instant qu’un peuple se donne des représentants, il n’est plus libre ; il n’est plus. Tout bien examiné, je ne vois pas qu’il soit désormais possible au souverain de conserver parmi nous l’exercice de ses droits, si la cité n’est très petite. Mais si elle est très petite, elle sera subjuguée ? Non. Je ferai voir ci-après (a) comment on peut réunir la puissance extérieure d’un grand peuple avec la police aisée et le bon ordre d’un petit État.Chapitre 16 Que l’institution du gouvernement n’est point un contrat
Le pouvoir législatif une fois bien établi il s’agit d’établir de même le pouvoir exécutif ; car ce dernier, qui n’opère que par des actes particuliers, n’étant pas de l’essence de l’autre, en est naturellement séparé. S’il était possible que le souverain,considéré comme tel, eût la puissance exécutive, le droit et le fait seraient tellement confondus, qu’on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l’est pas ; et le corps politique, ainsi dénaturé, serait bientôt en proie à la violence contre laquelle il fut institué. Les citoyens étant tous égaux par le contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n’a droit d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas lui-même. Or, c’est proprement ce droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le corps politique, que le souverain donne au prince en instituant le gouvernement. Plusieurs ont prétendu que l’acte de cet établissement était un contrat entre le peuple et les chefs qu’il se donne, contrat par lequel on stipulait entre les deux parties des conditions sous lesquelles l’une s’obligeait à commander et l’autre à obéir. On conviendra, je m’assure, que voilà une étrange manière de contracter. Mais voyons si cette opinion est soutenable. Premièrement, l’autorité suprême ne peut pas plus se modifier que s’aliéner ; la limiter, c’est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supérieur ;s’obliger d’obéir à un maître, c’est se remettre en pleine liberté. De plus, il est évident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes serait un acte particulier ; d’où il suit que ce contrat ne saurait être une loi ni un acte de souveraineté, et que par conséquent il serait illégitime. On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manières à l’état civil : celui qui a la force en main étant toujours le maître de l’exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat à l’acte d’un homme qui dirait à un autre : « Je vous donne tout mon bien, à condition que vous m’en rendrez ce qu’il vous plaira. » Il n’y a qu’un contrat dans l’État, c’est celui de l’association : celui-là seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne fût une violation du premier.Chapitre 17 De l’institution du gouvernement
Sous quelle idée faut-il donc concevoir l’acte par lequel le gouvernement est institué ? Je remarquerai d’abord que cet acte est complexe, ou composé de deux autres, savoir :l’établissement de la loi et l’exécution de la loi. Par le premier, le souverain statue qu’il y aura un corps de gouvernement établi sous telle ou telle forme ; et il est clair que cet acte est une loi. Par le second, le peuple nomme les chefs qui seront chargés du gouvernement établi. Or cette nomination, étant un acte particulier, n’est pas une seconde loi, mais seulement une suite de la première et une fonction du gouvernement. La difficulté est d’entendre comment on peut avoir un acte de gouvernement avant que le gouvernement existe, et comment le peuple, qui n’est que souverain ou sujet, peut devenir prince ou magistrat dans certaines circonstances. C’est encore ici que se découvre une de ces étonnantes propriétés du corps politique, par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence ; car celle-ci se fait par une conversion subite de la souveraineté en démocratie, en sorte que, sans aucun changement sensible, et seulement par une nouvelle relation de tous à tous, les citoyens, devenus magistrats,passent des actes généraux aux actes particuliers, et de la loi à l’exécution. Ce changement de relation n’est point une subtilité de spéculation sans exemple dans la pratique : il a lieu tous les jours dans le parlement d’Angleterre, où la chambre basse, en certaines occasions, se tourne en grand comité, pour mieux discuter les affaires, et devient ainsi simple commission, de cour souveraine qu’elle était l’instant précédent ; en telle sorte qu’elle se fait ensuite rapport à elle-même, comme chambre des communes, de ce qu’elle vient de régler en grand comité, et délibère de nouveau sous un titre de ce qu’elle a déjà résolu sous un autre. Tel est l’avantage propre au gouvernement démocratique, de pouvoir être établi dans le fait par un simple acte de la volonté générale. Après quoi ce gouvernement provisionnel reste en possession, si telle est la forme adoptée, ou établit au nom du souverain le gouvernement prescrit par la loi ; et tout se trouve ainsi dans la règle. Il n’est pas possible d’instituer le gouvernement d’aucune autre manière légitime et sans renoncer aux principes ci-devant établis.Chapitre 18 Moyens de prévenir les usurpations du gouvernement
De ces éclaircissements il résulte, en confirmation du chapitre XVI, que l’acte qui institue le gouvernement n’est point un contrat, mais une loi ; que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses officiers ; qu’il peut les établir et les destituer quand il lui plaît ; qu’il n’est point question pour eux de contracter,mais d’obéir ; et qu’en se chargeant des fonctions que l’État leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyens sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions. Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n’est point un engagement qu’il prend : c’est une forme provisionnelle qu’il donne à l’administration, jusqu’à ce qu’il lui plaise d’en ordonner autrement. Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu’il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu’il devient incompatible avec le bien public : mais cette circonspection est une maxime de politique, et non pas une règle de droit ; et l’État n’est pas plus tenu de laisser l’autorité civile à ses chefs, que l’autorité militaire à ses généraux. Il est vrai encore qu’on ne saurait, en pareil cas, observer avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d’un tumulte séditieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d’une faction. C’est ici surtout qu’il ne faut donner au cas odieux que ce qu’on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit ; et c’est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple, sans qu’on puisse dire qu’il l’ait usurpée ;car, en paraissant n’user que de us droits, il lui est fort aisé de les étendre, et d’empêcher, sous le prétexte du repos publie, les assemblées destinées à rétablir le bon ordre ; de sorte qu’il se prévaut d’un silence qu’il empêche de rompre, ou des irrégularités qu’il fait commettre, pour supposer en sa faveur l’aveu de ceux que la crainte fait taire et pour punir ceux qui osent parler. C’est ainsi que les décemvirs, ayant d’abord été élus pour un an, puis continués pour une autre année, tentèrent de retenir à perpétuité leur pouvoir, en ne permettant plus aux comices de s’assembler ; et c’est par ce facile moyen que tous les gouvernements du monde, une fois revêtus de la force publique,usurpent tôt ou tard l’autorité souveraine. Les assemblées périodiques, dont j’ai parlé ci-devant, sont propres à prévenir ou différer ce malheur, surtout quand elles n’ont pas besoin de convocation formelle ; car alors le prince ne saurait les empêcher sans se déclarer ouvertement infracteur des lois et ennemi de l’État. L’ouverture de ces assemblées, qui n’ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer, et qui passent séparément par les suffrages. La première : « S’il plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement. » La seconde : « S’il plaît au peuple d’en laisser l’administration à ceux qui en sont actuellement chargés. » Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir, qu’il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer,non pas même le pacte social ; car si tous les citoyens s’assemblaient pour rompre ce pacte d’un commun accord, on ne peut douter qu’il ne fût très légitimement rompu. Grotius pense même que chacun peut renoncer à l’État dont il est membre, et reprendre sa liberté naturelle et ses biens en sortant du pays (a). Or il serait absurde que tous les citoyens réunis ne pussent pas ce que peut séparément chacun d’eux.Partie 4
Chapitre 1Que la volonté générale est indestructible
Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n’ont qu’une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général. Alors tous les ressorts de l’État sont vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses il n’a point d’intérêts embrouillés, contradictoires le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être aperçu. La paix, l’union, l’égalité, sont ennemies des subtilités politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité : les leurres, les prétextes raffinés ne leur en imposent point, ils ne sont pas même assez fins pour être dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans régler les affaires de l’État sous un chêne et se conduire toujours sagement,peut-on s’empêcher de mépriser les raffinements des autres nations,qui se rendent illustres et misérables avec tant d’art et de mystère ? Un État ainsi gouverné a besoin de très peu de lois et, à mesure qu’il devient nécessaire d’en promulguer de nouvelles, cette nécessité se voit universellement. Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont déjà senti, et il n’est question ni de brigues ni d’éloquence pour faire passer en loi ce que chacun a déjà résolu de faire, sitôt qu’il sera sûr que les autres le feront comme lui. Ce qui trompe les raisonneurs, c’est que, ne voyant que des États mal constitués dès leur origine, ils sont frappés de l’impossibilité d’y maintenir une semblable police ; ils rient d’imaginer toutes les sottises qu’un fourbe adroit, un parleur insinuant pourrait persuader au peuple de Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que Cromwell eût été nus aux son. nettes par le peuple de Berne, et le duc de Beaufort à la discipline par les Genevois. Mais quand le nœud social commence à se relâcher et l’État à s’affaiblir, quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir et les petites sociétés à influer sur la grande, l’intérêt commun s’altère et trouve des opposants : l’unanimité ne règne plus dans les voix ; la volonté générale n’est plus la volonté de tous ; il s’élève des contradictions, des débats ; et le meilleur avis ne passe point sans disputes. Enfin, quand l’État, près de sa ruine, ne subsiste plus que par une forme illusoire et vaine, que le lien social est rompu dans tous les cœurs, que le plus vil intérêt se pare effrontément du nom sacré du bien public, alors la volonté générale devient muette ; tous, guidés par des motifs secrets, n’opinent pas plus comme citoyens que si l’État n’eût jamais existé ; et l’on fait passer faussement sous le nom de lois des décrets iniques qui n’ont pour but que l’intérêt particulier. S’ensuit-il de là que la volonté générale soit anéantie ou corrompue ? Non : elle est toujours constante,inaltérable et pure ; mais elle est subordonnée à d’autres qui l’emportent sur elle. Chacun, détachant son intérêt de l’intérêt commun, voit bien qu’il ne peut l’en séparer tout à fait ;mais sa part du mal public ne lui paraît rien auprès du bien exclusif qu’il prétend s’approprier. Ce bien particulier excepté,il veut le bien général pour son propre intérêt, tout aussi fortement qu’aucun autre. Même en vendant son suffrage à prix d’argent, il n’éteint pas en lui la volonté générale, il l’élude.La faute qu’il commet est de changer l’état de la question et de répondre autre chose que ce qu’on lui demande ; en sorte qu’au lieu de dire, par un suffrage : « Il est avantageux à l’État »,il dit : « Il est avantageux à tel homme ou a tel parti que tel ou tel avis passe. » Ainsi la loi de l’ordre public dans les assemblées n’est pas tant d’y maintenir la volonté générale que de faire qu’elle soit toujours interrogée et qu’elle réponde toujours. J’aurais ici bien des réflexions à faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter aux citoyens ; et sur celui d’opiner, de proposer, de diviser,de discuter. que le gouvernement a toujours grand soin de ne laisser qu’à su membres ; mais cette importante matière demanderait un traité à part, et je ne puis tout dire dans celui-ci. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Salomé ATTIA le 15 Juillet 2015 à 10:25
La Fée aux Miettes
Charles Nodier
LA FÉE AUX MIETTES
1832
À M. FLAVIEN DE MAGNONCOURT,
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,
Maire de Besançon.
Cher Flavien,
Je n’ai jamais dédié mes livres qu’à mes amis. Recevez celui-ci, qui n’est peut-être pas le moindre, puisqu’il a été deux fois imprimé, deux fois contrefait, deux fois traduit, et que les journaux n’en ont rien dit.
Et puis, ne le lisez pas ; mais aimez-le pour l’amour de moi.
CHARLES NODIER,
DE BESANÇON.
AU LECTEUR
QUI LIT LES PRÉFACES.Je vous déclare, mon ami, et qui que vous soyez, je vous donne ce nom, selon toute apparence, avec une affection plus sincère et plus désintéressée qu’aucun homme dont vous l’ayez jamais reçu ; je vous déclare, dis-je, qu’après le plaisir de faire quelque chose qui vous soit agréable, je n’en ai point ressenti d’aussi vif que celui de lire, d’entendre raconter, ou de raconter moi-même une histoire fantastique.
C’est donc à mon grand regret, que je me suis aperçu depuis longtemps qu’une histoire fantastique manquait de la meilleure partie de son charme quand elle se bornait à égayer l’esprit, comme un feu d’artifice, de quelques émotions passagères, sans rien laisser au cœur. Il me semblait que la meilleure partie de son effet était dans l’âme, et comme c’est là, en vérité, l’idée dont je me suis le plus sérieusement occupé toute ma vie, il s’en va sans dire qu’elle devait infailliblement me conduire à faire une sottise, parce que c’est un résultat auquel je n’échappe jamais quand je raisonne.
La sottise dont il est question cette fois-ci est intitulée : la Fée aux Miettes.
Je vais vous dire maintenant pourquoi la Fée aux Miettes est une sottise, afin de vous épargner trois ennuis assez fâcheux : celui de me le dire vous-même après l’avoir lue ; celui de chercher les raisons de votre mauvaise humeur dans un journal ; et jusqu’à celui de feuilleter le livre au lieu de le jeter au vieux papier, pour votre honneur et pour le mien, à côté du Roi de Bohême, avant d’avoir attenté du tranchant de votre couteau d’ébène à la pureté de ses marges toujours vierges.
Notez bien toutefois que je vous engage à ne pas commencer, et non à ne pas finir, ce qui serait une précaution de luxe, à moins que votre mauvaise destinée ne vous ait condamné comme moi à l’intolérable métier de lire des épreuves, ou au métier plus intolérable encore d’analyser des romans !
Allez maintenant ! et prenez pitié de moi, refrain de litanies qui n’est pas commun dans les préfaces.
J’ai dit souvent que je détestais le vrai dans les arts, et il m’est avis que j’aurais peine à changer d’avis ; mais je n’ai jamais porté le même jugement du vraisemblable et du possible, qui me paraissent de première nécessité dans toutes les compositions de l’esprit. Je consens à être étonné ; je ne demande pas mieux que d’être étonné, et je crois volontiers ce qui m’étonne le plus, mais je ne veux pas que l’on se moque de ma crédulité, parce que ma vanité entre alors en jeu dans mon impression, et que notre vanité est, entre nous, le plus sévère des critiques. Je n’ai pas douté un instant, sur la foi d’Homère, de la difforme réalité de son Polyphème, type éternel de tous les ogres, et je conçois à merveille le loup doctrinaire d’Ésope, qui l’emportait, au moins en naïveté diplomatique, sur les fins politiques de nos cabinets, du temps où les bêtes parlaient, ce qui ne leur arrive plus quand elles ne sont pas éligibles. M. Dacier et le bon La Fontaine y croyaient comme moi, et je n’ai pas de raisons pour être plus difficile qu’eux en hypothèses historiques. Mais si l’on rapproche l’événement des jours où j’ai vécu, et qu’on m’en affronte d’un ton railleur à travers de brillantes théories d’artiste, de poète et de philosophe, je m’imagine tout d’abord qu’on imagine ce qu’on me raconte, et me voilà malgré moi en garde contre la séduction de mes croyances. À compter de ce moment-là, je ne m’amuse qu’à contre-cœur, et je deviens ce que vous êtes peut-être déjà pour moi, un lecteur défiant, maussade et mal intentionné, vu que je ne sais pas à quoi sert la lecture, si ce n’est à amuser ceux qui lisent. Ce n’est probablement pas à les instruire ou à les rendre meilleurs. Regardez plutôt.
Permettez-moi, mon ami, de vous présenter cette pensée sous un aspect plus sensible, dans un exemple. Quand je courais doucement ma vingt-cinquième année entre les romans et les papillons, l’amour et la poésie, dans un pauvre et joli village du Jura, que je n’aurais jamais dû quitter, il y avait peu de soirées que je n’allasse passer avec délices chez le patriarche de mon cher Quintigny, bon et vénérable nonagénaire qui s’appelait Joseph Poisson. Dieu ait cette belle âme en sa digne garde ! Après l’avoir salué d’un serrement de main filial, je m’asseyais au coin de l’âtre sur un petit bahut assez délabré qui faisait face à sa grande chaise de paille ; j’ôtais mes sabots, selon le cérémonial du lieu, et je chauffais mes pieds au feu clair et brillant d’une bonne bourrée de genévrier qui pétillait dans le sapin. Je lui disais les nouvelles du mois précédent qui m’étaient arrivées par une lettre de la ville, ou que j’avais recueillies en passant de la bouche de quelque mercier forain, et il me rendait en échange, avec un charme d’élocution contre lequel je n’ai jamais essayé de lutter, les dernières nouvelles du sabbat, dont il était toujours instruit le premier, quoiqu’il ne fût certainement pas initié à ses mystères criminels. Par quelle mission particulière du ciel il était parvenu à les surprendre, c’est ce que je ne me suis pas encore suffisamment expliqué, mais il n’y manquait pas la plus légère circonstance, et j’atteste, dans la sincérité de mon cœur, que je n’ai de ma vie élevé le moindre soupçon sur l’exactitude de ses récits. Joseph Poisson était convaincu, et sa conviction devenait la mienne, parce que Joseph Poisson était incapable de mentir.
Les veillées rustiques de l’excellent vieillard acquirent de la célébrité à cent cinquante pas à la ronde. Elles devinrent des soirées auxquelles les gens lettrés du hameau ne dédaignèrent pas de se faire présenter. J’y ai vu le maire, sa femme et leurs neuf jolies filles, le percepteur du canton, le médecin vétérinaire, qui était un profond philosophe, et même le desservant de la chapelle, qui était un digne prêtre. Bientôt on exploita le thème commun de nos historiettes à l’envi les uns des autres, et il ne se trouva personne au bout de quelques semaines qui n’eût à raconter quelques événements du monde merveilleux, depuis les lamentables aventures d’une noble châtelaine des environs qui se changeait naguère en loup-garou pour dévorer les enfants des bûcherons, jusqu’aux espiègleries du plus mince lutin qui eut jamais grêlé sur le persil ; mais mon impression allait déjà en diminuant, ou plutôt elle avait changé de nature. À mesure que la foi s’affaiblissait dans l’historien, elle s’évanouissait dans l’auditoire, et je crois me rappeler qu’à la longue nous n’attachâmes guère plus d’importance aux légendes et aux traditions fantastiques, que je n’en aurais accordé pour ma part à quelque beau conte moral de M. de Marmontel.
L’induction que je veux tirer de là se présente assez naturellement si elle est vraie. C’est que pour intéresser dans le conte fantastique, il faut d’abord se faire croire, et qu’une condition indispensable pour se faire croire, c’est de croire. Cette condition une fois donnée, on peut aller hardiment et dire tout ce que l’on veut.
J’en avais conclu, – et cette idée bonne ou mauvaise qui m’appartient vaut bien la peine que je lui imprime le sceau de ma propriété dans une préface, à défaut du brevet d’invention, – j’en avais conclu, dis-je, que la bonne et véritable histoire fantastique d’une époque sans croyance ne pouvait être placée convenablement que dans la bouche d’un fou, sauf à le choisir parmi ces fous ingénieux qui sont organisés pour tout ce qu’il y a de bien, mais préoccupés de quelque étrange roman dont les combinaisons ont absorbé toutes leurs facultés imaginatives et rationnelles. Je voulais qu’il eût pour intermédiaire avec le public un autre fou moins heureux, un homme sensible et triste qui n’est dénué ni d’esprit ni de génie, mais qu’une expérience amère des sottes vanités du monde a lentement dégoûté de tout le positif de la vie réelle, et qui se console volontiers de ses illusions perdues dans les illusions de la vie imaginaire ; espèce équivoque entre le sage et l’insensé, supérieur au second par la raison, au premier par le sentiment ; être inerte et inutile, mais poétique, puissant et passionné dans toutes les applications de sa pensée qui ne se rapportent plus au monde social ; créature de rebut ou d’élection, comme vous ou comme moi, qui vit d’invention, de fantaisie et d’amour, dans les plus pures régions de l’intelligence, heureux de rapporter de ces champs inconnus quelques fleurs bizarres qui n’ont jamais parfumé la terre. Il me semblait qu’à travers ces deux degrés de narration, l’histoire fantastique pouvait acquérir presque toute la vraisemblance requise… pour une histoire fantastique.
Je me trompais cependant, et voilà, mon ami, ce que vous dira votre journal. Un fou n’intéresse que par le malheur de sa folie, et n’intéresse pas longtemps. Shakspeare, Richardson et Goethe ne l’ont trouvé bon qu’à remplir une scène ou un chapitre, et ils ont eu raison. Quand son histoire est longue et mal écrite, elle ennuie presque autant que celle d’un homme raisonnable, qui est, comme vous le savez, la chose la plus insipide que l’on puisse imaginer, et si je refaisais jamais une histoire fantastique, je la ferais autrement. Je la ferais seulement pour les gens qui ont l’inappréciable bonheur de croire, les honnêtes paysans de mon village, les aimables et sages enfants qui n’ont pas profité de l’enseignement mutuel, et les poètes de pensée et de cœur qui ne sont pas de l’Académie.
Ce que votre journal ne vous dira pas, c’est que cette idée m’aurait rebuté de mon livre, si je n’y avais vu qu’un conte de fées ; mais que par une grâce d’état qui est propre à nous autres auteurs, j’en avais peu à peu élargi la conception dans ma pensée, en la rapportant à de hautes idées de psychologie où l’on pénètre sans trop de difficulté quand on a bien voulu en ramasser la clef. C’est que j’avais essayé d’y déployer, sans l’expliquer, mais de manière peut-être à intéresser un physiologiste et un philosophe, le mystère de l’influence des illusions du sommeil sur la vie solitaire, et celui de quelques monomanies fort extraordinaires pour nous, qui n’en sont pas moins fort intelligibles, selon toute apparence, dans le monde des esprits. Ce n’est ni de l’Académie des Sciences, ni de la Société de Médecine que je parle.
Ce que votre journal vous dira, c’est que le style de la Fée aux Miettes est singulièrement commun, et je vous avouerai que j’aurais bien voulu qu’il le fût davantage, comme je l’aurais fait si je m’étais avisé plus tôt du mérite du simple et des grâces du naturel, et qu’une éducation littéraire mieux dirigée n’eût jamais placé sous mes yeux que deux modèles achevés de sentiment et de vérité, le Catéchisme historique de M. Fleury et les Contes de M. Galland ; mais si l’on était obligé d’arriver à ce degré de perfection pour écrire, l’art d’écrire serait encore un art sublime, et la presse périrait d’inaction.
Ce que votre journal ne vous dira pas, c’est que j’ai adopté cette manière dans la ferme intention de prendre une avance de quelques mois sur l’époque prochaine et infaillible où il n’y aura plus rien de rare en littérature que le commun, d’extraordinaire que le simple, et de neuf que l’ancien.
Ce que votre journal vous dira enfin, c’est que le sujet de la Fée aux Miettes rappelle, par le fond, autant qu’il s’en éloigne par la forme, un badinage délicieux qu’il n’est pas permis de paraphraser sous peine d’un ridicule éternel, et que j’avais mille fois moins en vue en écrivant que Riquet à la Houppe et la Belle au bois dormant ; mais si l’on voulait prescrire, après quatre ou cinq mille ans de littérature écrite, la bizarre obligation de ne ressembler à rien, on finirait par ne ressembler qu’au mauvais, et c’est une extrémité dans laquelle on tombe assez facilement sans cela, quand on est réduit à écrire beaucoup par une sotte passion ou par une fâcheuse nécessité.
Si ce dernier reproche vous inquiétait cependant sur l’originalité de mon invention, je vous tirerais bientôt, mon ami, de cette crainte bénévole, en déclarant avec candeur que l’idée première de cette histoire doit nécessairement se trouver quelque part. Quant à la Fée Urgelle, je vous dirai au besoin où l’auteur l’a prise, et où l’avait prise avant lui le conteur de fabliaux chez lequel il l’a prise, en remontant ainsi jusqu’à Salomon, qui reconnut dans sa sagesse qu’il n’y avait rien de nouveau sous le soleil.
Salomon vivait pourtant bien des siècles avant l’âge des romans ; il avait peu de dispositions à en faire, et c’est probablement pour cela qu’il a été surnommé LE SAGE.
Qui est une espèce d’introduction.
Non ! sur l’honneur ! m’écriai-je en lançant à vingt pas le malencontreux volume…
C’était cependant un Tite-Live d’Elzévir relié par Padeloup.
Non ! je n’userai plus mon intelligence et ma mémoire à ces détestables sornettes !… Non, continuai-je en appuyant solidement mes pantoufles contre mes chenets, comme pour prendre acte de ma volonté, il ne sera pas dit qu’un homme de sens ait vieilli sur les sottes gazettes de ce padouan crédule, bavard et menteur, tant que les domaines de l’imagination et du sentiment lui étaient encore ouverts !…
Ô fantaisie ! continuai-je avec élan… Mère des fables riantes, des génies et des fées !… enchanteresse aux brillants mensonges, toi qui te balances d’un pied léger sur les créneaux des vieilles tours, et qui t’égares au clair de la lune avec ton cortège d’illusions dans les domaines immenses de l’inconnu ; toi qui laisses tomber en passant tant de délicieuses rêveries sur les veillées du village, et qui entoures d’apparitions charmantes la couche virginale des jeunes filles !… –
Là-dessus je m’arrêtai, parce que cette invocation menaçait de devenir longue.
— L’histoire positive, repris-je gravement, l’expression d’une aveugle partialité, le roman consacré d’un parti vainqueur, une fable classique devenue si indifférente à tout le monde que personne ne prend plus la peine de la contredire !…
Et qui m’assure aujourd’hui, par exemple, qu’il y a plus de vérité dans Mézeray que dans les contes naïfs du bon Perrault, et dans l’Histoire byzantine que dans les Mille et une Nuits ?
Je voudrais bien savoir, ajoutai-je en rejetant une de mes jambes sur l’autre, car il ne manquait plus rien dès lors à la forme de cette protestation sacramentelle…
Je voudrais bien savoir vraiment ce qu’il y a de plus probable, des pérégrinations de la Santa Casa de Lorette, ou de celles du voyageur aérien !… Et puisque la grande moitié du monde croit fermement aux allocutions de l’âne de Balaam et du pigeon de Mahomet, je vous demande, messieurs, quelles objections vous avez contre les succès oratoires du Chat botté ?…
Car, enfin, l’historien du Chat botté fut, comme chacun l’avoue, un homme honnête, pieux, sincère, investi de la confiance publique. La tradition dont il s’est servi n’a jamais été contestée dans ce siècle douteux ; le sévère Fréret et le sceptique Boulanger, qui attaquaient à l’envi tout ce que les hommes respectent, l’ont ménagée dans leurs diatribes les plus audacieuses ; les enfants même qui ne savent pas lire parlent tous les jours entre eux d’un chat de bonne maison qui portait des bottes comme un gendarme et qui pérorait comme un avocat ; et si la famille du marquis de Carabas a disparu de nos fastes nobiliaires, ce que je n’oserais assurer, l’extinction des races illustres est un événement si commun dans les temps de guerre et de révolution, qu’on n’en peut tirer aucune induction défavorable contre l’existence de celle-ci…
L’histoire et les historiens !… Malédiction sur elle et sur eux ! Je prends Urgande à témoin que je trouve mille fois plus de crédibilité aux illusions des lunatiques !… –
— Les lunatiques ! interrompit Daniel Cameron, que j’avais oublié derrière mon fauteuil, où il attendait debout, dans une attitude patiente et respectueuse, le moment de me passer ma redingote… Les lunatiques, monsieur, il y en a une superbe maison à Glasgow.
— J’en ai entendu parler, dis-je en me retournant du côté de mon valet de chambre écossais. Quelle espèce d’hommes est-ce là ?
— Je n’oserais le dire précisément à monsieur, répondit Daniel en baissant les yeux avec un embarras qui laissait deviner cependant je ne sais quelle arrière-pensée sournoise et malicieuse. Les lunatiques sont des hommes qu’on appelle ainsi, je suppose parce qu’ils s’occupent aussi peu des affaires de notre monde que s’ils descendaient de la lune, et qui ne parlent au contraire que de choses qui n’ont jamais pu se passer nulle part, si ce n’est à la lune, peut-être.
— Il y a de la finesse et presque de la profondeur dans cette idée, Daniel. Nous remarquons en effet que la nature, dans l’enchaînement méthodique des innombrables anneaux de sa création, n’a point laissé d’espace vide. Ainsi le lichen tenace qui s’identifie avec le rocher unit le minéral à la plante ; le polype aux bras rameux, végétatifs et rédivives, qui se reproduit de bouture, unit la plante à l’animal ; le pongo, qui pourrait bien devenir éducable, et qui l’est probablement devenu quelque part, unit le quadrupède à l’homme. À l’homme s’arrête la portée de nos classifications naturelles, mais non la portée du principe générateur des créations et des mondes. Il est donc non seulement possible, mais certain… et je ne crains même pas d’établir en principe que si cela n’était point, toute l’harmonie de l’univers serait détruite !… il est incontestable que l’échelle des êtres se prolonge sans interruption à travers notre tourbillon tout entier, et de notre tourbillon à tous les autres, jusqu’aux limites incompréhensibles de l’espace où réside l’être sans commencement et sans fin, qui est la source inépuisable de toutes les existences et qui les ramène incessamment à lui.
Et comme le microcosme ou petit monde est l’image réduite et visible du macrocosme ou grand monde, qui échappe à nos jugements par son immensité, une comparaison te fera beaucoup mieux comprendre cette idée, si tu la comprends ; car Dieu ou la puissance inconnue qui tient la place de cette profonde et insaisissable abstraction… – je te prie de me suivre attentivement ! – Dieu, dis-je, a daigné imprimer intelligiblement l’image imparfaite de ce cycle immense de production, d’absorption, d’épuration et de reproduction, qui commence, aboutit et recommence éternellement à lui, dans la fonction perpétuellement agissante de l’Océan, qui produit, absorbe, épure et reproduit à jamais les eaux qui en dérivent… ; – et cette similitude est vraiment trop claire pour que je me croie obligé à t’en donner la figure.
— Mais les lunatiques, monsieur ? dit Daniel, en déposant proprement mon habit sur mon pupitre…
— J’y arrivais, Daniel. Les lunatiques, dont tu parles, occuperaient, selon moi, le degré le plus élevé de l’échelle qui sépare notre planète de son satellite, et comme ils communiquent nécessairement de ce degré avec les intelligences d’un monde qui ne nous est pas connu, il est assez naturel que nous ne les entendions point, et il est absurde d’en conclure que leurs idées manquent de sens et de lucidité, parce qu’elles appartiennent à un ordre de sensations et de raisonnements qui est tout à fait inaccessible à notre éducation et à nos habitudes. As-tu jamais vu, Daniel, des sauvages Esquimaux ?
— Il y en avait deux sur le vaisseau du capitaine Parry.
— As-tu parlé à ces Esquimaux ?
— Comment aurais-je pu leur parler, puisque je ne savais pas leur langue ?
— Et si tu avais subitement reçu le don des langues, par intuition, comme Adam, ou par inspiration, comme les compagnons du Sauveur, ou par tout autre phénomène moral, comme un membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qu’aurais-tu dit à ces Esquimaux ?
— Qu’aurais-je pu leur dire, puisqu’il n’y a rien de commun entre les Esquimaux et moi ?
— Voilà qui est bien. Je n’ai plus qu’une question à te faire. Crois-tu que ces Esquimaux pensent et qu’ils raisonnent ?
— Je le crois, dit Daniel, comme voilà une brosse, et la redingote de monsieur que je viens de plier sur le pupitre.
— Eh bien, m’écriai-je en claquant des mains, puisque tu crois que les Esquimaux pensent et qu’ils raisonnent, quoique tu ne les comprennes point, que me diras-tu maintenant des lunatiques ?
— Je dirai, monsieur, répondit intrépidement Daniel, que la maison des lunatiques de Glasgow est certainement la plus belle de l’Écosse, et par conséquent du monde entier.
Je ne sais si vous avez jamais éprouvé, lecteur, un désappointement plus cruel que celui que mon ami le bachelier Farfallo de las Farfallas, qui passa toute une nuit pluvieuse à sonner des cantatilles sur sa mandoline, au pied de la croisée d’une belle richement vêtue à la française, – elle n’en bougea pas !… – et qui ne s’aperçut qu’au point du jour que c’était un mannequin dont la Pédrilla venait de faire emplette à Paris, pour sa boutique de modes.
Je ressentis quelque chose de pareil à la réponse de Daniel, dont il résultait démonstrativement que mes inductions philosophiques n’étaient ni plus ni moins inintelligibles pour lui que le langage des Esquimaux du capitaine Parry.
Mais je me consolai en pensant qu’il y avait là un argument irrésistible en faveur de ma théorie des lunatiques. – Et vous savez par expérience que rien n’imprime une impulsion plus bienveillante à la pensée que la satisfaction de soi-même.
Qu’importe où je vivrai, pensai-je intérieurement, pourvu que j’emporte avec moi des idées douces et d’agréables fantaisies qui entretiennent dans mon organisme parfaitement équilibré ce jeu souple des agents de la vie, cette température tiède et régulière du sang, cette inaltérable harmonie de l’action et de la fonction qu’on appelle vulgairement la santé ?…
— Daniel, dis-je à haute voix, tu es né à Glasgow, mon enfant ?
— En Canongate, monsieur, cinq ou six maisons au-dessous de celle du bailli Jervis…
— Tu as laissé à Glasgow quelque jeune maîtresse à la mante rouge ou noire, aux pieds nus plus blancs que l’albâtre, à l’œil vif et hardi comme celui du faucon, tes amis d’enfance, tes parents, ta vieille mère peut-être…
Daniel me répondit par un signe négatif, mais je ne voulus pas m’en apercevoir.
— Tu te souviens des jeux des rives de la Clyde, et de ses talus verdoyants, et du bruit retentissant des marteaux d’Hig-Street, et de la solennité sérieuse de la vieille église ! Écoute, Daniel, nous irons à Glasgow, et je verrai tes lunatiques…
— Nous irons à Glasgow ! s’écria Daniel ivre de joie.
— Nous partirons à six heures du soir, continuai-je en réglant ma montre. Comme dans le pays de la liberté plénière où nous sommes, j’ai la précaution d’être toujours muni d’un passeport et d’un permis de poste, je n’attends plus que les chevaux. Et la route intermédiaire m’étant tout à fait indifférente, ne manque pas de dire que je ne m’arrêterai qu’à 55 degrés 51 minutes de latitude.
Daniel était parti.
Dix jours après, je descendis à Buck’shead Inn, où l’on est pour le moins aussi bien qu’au Star.
II.
Qui est la continuation du premier, et où l’on rencontre le personnage le plus raisonnable de cette histoire à la maison des fous.
Je visitai la maison des lunatiques le jour de Saint-Michel, époque où l’aube d’Écosse commence à se rapprocher visiblement du crépuscule qui la suit, et je m’y pris de bonne heure, parce que j’avais entendu parler de son jardin botanique, si riche en plantes rares et merveilleuses. J’y arrivai à dix heures, par une de ces matinées pâles et sans soleil, mais calmes et de bon augure, qui annoncent une soirée paisible. Je ne m’arrêtai pas à ces tristes infirmités de l’espèce qui attirent les curieux devant la loge des fous. Je ne cherchais pas le fou malade qui épouvante ou qui rebute, mais le fou ingénieux et presque libre, qui s’égare dans les allées sous l’escorte attentive de la pitié, et qui n’a jamais rendu nécessaire celle de la défiance et de la force. Et moi aussi, j’allais, je me perdais parmi ces détours, comme un lunatique volontaire qui venait réclamer de ces infortunés quelques droits de sympathie. Je remarquai bientôt qu’ils s’écartaient de mon passage avec une dignité triste, celle du malheur, peut-être, et peut-être aussi celle d’une révélation instinctive de supériorité morale, qui est pour eux la compensation de l’esclavage philanthropique auquel notre sublime raison les condamne. Je m’éloignai respectueusement du chemin de ces solitaires, plus judicieux que nous, pour lesquels l’homme social n’est que trop justement un objet d’inquiétude et de terreur.
Hélas ! dis-je dans la profonde amertume de mon cœur, voilà l’effet de notre ambitieuse et fausse civilisation !… Ce que j’ai de frères sur la terre se détournent de moi, parce que je porte ce funeste habit du riche qui leur dénonce un ennemi !… Et ce qui me reste à moi qui fuis le monde, comme ils me fuient, c’est le commerce de cette création vivante et sensible, mais impensante et impassionnée, qui ne peut pas payer mes sentiments d’un sentiment !…
Je réfléchissais à ceci en mesurant du regard un grand carré de mandragores presque entièrement moissonné jusqu’à la racine par la main de l’homme, et sur lequel toutes ces mandragores gisaient flétries et mortes sans que personne eût pris la peine de les recueillir. Je doute qu’il y ait un endroit au monde où l’on voie plus de mandragores.
Comme je me rappelai subitement que la mandragore était un narcotique puissant, propre à endormir les douleurs des misérables qui végètent sous ces murailles, j’en arrachai une de la partie du carré qui n’était pas encore atteinte, et je m’écriai en la considérant de près : Dis-moi, puissante solanée, sœur merveilleuse des belladones, dis-moi par quel privilège tu supplées à l’impuissance de l’éducation morale et de la philosophie politique des peuples, en portant dans les âmes souffrantes un oubli plus doux que le sommeil, et presque aussi impassible que la mort ?…
— Vous a-t-elle répondu, me demanda un jeune homme qui se levait à mes pieds ?… A-t-elle parlé ? a-t-elle chanté ? Oh ! de grâce, monsieur, apprenez-moi si elle a chanté la chanson de la mandragore :
C’est moi, c’est moi, c’est moi !
Je suis la mandragore,
La fille des beaux jours qui s’éveille à l’aurore,
Et qui chante pour toi !
— Elle est sans voix, lui répondis-je en soupirant, comme toutes les mandragores que j’ai cueillies de ma vie…
— Alors, reprit-il en la recevant de ma main, et en la laissant tomber sur la terre, ce n’est donc pas elle encore !
Pendant qu’il restait plongé dans une méditation douloureuse, en proie au regret inexplicable pour vous et pour moi de n’avoir pas encore trouvé une mandragore qui chantât, je prenais le temps de le regarder avec attention, et je sentais s’accroître de plus en plus l’intérêt que le ton tendrement accentué de sa voix et le caractère innocent et naïf de son aliénation m’avaient inspiré d’abord. Quoique sa physionomie, fatiguée par une habitude non interrompue d’espérances et de désappointements, portât les traces d’un souci amer, elle n’annonçait pas plus de vingt-deux ans. Il était pâle ; mais de cette pâleur de tristesse et d’abattement sur laquelle on sent qu’un jour de pure allégresse ranimerait toute la fraîcheur de la santé ; ses traits avaient la pureté du style grec, mais non sa froideur et sa symétrie ; on devinait même au galbe bien arrêté de ses lignes régulières l’impression d’une âme rêveuse et mobile, quoique soumise et timide. La courbure étroite et noire de ses sourcils parfaitement arqués n’avait certainement jamais fléchi sous le poids d’un remords, que dis-je ! sous celui d’une de ces inquiétudes passagères de la conscience qui troublent quelquefois jusqu’au repos légitime de la vertu. Ses grands yeux, quand il les ramena sur moi, m’étonnèrent par je ne sais quelle transparence humide et bleue qui baignait un disque d’ébène où le feu du regard s’était assoupi, et ma monomanie poétique vint me rappeler l’atmosphère d’azur livide où plonge un astre éclipsé. Enfin, pour m’expliquer plus clairement, et j’aurais peut-être dû commencer par là, ce qui serait arrivé infailliblement si j’étais maître de me défendre de l’invasion de la métaphore et du despotisme de la phrase, je vous dirai en langue vulgaire que c’était un fort beau garçon, qui avait les yeux, les sourcils et les cheveux noirs comme du jais.
Ce qui me frappa cependant le plus, tant la recommandation extérieure agit invinciblement sur la raison la plus libre de préjugés, ce fut la recherche singulière, pour ne pas dire fastueuse, du costume de mon lunatique, et l’aisance abandonnée avec laquelle il portait ces richesses, aussi insoucieusement qu’un montagnard des Highlands qui descend aux basses-terres, drapé de son plaid. Une de ces chaînes d’or souple et doux que les Nababsrapportent de l’Inde paraissait soutenir un médaillon sur sa poitrine, et le shall le plus fin de tissus et le plus élégant de broderies qui soit sorti des fabriques de Cachemire la traversait en sautoir flottant. Quand il passa ses doigts forts et sa main musclée, mais d’un blanc pur et poli comme l’ivoire, dans les touffes de sa chevelure, je les vis étinceler de bagues, de rubis et de bracelets de diamants, et c’est un fait sur lequel je ne saurais me tromper, moi qui apprécie de l’œil les pierres précieuses, au carat et au grain, et qui défie sur ce point le réactif du chimiste, l’émeri du lapidaire et la balance du joaillier.
— Comment vous appelez-vous, monsieur ?… lui dis-je, avec l’expression un peu confuse, et difficile à caractériser pour moi-même, de l’attendrissement que m’inspirait l’infortune de mon semblable, et du respect que m’imposait malgré moi les débris de l’opulence d’un grand prince déchu.
— Monsieur !… reprit-il en souriant… je ne suis pas un monsieur. On m’appelle Michel, et plus communément Michel le charpentier, parce que c’est mon état.
— Permettez-moi de vous dire, Michel, que rien n’annonce dans vos manières un simple charpentier, et que je crains qu’une préoccupation d’esprit qui vous maîtrise à votre insu ne vous trompe sur votre véritable condition.
— Il est assez naturel, monsieur, de former une pareille conjecture dans la maison où nous sommes, vous comme curieux, et moi, comme détenu ; mais je vous assure que mon nom et ma profession sont les seules choses qu’on n’y ait pas contestées. Ce qu’il y a de vrai, c’est que je suis un charpentier opulent, le plus riche du monde, peut-être ; et quant à ces objets de luxe dont l’étalage explique très bien l’erreur obligeante dans laquelle vous êtes tombé sur mon compte, je ne les porte point par orgueil, je vous prie de le croire, mais parce que ce sont des présents de ma femme, qui fait, depuis de longues années, un commerce florissant avec le Levant. Si on ne m’en a pas retiré l’usage en m’admettant ici, c’est peut-être, comme je l’ai pensé quelquefois, que j’y suis placé sous une protection inconnue, et aussi parce que mon caractère inoffensif et paisible me recommande à l’humanité, à la confiance et aux égards des gardiens.
Frappé de cette manière nette et simple d’exprimer des idées naturelles, dont je ferais probablement moins de cas si elle m’était plus familière : — Attendez, mon cher Michel, lui demandai-je d’un ton de curiosité inquiète : — Vous avez dû participer à des opérations bien importantes pour parvenir à un état de fortune aussi considérable ?…
Michel rougit, parut embarrassé un moment, et puis, arrêtant sur moi un œil assuré, mais plein de candeur :
— Oui, monsieur, répondit-il, mais j’ai peine moi-même à me rendre un compte exact de l’origine et de l’objet de mes entreprises, quoiqu’il n’y ait rien de plus vrai. C’est moi qui fournis les solives de cèdre et les lambris de cyprès du palais que Salomon fait bâtir à la reine de Saba, au juste milieu du lac d’Arrachieh, à deux jours de l’oasis de Jupiter Ammon, dans le grand désert libyque.
— Oh ! oh ! m’écriai-je, ceci est tout à fait différent. Mais vous m’avez dit, si je ne me trompe, que vous étiez marié. Votre femme est-elle jeune ?
— Jeune ! dit Michel encore plus troublé. Non, monsieur. J’imagine qu’elle a plus de trois mille ans, mais elle n’en paraît guère que deux cents.
— De mieux en mieux, mon ami ! Ces notions, Dieu soit loué, ne sont plus de ce monde. Au moins, pensez-vous qu’elle soit belle, malgré son grand âge ?
— Ni pour le monde, ni pour vous, monsieur. Belle pour moi, comme la femme qu’on aime, comme la seule femme qu’on puisse aimer !…
— Et ne vous est-il jamais arrivé de croire que la volonté de votre femme, que l’influence de sa fortune et de son crédit soient entrées pour quelque chose dans les persécutions que vous éprouvez ?
— Je l’ignore, et je regretterais de l’avoir ignoré, car cette idée aurait embelli ma prison.
— Pourquoi, Michel, pourquoi ?
— Parce qu’elle ne peut rien vouloir qui ne soit bien.
— Oh ! Michel, vous excitez vivement ma curiosité ! Je voudrais connaître cette histoire ! –
Je ne sais si vous êtes comme moi, mes amis, mais j’aurais volontiers cédé ma place à trois séances solennelles de l’Institut, pour suivre Michel dans le labyrinthe fantastique où ses demi-confidences m’avaient engagé…
Et si vous n’étiez pas comme moi, j’ai le bonheur de tenir le fil d’Ariane à votre disposition. Faites passer rapidement sous le pouce de la main droite, – ou bien sous celui de la main gauche, si vous êtes scaeve ou gaucher, – ou même sous celui des deux mains qu’il vous plaira d’employer, si vous êtes ambidextre ; faites-y passer, dis-je, en rétrogradant, les feuillets que vous venez de parcourir. Cela sera facile et bientôt fait, surtout si vous avez le geste assez sûr et fragile, dans votre empressement, pour en ramener plusieurs à la fois. Vous arriverez ainsi au frontispice, à la garde, à la couverture, c’est-à-dire à la porte d’entrée de ce dédale ennuyeux, et vous pourrez faire voile vers Naxos.
— Mon histoire ? dit Michel d’un air réfléchi, en portant successivement les yeux sur le point qu’occupait alors le soleil dans le ciel, et sur le petit coin de mandragores qui lui restait à défricher, pour se détromper de l’existence de la mandragore qui chante, au moins dans le jardin des lunatiques de Glasgow… – Mon histoire ? elle est bizarre et incompréhensible, sans doute, puisque personne n’y croit ; puisqu’on juge au contraire, partout où j’en parle, que ma foi dans des événements imaginaires au jugement de la raison universelle est un signe de faiblesse et de dérangement d’esprit ; puisque ce motif seul a déterminé les précautions bienveillantes dont je suis l’objet, que vous appeliez tout à l’heure des persécutions, et que je n’attribue qu’à l’humanité. Que vous dirais-je, enfin ? cette histoire est pour moi une suite de notions claires et certaines, mais telles que j’en trouve moi-même l’enchaînement inexplicable, et que j’essayerais quelquefois d’en détourner ma pensée, si elles ne me retraçaient l’idée de mes jours heureux, et si elles ne me rendaient surtout présente la nécessité d’accomplir un saint devoir, pour lequel il ne me reste que ce jour, qui expire au coucher du soleil.
J’allais l’interrompre. Il s’en aperçut, et continuant vivement comme s’il avait prévu mon dessein :
— Il faut, poursuivit-il en mettant le doigt sur sa bouche, avec une expression mystérieuse, que j’arrive à Greenock avant minuit, et je m’inquiéterais peu de la longueur et de la difficulté du voyage, si j’avais achevé ma tâche. Voilà ce qui m’en reste, ajouta Michel en me montrant les mandragores sur pied, qui se déployaient en verdoyant, et se balançaient gaiement à une petite brise, sous le jeu des rayons qui traversaient les nuages comme une clairière. — Je ne suis pas en peine, continua-t-il, de finir ma besogne en quelques minutes, mais je n’ai pas de raison de vous le dissimuler, puisque vous avez eu la bonté de vous intéresser à moi,… c’est là, dans cette touffe de vertes et riantes mandragores qu’est caché le secret de mes dernières illusions ; c’est là qu’à la dernière, à laquelle il reste encore une fleur, à celle qui cédera sous le dernier effort de mes doigts, et qui arrivera muette à mon oreille, comme la vôtre, mon cœur se brisera ! Et vous savez si l’homme aime à repousser jusqu’à son dernier terme, sous l’enchantement d’une espérance longtemps nourrie, la désolante idée qu’il a tout rêvé TOUT ; et qu’il ne reste rien derrière ses chimères… RIEN ! j’y pensais quand vous êtes venu, et voilà pourquoi je m’étais assis. –
Quel infortuné, ô mon Dieu ! n’a pas eu sur la terre, où tu nous as jetés pêle-mêle, sans nous peser et sans nous compter…… dans un moment de colère ou de dérision !… quel homme n’a pas eu sa mandragore qui chante !…
— Vous avez donc le temps, Michel, de me faire ce récit ; … et pendant que vous me le ferez, nous veillerons à la garde de vos mandragores, et surtout de celle qui a encore une fleur, belle d’ici comme une étoile. J’imagine que la Providence peut nous fournir, durant les heures qui nous restent, quelque motif de consolation.
Michel pressa ma main ; il s’assit près de moi, les yeux tournés sur ses mandragores, et il commença ainsi.
III.
Comment un savant, sans qu’il y paraisse, peut se trouver chez les lunatiques, par manière de compensation des lunatiques qui se trouvent chez les savants.
Je suis né à Granville en Normandie.
— Attendez, Michel ; un mot avant d’entrer dans ce récit, que je tâcherai de ne pas interrompre souvent.
Jusque-là, Michel m’avait parlé en anglais ; il me parlait en français alors.
— La langue française est votre langue naturelle, et je ne m’en serais pas aperçu, à la manière dont vous vous exprimez dans celle dont nous nous sommes servis. Laquelle des deux vous est plus familière, car cela me serait indifférent pour vous entendre ?
— Je le sais, monsieur ; mais j’ai cru remarquer que vous étiez mon compatriote ; et, quoique les deux langues me soient également familières, j’ai préféré celle qui me donnait un titre de plus à votre attention, et peut-être à votre indulgence.
— Devez-vous cet avantage, assez rare à votre âge et dans votre état, à l’usage ou à l’éducation ?
— À l’usage et à l’éducation.
— Pardonnez-moi tant de questions, Michel : parlez-vous d’autres langues que ces deux langues, avec la même facilité ?
Ici Michel baissa les yeux, comme toutes les fois qu’il avait à faire un aveu pénible pour sa modestie.
— Je crois parler avec la même facilité toutes les langues que je sais.
— Mais encore ?
— Celles de tous les peuples dont le nom a été recueilli par les historiens ou les voyageurs, et qui ont écrit leur alphabet.
— Oh ! pour cette fois, Michel, ce n’est ni l’éducation ni l’usage qui ont pu vous communiquer cette science perdue depuis les apôtres ! À qui en avez-vous l’obligation, je vous prie ?
— À l’amitié d’une vieille mendiante de Granville.
— Alors, dis-je en laissant tomber mes mains sur mes genoux, pour Dieu ! Michel, reprenez votre narration, dussé-je ne jamais sortir, pour en entendre la fin, de l’hospice des lunatiques de Glasgow. – D’ailleurs, ajoutai-je en moi-même, il est probable, si cela continue, que je n’aurai rien de mieux à faire que d’y rester.
IV.
Ce que c’est que Michel, et comment son oncle l’avait sagement instruit dans l’étude des lettres et la pratique des arts mécaniques.
Je suis né à Granville en Normandie. Ma mère mourut peu de jours après ma naissance. Mon père, que j’ai connu à peine, était un riche négociant qui trafiquait depuis longtemps dans les Indes ; à son dernier voyage, qui devait être plus long et plus hasardeux que les autres, il me laissa sous la garde de son frère aîné, qui l’avait précédé dans ce commerce, et qui n’avait d’autre héritier que moi.
Mon oncle se ressentait peut-être un peu dans ses manières de la rudesse qu’on attribue ordinairement aux marins : la fréquentation des orientaux, et quelque séjour parmi ces peuplades peu civilisées qu’on appelle sauvages, lui avaient inspiré une sorte de mépris systématique pour la société et pour les mœurs européennes ; mais il était doué, à cela près, d’un sens juste et délicat ; et, bien qu’il m’entretînt de préférence des histoires merveilleuses de ce pays d’enchantement pour lesquels sa conversation m’inspirait une prédilection de jour en jour plus vive, il trouvait toujours manière d’en tirer pour mon instruction d’excellents enseignements. Les imaginations poétiques de l’homme simple, dont le commerce du monde n’a pas altéré la naïveté, ne lui paraissaient gracieuses et charmantes qu’autant qu’il en résultait un avantage réel d’utilité morale pour la conduite de la vie, et il les regardait comme d’admirables emblèmes qui enveloppent agréablement les leçons les plus sérieuses de la raison. Il avait coutume de les terminer, pendant que j’étais encore suspendu au charme de ses récits, par cette formule qui ne sortira jamais de mon esprit :
« Et si cela n’est pas vrai, Michel, chose dont je suis à peu près convaincu, ce qu’il y a de vrai, c’est que la destination de l’homme sur la terre est le travail ; son devoir, la modération ; sa justice, la tolérance et l’humanité ; son bonheur, la médiocrité ; sa gloire, la vertu ; et sa récompense, la satisfaction intérieure d’une bonne conscience. »
Quoiqu’il ne fût pas très savant, et qu’il n’entendît que par pratique la plupart des sciences essentielles de son état, il n’avait rien négligé pour mon éducation : à quatorze ans, je savais passablement ce qu’on enseigne aux enfants qui doivent être riches ; les langues anciennes et modernes qui entrent dans les bonnes études classiques, la partie indispensable des beaux-arts, qui s’applique le plus communément aux besoins de la société, et même quelques arts d’agrément qui contribuent au bien-être ou à la consolation de l’homme livré à lui-même, par l’effet de son caractère ou le hasard de sa fortune ; mais on m’avait fait approfondir davantage les éléments les plus positifs des connaissances humaines, dans leur rapport expérimental avec l’utilité commune, et mes maîtres ne trouvaient pas que j’eusse mal profité.
J’arrivais, comme je l’ai dit, au commencement de ma quinzième année. Un soir, mon oncle me tira à part à la fin d’un petit régal qu’il avait donné à mes instituteurs et à mes camarades, le propre jour de Saint-Michel, qui est celui-ci, et qui est l’anniversaire de ma naissance, et la fête de mon patron ; c’était à Granville, où saint Michel est particulièrement honoré, un des derniers jours des vacances.
Après m’avoir baisé tendrement sur les deux joues, il me fit asseoir en face de lui, vida sa pipe sur son ongle, et me parla dans les termes que je vais vous rapporter.
« Écoute, mon enfant, ce n’est pas un conte que je vais te faire aujourd’hui ; je suis content de toi ; te voilà, grâce à Dieu et à ton bon naturel, un assez joli garçon pour ton âge ; il faut maintenant penser à l’avenir, qui est toute la vie du sage, puisque le présent n’est jamais, et que le passé ne sera plus. J’ai entendu dire cela dans un pays où l’on en sait plus long qu’ici. Je te vois tous les avantages qui peuvent recommander dans le monde un aimable enfant bien nourri, entretenu d’utiles instructions, et pénétré de principes honnêtes ; cependant, mon pauvre Michel, tu ne tiens pas plus à la vie, par une ressource solide, que la cendre qui vient de tomber de ma pipe, tant que tu n’as pas un bon état à la main. Je n’ai pas parlé de ceci, tant que je t’ai vu frêle et gentil comme une petite fille qui n’a affaire que de vivre et de se porter gaillardement, parce que je craignais de te fatiguer, en compliquant des études que tu poussais déjà plus chaudement que je n’aurais voulu pour une santé qui m’est si chère ! À cette heure, petit, que nous sommes sortis des brisants, que nous filons sous un joli vent comme des oiseaux, et que nous avons notre gourdoyement aussi libre que des poissons, il faut que nous parlions raison dans la chambre du capitaine. – Avec tes joues épanouies et vermeilles qui ressemblent à des pivoines, et tes mains aussi fortes que le meilleur harpon qu’ait jamais lancé un pêcheur hollandais, sur les côtes du Spitzberg, tu serais bien étonné s’il fallait, je ne dis pas gréer un canot, mais tailler une pièce de radoub, étancher une étoupe goudronnée au calfat, ou tendre une ligne à l’estrompe. Je te parlerai de cela une autre fois, et je ne te reproche pas, cher neveu, de ne pas savoir ce que je ne t’ai jamais fait apprendre. Ce que je veux te dire pour ta gouverne, c’est que c’est dans la pratique des métiers, quel que soit le vent qui fatigue tes relingues, ou le sable que te rapporte la sonde, c’est là seulement, vois-tu, que sont placés nos moyens les plus assurés d’existence ; et si tu voyais dans une de ces occasions difficiles où tous les hommes peuvent se trouver, un savant ou un homme de génie qui ne sache faire œuvre de ses dix doigts, tu en aurais vraiment pitié. Après le prêtre auquel j’ai foi, et le roi que je respecte, la position la plus honorable de la société, Michel, c’est celle de l’ouvrier.
» Tu pourrais me dire à cela, Michel, que tu as de la fortune, et tu ne me le diras pas, car tu es un enfant raisonnable et beaucoup plus réfléchi que ton âge ne le comporte. Il me serait en effet trop facile de te répondre et de te désabuser ; il n’y a de fortune solide pour l’homme que celle qu’il doit à son travail ou à son industrie, et qu’il ménage et conserve par sa bonne conduite : celle qu’il reçoit du hasard de sa naissance appartient toujours au hasard ; et la plus hasardeuse de toutes est celle de ton père et la mienne, la fortune du marin.
» La tienne est en effet assez grande aujourd’hui pour satisfaire à l’ambition d’un homme simple qui ne veut que se reposer, et qui ne cherche de plaisirs que ceux dont la nature est prodigue pour les hommes simples ; mais à supposer qu’elle t’arrive bien plus tôt que tu ne le voudrais, et que notre mort devance le terme commun, pour t’enrichir malgré toi au moment où l’aisance et la liberté ont le plus de prix, que ferais-tu, mon pauvre Michel, de ton opulente oisiveté ? Les loisirs des gens riches ne sont qu’un insupportable ennui pour ceux qui n’en savent pas appliquer l’usage au bien-être des autres ; il n’y a point de Crésus, vois-tu, qui n’ait senti quelquefois que le meilleur des jours de la vie est celui qui gagne son pain.
» J’arrive maintenant au point le plus important de mon sermon, car tu savais aussi bien que moi tout ce que j’ai dit jusqu’ici. Mon intention, cher petit neveu, n’est pas d’attrister ta fête par l’inquiétude d’un malheur possible, mais contre lequel toutes les circonstances nous rassurent. Ton père avait placé son bien et une partie du mien dans une belle spéculation qui nous souriait depuis vingt ans ; il y en a deux que je n’ai reçu de ses nouvelles, et les malheureuses guerres de l’Europe expliquent trop ce retard, pour que je m’en sois mis en peine plus qu’il ne convient à un vieux loup de mer qui a été retenu trois ans aux îles Bissayes, et qui regretterait de n’y être pas encore, soit dit en passant, si je ne t’aimais aussi tendrement que mon propre fils. Mais, comme dit le marin, au bout du câble faut la brasse, et si dans deux autres années d’ici, nous n’avions pas entendu parler de Robert, il serait force de risquer le tout pour le tout, et d’aller le chercher d’île en île, certain que je suis de te le ramener, car je sais mieux son itinéraire, Michel, que tu ne sais la longitude d’Avranches. Alors cependant, adieu le double patrimoine du pauvre Michel ! Plus d’oncle, plus de père, plus d’habit d’hiver, plus d’habit d’été, plus d’argent dans la poche le dimanche, plus de banquet à la maison le jour de sa fête : il faudrait, tout savant qu’il fût, si on refusait une place de répétiteur chez le riche, ou une place d’expéditionnaire chez le chef de bureau, que M. Michel allât déterrer ses coques dans le sable pour déjeuner, et qu’il allât mendier pour dîner, à côté de la vieille naine de Granville, sur le morne de l’église.
» — Arrêtez, arrêtez, mon oncle ! lui dis-je en baignant sa main de larmes de tendresse ! Je serais trop indigne de vous, si je ne vous avais pas encore compris. L’état de charpentier m’a toujours plu. — L’état de charpentier ! s’écria mon oncle avec une sorte d’explosion de joie, tu n’es vraiment pas dégoûté ! Je ne t’en aurais jamais indiqué un autre ! Le charpentier, mon enfant ! c’est dans ses chantiers que notre divin maître a daigné choisir son père adoptif !… et ne doute pas qu’il ait voulu nous enseigner par là que, de tous les moyens d’existence de l’homme en société, le travail manuel était le plus agréable à ses yeux ; car il ne lui coûtait pas davantage de naître prince, pontife ou publicain. Le charpentier, souverain sur mer et sur terre par droit d’habileté, qui jette des vaisseaux à travers l’Océan, et qui édifie des villes pour commander aux ports, des châteaux pour commander aux villes, des temples pour commander aux châteaux ! Sais-tu que j’aimerais mieux qu’on dît de moi que j’ai lancé dans l’espace les solives de cèdre et les lambris de cyprès du palais de Salomon que d’avoir écrit la loi des Douze Tables ? »
C’est ainsi, monsieur, qu’il fut convenu que j’apprendrais l’état de charpentier, jusqu’à l’âge de seize ans, qui était l’époque extrême où le défaut de renseignements sur le sort de mon père pouvait en faire pour moi une importante ressource ; mais mon oncle exigea en même temps que je ne renonçasse point aux études que j’avais commencées, et qui furent seulement distribuées en sorte que mes doubles travaux ne se nuisissent pas mutuellement. Comme cette disposition, qui ne me prenait pas plus de temps, jetait au contraire une distraction agréable et variée dans ma vie, mes faibles progrès parurent encore plus sensibles que par le passé. En moins de deux ans, j’étais devenu maître ouvrier ; et, d’un autre côté, je connaissais assez les langues classiques pour pénétrer peu à peu, avec une facilité qui s’augmentait tous les jours, dans l’intelligence des autres. Je vous prie de croire que ma modestie n’est presque intéressée en rien à cet aveu, puisque je devais ces nouvelles acquisitions de mon esprit à des renseignements particuliers dont tout autre que moi aurait certainement tiré un plus grand profit. C’est ce qu’il faut que je vous explique maintenant pour l’intelligence du reste de mon histoire, si toutefois elle n’a pas déjà lassé votre patience. –
Je témoignai à Michel que je l’entendrais avec un plaisir que ma seule crainte est de ne pas faire partager au lecteur, – et il continua.
V.
Où il commence à être question de la Fée aux Miettes.
Si vous êtes jamais allé à Granville, monsieur, vous devez avoir entendu parler de la naine qui couchait sous le porche de l’église, et qui mendiait à la porte ? –
— Ce que vient d’en dire votre oncle, Michel, est tout ce que j’en sais ; et je ne pensais pas que cette malheureuse créature pût tenir une autre place dans votre histoire. C’est ce qui m’a empêché de m’en informer.
— La naine de Granville, reprit Michel, était une petite femme de deux pieds et demi au plus, dont la taille courte, et d’ailleurs assez svelte, était la moindre singularité. Personne ne lui avait connu ni origine ni parents ; et, quant à son âge, il était tel qu’il n’existait pas un vieillard à dix lieues à la ronde, qui se souvînt de l’avoir connue plus jeune en apparence, plus huppée, ou plus grandelette. Les gens instruits pensaient même qu’on ne pouvait expliquer naturellement les traditions populaires qui couraient à son sujet, qu’en supposant qu’il y avait eu successivement plusieurs femmes semblables à celle-ci, que la mémoire des habitants s’était accoutumée à confondre entre elles, à cause de l’analogie de leur physionomie et de leurs habitudes, et on citait en effet un titre de 1369, où le droit de coucher sous le porche du grand portail, et de présenter l’eau bénite aux fidèles pour en obtenir quelque légère aumône, lui était garanti en reconnaissance du don qu’elle avait fait à l’église de plusieurs belles reliques de la Thébaïde.
Cette méprise paraissait d’autant plus vraisemblable qu’on avait vu maintes fois la naine de Granville s’absenter pendant des mois, pendant des saisons, pendant des années, et même pendant le cours d’une ou deux générations, sans qu’on sût ce qu’elle était devenue ; et il fallait en effet qu’elle eût considérablement voyagé, car elle parlait toutes les langues avec la même facilité, la même propriété de termes, la même richesse d’élocution, que le français de Blois ou de Paris, qui n’était pas lui-même sa langue naturelle. Cette science de souvenirs dont elle ne faisait aucun étalage, car elle ne se servait d’ordinaire que de notre patois bas-normand, lui avait donné, comme vous pouvez croire, un immense crédit dans les écoles où elle venait journellement recueillir pour ses repas les débris de nos déjeuners, et cette dernière particularité, jointe aux idées superstitieuses et aux folles rêveries dont nos nourrices et nos domestiques nous berçaient depuis l’enfance, avait valu à la pauvre naine, parmi les jeunes garçons de mon âge, un surnom assez fantasque : on l’appelait la Fée aux Miettes. C’est ainsi que je vous en parlerai à l’avenir.
Ce qu’il y a de certain, monsieur, c’est qu’aucune difficulté de thème ou de version n’eût embarrassé la Fée aux Miettes, et elle se gardait bien de nous les expliquer sans nous les rendre aussi claires qu’elles l’étaient pour elle-même, de sorte que notre travail se trouvait infiniment meilleur et notre instruction aussi, puisque nous entendions parfaitement tout ce qu’elle nous faisait faire, et que nous pouvions appuyer par de bonnes autorités et de bons raisonnements tout ce que nous avions fait. Nous n’étions pas assez ingrats pour cacher les obligations que nous avions à la Fée aux Miettes, mais nos respectables maîtres, qui ne voyaient en elle qu’une misérable mendiante, et qui l’honoraient cependant comme une digne femme, n’étaient pas fâchés de sentir notre émulation excitée par une illusion innocente. — Oh ! oh ! s’écriaient-ils en riant, quand il arrivait une excellente composition cicéronienne qui enlevait d’emblée la première place, – voici qui ressent la touche et l’inspiration de la Fée aux Miettes. – Et il n’y avait rien de plus vrai. J’ai souvent désiré de savoir si ce dicton s’était conservé à Granville.
— La Fée aux Miettes n’est donc plus à Granville, mon ami ?
— Non, monsieur, répondit Michel en soupirant et en élevant les yeux au ciel !
VI.
Où la Fée aux Miettes est représentée au naturel, avec de beaux détails sur la pêche aux coques, et sur les ingrédients propres à les accommoder, pour servir de supplément à la Cuisinière bourgeoise.
Il n’y avait pas un écolier à Granville qui n’aimât la Fée aux Miettes, continua Michel, mais elle m’inspirait dès ma douzième année un penchant de vénération tendre et de soumission presque religieuse qui tenait à un autre ordre d’idées et de sentiments. Était-il l’effet d’une reconnaissance profondément sentie, ou le résultat de cette éducation privée qui m’avait fait contracter de bonne heure, dans la conversation de mon oncle André, le goût de l’extraordinaire et du surnaturel, c’est ce que je ne saurais démêler. Il est vrai, cependant, qu’elle m’affectionnait elle-même entre tous mes camarades, et que, si je l’avais voulu, j’aurais toujours été le premier de l’école. Je ne le désirais point, parce que cet avantage qu’on prend sur les autres est une des raisons qui nous en font haïr, et que je regardais l’amitié comme un avantage bien plus doux que ceux qui résultent de la supériorité de l’instruction et du talent. C’était donc pour mon propre bonheur, et il y a bien peu de mérite à cela, que dans les fréquentes conférences où nous admettait la Fée aux Miettes, sous le porche de l’église, avant d’entrer à la messe ou aux vêpres, je lui disais le plus souvent, en la tirant un peu en particulier : — J’ai eu du temps cette semaine pour travailler à ma composition, et je la crois aussi bonne que je puisse la faire, en m’aidant, à part moi, des conseils que j’ai reçus de vous jusqu’ici ; mais voilà Jacques Pellevey que ses parents veulent mettre dans les ordres, et Didier Orry dont le père est bien malade, et recevrait une grande consolation de voir Didier réussir dans ses études. Comme j’ai fait tout ce qu’il fallait pour contenter mon oncle et mes professeurs, je ne désire maintenant que de voir Jacques et Didier alterner à la première place jusqu’à la fin de l’année. Je vous prie aussi de soutenir un peu Nabot, le fils du receveur, quoique je sache bien qu’il ne m’aime pas, et qu’il me battrait s’il en avait la force ; mais parce qu’il me semble qu’il aurait moins d’aigreur dans le caractère, s’il n’était pas si malheureux dans ses études, et que le dépit d’être toujours le dernier n’eût pas altéré son naturel.
— Je ferai ce que tu me demandes, me répondait la Fée aux Miettes en prenant un petit air soucieux, et je ne suis pas étonnée que tu me l’aies demandé, parce que je connais ton bon cœur ; mais il me serait possible, si je réussissais, que tu n’eusses pas le grand prix à la Saint-Michel. — Alors, lui répondis-je, cela me serait égal. — Et à moi aussi, reprenait la Fée aux Miettes, avec un sourire doux et significatif que je n’ai jamais connu qu’à elle.
J’eus pourtant le grand prix cette année-là, avec Jacques, qui entra au séminaire, et Didier, dont le père guérit. Nabot mérita l’accessit au grand étonnement de tout le monde, mais il m’en a longtemps voulu, parce qu’il regarda comme une injustice la préférence qu’on m’avait donnée sur lui.
— Avez-vous eu d’autres ennemis au monde, Michel ?…
— Je ne crois pas, monsieur.
Jusqu’ici je ne vous ai parlé que de l’âge et de la taille de la Fée aux Miettes. Vous ne la connaissez pas encore. Je vous ai dit, si je ne me trompe, qu’elle était assez svelte dans sa tournure, mais cela ne peut s’entendre que d’une très vieille femme qui a conservé, par bonheur ou par régime, quelque souplesse et quelque élégance de formes. Elle prêtait souvent cependant à l’idée que nous nous faisions de la décrépitude, en s’appuyant toute courbée sur une petite béquille de bois du Liban, surmontée d’une forte poignée de je ne sais quel métal inconnu, mais qui avait l’éclat et l’apparence du vieil or. C’est cette baguette curieuse, dont elle n’avait jamais voulu se défaire en faveur des juifs dans sa plus grande indigence, qui lui fit décerner bien avant nous, par les petites écoles de Granville, ses titres de féerie. Il est vrai qu’elle lui venait de sa mère, ou même de sa grand’mère, si la chronologie du monde permet cette supposition, et je vous demande si ces deux respectables personnes devaient avoir été de grandes princesses. Il faut bien passer quelque vanité aux pauvres gens. C’est le seul dédommagement de leurs misères.
Aussi n’était-ce pas ce petit travers qui tourmentait ma vive et sincère amitié pour la Fée aux Miettes. Elle en avait un autre, la bonne femme, qui m’affligeait mille fois davantage, le souvenir d’une ancienne beauté qu’elle ne croyait pas tout à fait effacée, et dont elle parlait en se rengorgeant, avec une complaisance qu’on ne pouvait s’empêcher de trouver risible. Je n’étais pas des derniers à m’en égayer en sa présence, car autrement je ne me le serais jamais permis. Je lui avais trop d’obligations pour cela. — Tu as beau plaisanter, méchant sournois, disait-elle alors en me frappant gentiment de sa béquille… il arrivera un jour où mes charmes auront assez d’empire sur le beau Michel pour le faire extravaguer d’amour … — De l’amour pour vous, Fée aux Miettes ! m’écriais-je en riant ; ni plus ni moins, en vérité, que pour ma bisaïeule, si elle ressuscitait aujourd’hui avec un siècle de plus sur la tête ; – et notre dialogue était bientôt couvert par les acclamations de toute la brigade joyeuse qui dansait en rond autour d’elle en chantant : Ah ! qu’elle est belle, la Fée aux Miettes !… Mais nous finissions par la cajoler un peu, et elle s’en allait contente…
Ce n’est pas que la caducité de la Fée aux Miettes eût rien de repoussant. Ses grands yeux brillants qui roulaient avec un feu incomparable entre deux paupières fines et allongées comme celles des gazelles ; son front d’ivoire où les rides étaient creusées avec des flexions si douces et si pures, qu’on les aurait prises pour des embellissements ajustés par la main d’un artiste ; ses joues, surtout, éclatantes comme une pomme de grenade coupée en deux, avaient un attrait d’éternelle jeunesse qu’il est plus facile de sentir que d’exprimer ; ses dents mêmes auraient paru trop blanches et trop bien rangées pour son âge, si, aux deux coins de sa lèvre supérieure, sa bouche fraîche et rose encore n’en avait laissé échapper deux, qui étaient à la vérité plus blanches et plus polies que des touches de clavecin, mais qui s’allongeaient assez disgracieusement d’un pouce et demi au-dessous du menton.
Et je me surprenais quelquefois à dire tout seul : Pourquoi la Fée aux Miettes ne s’est-elle pas fait arracher ces deux diables de dents ?…
La Fée aux Miettes ne montrait jamais ses cheveux, probablement parce qu’ils auraient contrasté avec l’ébène de ses sourcils. Ils étaient ramassés sous un bandeau d’une blancheur éblouissante, surmonté d’un fichu également blanc, plié en carré à plusieurs doubles, et posé horizontalement sur la tête comme la plinthe ou le tailloir du chapiteau corinthien. Cette coiffure, qui est celle des femmes de Granville, de temps immémorial, et dont on ne fait usage en aucune partie de la France, quoiqu’elle soit merveilleuse dans sa simplicité, passe pour avoir été apportée chez nous par la Fée aux Miettes, de ses voyages d’outre-mer, et nos antiquaires conviennent qu’ils seraient fort embarrassés de lui assigner une origine plus vraisemblable. Le reste de son costume se composait d’une espèce de juste blanc serré au corps, mais dont les manches larges et pendantes soutenaient au-dessous de l’avant-bras d’amples garnitures d’une étoffe un peu plus fine, découpée à grands festons, et d’une jupe courte et légère de la même couleur, bordée à la hauteur du genou de garnitures pareilles, qui tombaient assez bas pour laisser à peine entrevoir un pied fort mignon, chaussé de petites babouches aussi nettes que galantes. L’habit complet paraissait, je vous jure, plus frais, à telle heure et en tel endroit qu’on la rencontrât, que s’il venait de sortir des mains d’une lingère soigneuse ; et ce n’est pas ce qu’il y avait de moins extraordinaire dans la Fée aux Miettes, car elle était si pauvre, comme vous savez, qu’on ne lui connaissait de ressources que dans la charité des bonnes gens, et d’autre logement que le porche du grand portail. Il est vrai que les coureurs nocturnes prétendaient qu’on ne l’y rencontrait jamais quand minuit avait sonné, mais on n’ignorait pas qu’elle passait souvent ses nuits en prière à l’hermitage Saint-Paterne, ou à celui du fondateur de la belle basilique de Saint-Michel, dans le péril de la mer, sur le rocher où l’on voit encore empreint le pied d’un ange.
Comme mon histoire est pleine de tant d’événements incroyables que j’ai déjà quelque pudeur à les raconter, je me garderai bien d’ajouter à l’invraisemblance des faits qui n’ont d’autre garant que ma sincérité, l’invraisemblance des vaines conjectures populaires. La seule chose que je puisse attester sans crainte d’être contredit des personnes qui ont vu la Fée aux Miettes, et qui n’a pas vu la Fée aux Miettes à Granville !… c’est qu’il ne s’est jamais trouvé sur terre une petite vieille plus blanchette, plus proprette et plus parfaite en tout point.
Les seules distractions que je prenais alors, car j’étais fort affectionné au travail, c’était la recherche des papillons, des mouches singulières, des jolies plantes de nos parages, mais plus souvent la pêche aux coques, dont il faut, si vous le permettez, que je vous dise quelque chose.
Les grèves du mont Saint-Michel, alternativement couvertes et délaissées par les eaux, ont cela de particulier, qu’elles changent tous les jours d’aspect, de forme et d’étendue, et que le sable menu dont elles sont composées conserve l’apparence des récifs et des bas-fonds de la mer, avec toutes les embûches de cet élément, de sorte qu’elles ont en leur absence leurs vagues, leurs écueils et leurs abîmes. Ce n’est pas sans une certaine habitude qu’on peut y marcher hardiment, sans s’exposer, jusqu’au rocher pyramidal sur lequel Saint Michel a permis à l’audace des hommes de bâtir son église miraculeuse. Si un voyageur inexpérimenté s’égare de quelques pas, le sable trompeur le saisit, l’aspire, l’enveloppe, l’engloutit, avant que la vigie du château et la cloche du port aient eu le temps d’envoyer le peuple à son secours. Cet horrible phénomène a quelquefois dévoré jusqu’à des vaisseaux abandonnés par le reflux.
La nature est si bonne pour sa création, qu’elle a semé dans cette arène mobile une ressource plus abondante que la manne du désert. C’est cette petite coquille à sillons profonds et rayonnants dont les valves rebondies, et comme lavées d’un incarnat pâle, ornent si souvent le camail grossier du pèlerin. On l’appelle la coque, et sa recherche est devenue pour les habitants du rivage une de ces innocentes industries qui n’offensent au moins le regard de l’homme sensible, ni par l’effusion du sang, ni par la palpitation des chairs vivantes. L’attirail du pêcheur est tout simple. Il se réduit à une résille à mailles serrées qui pend sur son épaule, et dans laquelle il jette par douzaines son gibier retentissant ; et puis, à un bâton armé d’une pointe de fer peu crochue qui sert à la fois à sonder le sable et à le retourner. Un petit trou cylindrique, seul vestige de vie que les vagues aient respecté en se retirant, lui indique le séjour de la coque, et d’un seul coup de pic, il la découvre ou l’enlève. C’est de là qu’il montait à la face de l’Océan, le pauvre petit animal, sur une de ses écailles voguant en chaloupe, et sous l’autre, dressée comme une voile. Il y a aussi là-dedans une âme et un Dieu, comme dans toute la nature ; mais l’habitude a si vite appris aux enfants que rien n’est délicieux comme la coque, fricassée avec du beurre d’Avranches et des fines herbes !
Il y a loin de Granville aux grèves de Saint-Michel, et le chemin le plus court n’est pas le plus sûr à beaucoup près ; mais je m’y engageais volontiers quand j’avais trois jours de vacances devant moi, ce qui se présente souvent à l’époque des grandes fêtes, et mon oncle était enchanté de me voir essayer sans danger réel les fortunes du voyageur de mer. J’ai dit qu’on rencontrait quelquefois la Fée aux Miettes sur cette route, parce qu’elle avait une grande dévotion à Saint-Michel, et cette rencontre m’était toujours agréable, la Fée aux Miettes ayant des trésors de souvenirs qui rendaient sa conversation la plus intéressante et la plus profitable du monde. Je ne saurais dire comment cela se faisait, mais j’apprenais plus de choses utiles dans une heure de son entretien que les livres ne m’en auraient appris en un mois, ses courses lointaines et son bon jugement naturel l’ayant familiarisée avec toutes les études, comme avec toutes les langues. Elle joignait à cela une manière si saisissante et si lumineuse de communiquer ses idées, que j’étais étonné de les voir apparaître subitement dans mon intelligence, aussi claires que si elles s’étaient réfléchies sur la glace d’un miroir. D’ailleurs, la marche de la Fée aux Miettes ne retardait jamais la mienne ; si accablée qu’elle était du fardeau des ans, vous auriez dit qu’elle glissait sur le sable, plutôt que d’y imprimer ses pieds ; et, pendant que je mesurais de l’œil pour elle un rocher difficile à l’escalade, il m’arrivait quelquefois de l’apercevoir au sommet, et de l’entendre crier, en riant au éclats : « Eh bien, brave Michel, faut-il que je te tende la main ? »
Un jour que nous revenions ensemble ainsi, en causant des petites conquêtes d’histoire naturelle que j’avais faites la veille, et qu’elle s’amusait à me décrire aussi exactement qu’une bonne iconographie aurait pu le faire, les arbres à grandes fleurs des forêts de l’Amérique, et les papillons de lapis et d’or des deux presqu’îles de l’Inde : — Comment est-il donc advenu, Fée aux Miettes, lui dis-je, que vos voyages aient abouti à Granville où je me plais, parce que j’y suis né et que mes affections d’enfance y étaient, mais qui ne saurait vous offrir cet attrait de la patrie dont toutes choses s’embellissent ? Je vous avouerai que cela m’embarrasse un peu. — C’est précisément, répondit-elle, cet attrait de la patrie dont tu parles, qui me fait rechercher avec empressement les ports d’où la route d’Orient m’est toujours ouverte ; je comptais obtenir, tôt ou tard, de la charité des marins, mon passage sur quelque bâtiment, et les longues guerres qui viennent de finir m’ont, durant tout le temps de ton enfance, privée de cet avantage. Combien, si je ne t’avais connu, n’aurais-je pas regretté d’avoir quitté Greenock, où cette occasion se présente tous les jours, et où je n’étais du moins pas obligée de coucher sur la pierre froide, sous un porche battu du vent, car j’y avais et j’y ai encore, si Dieu l’a permis, une jolie maisonnette appuyée contre les murs de l’arsenal. Une autre raison, continua-t-elle en minaudant, et en me flattant du geste et du regard, c’est l’amour que j’ai conçu pour un petit cruel qui ne reconnaît pas ma tendresse. – Et puis, comme par un fâcheux retour sur elle-même, elle baissa les yeux, soupira, et parut repousser du dos de la main une larme prête à couler.
— Laissons, laissons, repris-je, cette plaisanterie hors de saison qui ne va pas à votre âge ni au mien ; une femme aussi pieuse et aussi sensée que vous êtes peut s’en faire un jeu innocent, mais elle viendrait mal dans une conversation sérieuse. Maintenant que la paix est faite, il n’y a rien de plus aisé que de vous assurer, avec vingt louis d’or de mes épargnes, un bon passage pour Greenock, qui n’est pas au bout du monde, mais qui doit être, si je ne me trompe, à six ou sept lieues plein ouest de Glasgow, dans le comté de Renfrew. Voyez, ma bonne mère, si cela vous accommode, et pour peu que vous pensiez y être plus heureuse qu’à Granville, je vous dispenserai avec plaisir de recourir à la générosité des mariniers.
— Et de qui veux-tu que j’accepte ce bienfait, Michel ? de toi, dont la fortune est peut-être perdue à jamais, au moment où tu y penses le moins ?
— Je ne sais, dis-je, Fée aux Miettes, mais la fortune réelle d’un maître ouvrier n’est jamais perdue, tant qu’il a des bras et du courage ; mon éducation est finie, mon aptitude au travail éprouvée, ma constitution vigoureuse, et mon âme ferme. L’avenir ne peut m’enlever désormais que ce qu’il plairait à la Providence de me ravir, et je suis tout résigné d’avance à ses volontés, parce qu’elle sait mieux ce qui nous convient que nous ne le savons nous-mêmes.
— Je te sais gré de ta générosité, repartit la Fée aux Miettes, mais tu comprends qu’elle n’inquiète pas médiocrement ma pudeur et ma délicatesse. Passe encore si tu me laissais l’espérance de partager un jour ma petite fortune avec la tienne et de devenir ton heureuse femme !
— Oh ! oh ! Fée aux Miettes, que ce ne soit pas cela qui vous arrête, dis-je à mon tour, en lui cachant le mieux que je le pus le fou rire dont sa proposition faillit me faire éclater. Je suis, à la vérité, fort loin de penser aujourd’hui à un établissement aussi grave que le mariage, mais tout vient à son temps dans la vie ; nous sommes gens de revue, s’il plaît à Dieu, et je ne réponds de rien, si nous nous retrouvons quelque part, quand je serai mûr pour prendre le parti que vous dites. Au moins puis-je vous répondre que je n’ai contracté jusqu’ici aucun engagement qui m’en empêche !
— Tu me combles de joie, mon cher Michel, et il n’y a plus qu’une chose qui m’arrête. J’ai eu le bonheur de te servir quelquefois de mon expérience et de mes conseils, et tu n’es pas encore arrivé au point de t’en passer toujours. Si tu me procures le moyen de retourner à Greenock, ne te manquera-t-il rien quand je serai partie ?
— De vous savoir heureuse, Fée aux Miettes.
En prononçant ces paroles, je serrai cordialement sa petite main qui tremblait dans la mienne, et je rencontrai ses yeux animés, en se fixant sur moi, d’un feu extraordinaire que je n’avais jamais vu briller dans ceux d’une femme.
Serait-il possible, en effet, me demandai-je en la quittant, que cette pauvre vieille m’aimât ?
VII.
Comment l’oncle de Michel se mit en mer, et comment Michel fut charpentier.
J’avais réellement vingt louis d’or en réserve sur les gratifications de douze francs que mon oncle André ne manquait pas de me distribuer tous les dimanches, et dont il me restait toujours quelque chose, parce que je ne dépensais que ce que je trouvais l’occasion de donner. Cependant, je n’étais pas sans quelque scrupule sur le droit que je pouvais avoir de disposer à seize ans d’une somme aussi forte, et si je m’étais engagé très avant dans ma promesse à la Fée aux Miettes, c’est que je savais que mon oncle André ne me contrariait jamais, et qu’il me contrarierait moins encore, en cette occasion, sur l’honnête emploi d’un argent inutile.
Quand j’entrai le soir dans sa chambre, son maintien grave et rêveur m’interdit. J’imaginai d’abord que le moment n’était pas favorable pour lui faire ma confidence, et je me retirais doucement, lorsque j’entendis qu’il me rappelait.
« Michel, me dit-il, en me faisant asseoir en face de lui, et en prenant une de mes mains entre les siennes, Mon cher Michel, le moment dont je t’avais parlé est venu, sans que nous ayons reçu de nouvelles de Robert. Il faut donc, mon fils, que je parte, et que j’accomplisse le devoir d’un bon associé, d’un bon frère et d’un honnête homme, pour retrouver la trace de ton père, qui ne peut m’échapper ; et s’il m’est impossible d’y parvenir, – Dieu veuille nous épargner cette douleur, – pour recueillir du moins quelques débris de la fortune qu’il devait te laisser. Cette résolution était formée de loin, comme tu sais, et mes mesures sont si bien prises, que l’arrivée inopinée de Robert en pouvait seule empêcher l’effet. Voilà le sablier vide, et celui qui marque les années de ma vie s’épuise aussi. Je n’ai pas dû perdre de temps, mais j’ai voulu m’épargner autant que possible la vue des larmes qui mouillent tes joues, et qui tombent amèrement sur mon cœur d’homme. Tu es assez fort aujourd’hui pour mettre de toi-même le courage d’un vieillard à l’abri de cette épreuve. Essuie tes yeux, petit, et embrasse-moi avec la fermeté d’un noble garçon. Je pars demain. »
À ces mots, les sanglots m’étouffèrent, je n’eus pas la force de me lever pour me jeter dans les bras de mon oncle André, et je cachai ma tête entre ses genoux.
« Voilà qui est bien, dit-il d’une voix assurée. Cela se dissipera comme un nuage, et gaiement j’espère, car le soleil est à l’horizon. J’aurais plus de motifs que toi de m’inquiéter, si je te laissais dans une position qui pût m’alarmer sur ton avenir, mais tu as bien profité de tes études et de ton apprentissage, et je ne crois pas qu’il y ait un homme dans les cinq parties du monde qui puisse se passer plus allégrement de cette fiction de la fortune, qu’on n’a inventée, crois-moi, que pour les infirmes et les paresseux. Tu es grand, bien fait, alerte, suffisamment informé des connaissances utiles, et, par-dessus tout cela, comme je l’ai désiré, un des bons ouvriers qui aient jamais fait crier une scie et retentir un maillet dans les chantiers de Granville. Toutes les inclinations que je te connais sont pour le travail et la médiocrité, et je n’ai plus besoin de te rappeler qu’une médiocrité aisée, qui est meilleure que la richesse, ne manque jamais au travail. C’est demain que tu entres à la journée chez ton charpentier, et c’est à compter de demain que chaque jour te rapporte un salaire. Comme j’ai pourvu à te conserver jusqu’à la Saint-Michel prochaine, dans la maison où nous sommes, le domicile, la nourriture, et toutes les nécessités de la vie, sans compter mes vieilles nippes et tout ce qui en dépend, dont tu useras à ton plaisir, cette première année de profit, que tu peux convertir en économies, suffira pour t’assurer, à chaque année qui suivra, le modeste bien-être auquel tu es accoutumé, et dont tu n’as jamais désiré de sortir ; car une année d’avance pour un ouvrier est un trésor plus solide que ceux du grand Mogol. Et si je te fais tant d’éloges de l’économie que je n’ai jamais beaucoup pratiquée par moi-même, ce n’est pas que je la considère comme un moyen d’enrichissement, mais parce que je ne connais point d’autre moyen d’indépendance. À cela près, c’est la moindre des vertus réelles, et il n’y a pas de libéralité bien placée, pourvu qu’elle le soit sans calcul et sans ostentation, qui ne vaille mieux qu’une économie. »
Ces paroles de mon oncle, dites en pareilles circonstances, enlevaient un poids énorme de dessus mon cœur. J’étais maître de vingt louis que je venais de promettre à la Fée aux Miettes, et dont elle avait si grand besoin ! Mon oncle continua :
« Il me reste peu de choses à te dire, et je t’en dispenserais, si la vieille naine de l’église, que vous appelez, je crois, la Fée aux Miettes, n’était venue m’apprendre, un instant avant que tu n’entrasses auprès de moi, qu’elle partait demain pour sa petite ville de Greenock, où je ne sais quels intérêts, peut-être imaginaires, réclament la présence de cette pauvre femme, et pour me demander en même temps si je t’autorisais à disposer en sa faveur de tes petites épargnes, dont tu es tout-à-fait le maître, et que tu ne peux mieux employer de ta vie qu’à soulager une honnête misère. Je suppose seulement, Michel, que tu as compté sur ton travail pour les remplacer ? »
Sur un signe d’affirmation et de plaisir que je lui fis alors : — « À merveille, reprit mon oncle, tu vois que je sais prévenir tes confidences, et pour revenir à mon discours, je m’en serais volontiers rapporté à la Fée aux Miettes de ces derniers enseignements, parce que c’est une femme de bon conseil, dans tout ce qui ne touche point à quelques rêveries assez bizarres dont elle s’est infatuée, mais que nous devons passer à son grand âge ; et aussi parce qu’elle a toujours été portée de si bonne intention pour notre maison, que mon père n’hésitait pas à lui attribuer le succès de ses meilleures entreprises, et l’agrandissement de son bien, au point de la mettre à l’aise si elle l’avait voulu, et si elle n’eût préféré obstinément son vagabondage mystérieux à une existence plus solide. Les bonnes dispositions que Dieu t’a données, et dont il m’a été permis de voir le germe éclore et se développer sous mes yeux, me permettent d’ailleurs d’abréger beaucoup ces instructions, et de les rapporter seulement au nouvel état que tu vas embrasser pendant mon absence.
» Quoique tu ne sois pas né pour lui, ne le méprise jamais, et surtout, ne le quitte jamais par orgueil. Le parvenu qui dédaigne le métier qui l’a nourri n’est guère moins méprisable que l’enfant dénaturé qui renie sa mère.
» Sois charpentier avec les charpentiers. Ne te distingue d’eux par ton éducation qu’autant qu’il le faut pour leur en communiquer lentement le bienfait sans les humilier. Crois que ceux qui t’écoutent avec une envie sincère de s’instruire, valent presque toujours mieux que toi, puisqu’ils doivent à un instinct naïf de ce qui est bien ce que tu ne dois, peut-être, qu’au hasard de la naissance et au caprice de la fortune.
» Ne fuis pas les plaisirs de tes camarades. Le plaisir est de ton âge. Ne t’y livre pas aveuglément. Le plaisir auquel on s’est livré sans défense et sans retour, devient le plus inexorable des ennemis.
» Si ton cœur s’ouvre à l’amour des femmes avant de me revoir, n’oublie pas, de quelque charme qu’elle soit revêtue, que toute femme qui détourne un homme du soin de son devoir et de son honneur est moins digne d’amour que la naine de l’église. L’amour est le plus grand des biens, mais il n’est jamais vraiment heureux tant qu’il ne satisfait pas la conscience.
» Souviens-toi, de plus, qu’un homme de ton âge qui a par devers lui une année d’existence assurée, le goût du travail et de la simplicité, un tempérament robuste, une santé à l’épreuve et un bon métier, est cent fois plus riche que le roi, quand il joint à tout cela douze francs vaillant dans sa poche ; six francs pour satisfaire aux besoins de son imagination, six francs pour adoucir le sort d’un pauvre, ou pour soulager les angoisses d’un malade.
» Enfin, si les principes de religion que je t’ai inculqués soigneusement depuis le berceau s’effaçaient de ton esprit, ce qui n’est que trop à craindre par le temps qui court, retiens-en au moins deux pour l’amour de moi, parce qu’ils peuvent tenir lieu de tous les autres ; le premier, c’est qu’il faut aimer Dieu, même quand il est sévère ; le second, c’est qu’il faut se rendre utile aux hommes autant qu’on le peut, même quand ils sont méchants. »
Après cela, il me quitta en me serrant la main.
Quand je fus de retour dans ma chambre, j’envoyai mes vingt louis à la Fée aux Miettes.
Le lendemain, sans m’en prévenir, mon oncle partit de bonne heure en me laissant tout ce qui m’était nécessaire pour un an. La Fée aux Miettes, qui n’avait pris que le temps de manifester son contentement devant mon commissionnaire, par une de ses explosions familières de joie fantasque et capricieuse, était partie dès la veille.
Je restai seul, – tout seul, j’essuyai quelques larmes, et j’allai à l’atelier.
VIII.
Dans lequel on apprend qu’il ne faut jamais jeter ses boutons au rebut sans en tirer le moule.
L’année qui suivit aurait été douce, car il n’y a rien de plus doux que de gagner sa vie, si l’absence de mon père et celle de mon oncle, qui me tenait lieu de père, depuis longtemps, n’avaient laissé un vide profond dans mon cœur. Je regrettais souvent que celui-ci ne m’eût pas permis de le suivre dans ses recherches lointaines, malgré toutes mes prières, sous prétexte que j’étais réservé à autre chose, et que mon obéissance pouvait seule lui faire espérer que nous nous trouverions tous réunis un jour. Je pensais aussi à la Fée aux Miettes, car elle m’avait aussi aimé.
La Saint-Michel revint sans que j’eusse amassé d’économies, parce que mes amis se faisaient sans cesse de nouveaux besoins que je ne comprenais pas toujours, mais auxquels je ne pouvais m’empêcher de compatir. Jacques Pellevey était vicaire, mais il vaquait deux ou trois bonnes cures dans le diocèse, et cela le forçait à de fréquents voyages à l’archevêché. Didier Orry, qui était de plusieurs années plus âgé que moi, commençait à penser au mariage, et il ne pouvait se flatter de réussir dans quelques espérances qu’il avait formées, s’il ne se faisait voir avec avantage à la préfecture. Quant à Nabot, qui m’avait rendu sincèrement son amitié depuis que nos rivalités d’école avaient cessé, il s’était adonné au jeu, et n’y était pas plus heureux qu’au collège. Il était de mon devoir de le dissuader de ce penchant, et je n’y épargnais pas mes efforts. Il était aussi de mon devoir de l’aider à réparer le mal qu’il se faisait, surtout quand les résultats de cette malheureuse passion menaçaient de compromettre sa réputation, et je n’y épargnais pas mon argent. Enfin quand l’année expira, et avec elle les dernières ressources que la bonté de mon oncle m’avait ménagées, je fus réduit à celles de mon travail journalier, qui me fournissait à peine de quoi vivre assez pauvrement ; mais je m’y étais préparé, et je ne m’en trouvai pas plus malheureux.
Comme je m’étais perfectionné dans mon métier en le pratiquant, et que j’annonçais d’ailleurs cet esprit d’ordre et d’activité qui tient lieu de l’intelligence des affaires, l’entrepreneur qui nous employait alors et dont les entreprises allaient mal, probablement parce qu’il avait trop entrepris à la fois, s’avisa je ne sais comment de m’en confier la direction ; je ne fus pas deux jours à cette nouvelle tâche, que je m’aperçus qu’il était malheureusement trop tard pour sauver sa fortune. Je ne profitai donc pas de l’augmentation de mon salaire, et je le laissai dans ses mains, en me contentant de prélever avec mes compagnons ce qui me revenait comme à eux pour le travail ordinaire de l’établissement que je n’avais pas quitté, car les conseils de mon oncle André m’étaient trop présents pour que j’eusse un moment conçu le dessein de devenir autre chose qu’un artisan. Je passai par conséquent cette seconde année sans pouvoir mettre à côté l’un de l’autre ces deux écus de six francs, dont l’un appartient au luxe et l’autre à la charité, et qui suffisent au bonheur d’un homme obscur et laborieux. Comme elle finissait, le maître, obsédé par ses créanciers, passa un beau jour à Jersey, et nous laissa sans occupation et sans moyen d’existence, les chantiers de Granville étant toujours fournis d’ouvriers habiles, dont le nombre excédait déjà celui que réclament les besoins ordinaires du pays. Ce malheur ne fut cependant très réel que pour moi, mes camarades l’ayant prévu depuis plus longtemps que je n’avais fait, et s’étant précautionnés contre l’événement, en plaçant leurs petits fonds dans une assez jolie spéculation de cabotage qui commençait à prospérer. Comme je leur avais inspiré de l’attachement, et qu’ils connaissaient l’état de ma fortune si rapidement déchue, ils vinrent m’offrir d’entrer en partage avec eux, et ils mirent dans cette proposition une effusion si franche et si tendre, que j’en fus touché jusqu’aux larmes. J’avoue même que je n’aurais pas fait difficulté de me rendre à leurs instances, dans l’espoir de payer utilement ma quote-part en industrie et en talents, si mon parti n’eût été pris d’avance. Je ne pouvais compter, à la vérité, ni sur Jacques Pellevey, quoiqu’il fût devenu curé, ni sur Didier Orry, quoiqu’il eût fait un mariage opulent. L’un me promettait bien une place de maître d’école quand elle serait vacante, mais le titulaire était un homme vert et vigoureux ; l’autre me réservait un logement et un accueil fraternel dans sa maison, pour y être précepteur de ses enfants, aussitôt qu’ils seraient sortis des mains des femmes, mais on venait de porter le premier en nourrice, et c’était, si je ne me trompe, une fille. Tous deux étaient si empêchés de satisfaire à leurs frais d’établissement, qui devaient être, en effet, fort considérables, que je crois qu’ils n’avaient jamais été plus réellement pauvres que depuis qu’ils étaient riches, de sorte que mon malheur n’avait rien à envier, même quand j’en aurais été capable, au malheur de mes amis. Je pouvais moins encore penser à Nabot, qui jouait toujours, qui ne gagnait jamais, et qui n’était pas encore parvenu à concevoir qu’un homme bien né ne pût se réduire à ce qu’il appelait la honte de travailler. Je dois lui rendre la justice de dire qu’il était devenu plus expansif et plus affectueux, en devenant plus à plaindre. Tout ce que nous pouvions l’un pour l’autre, c’était de rire ou de pleurer ensemble, quand je n’avais pas trouvé d’occupation, et c’est une compensation qui répare tant de misères, que je me suis quelquefois demandé alors si je voudrais y renoncer, au prix de cette prospérité sans nuage dont la monotonie sèche le cœur.
Je ne crois pas vous avoir dit quelle résolution j’avais prise. Je me proposai d’aller offrir mes services de ville en ville et de village en village, partout où il se trouverait un pont à jeter sur la rivière, ou une maison à construire, et comme cela ne manque jamais, j’étais sûr aussi que la providence ne me manquerait pas. Elle ne manque qu’aux oisifs.
Ce qui m’affligeait le plus, c’est que mes habits avaient vieilli, et que j’avais quelque pudeur de me présenter à la fête de Saint-Michel en si mauvais équipage, non que j’attachasse beaucoup de prix pour moi à cette recommandation extérieure, mais parce que le délabrement de ma toilette pouvait faire penser aux honnêtes gens dont j’avais eu le bonheur de gagner l’estime que j’avais cessé de la mériter par ma conduite. Je comprenais pour la première fois le besoin que tous les hommes ont de l’opinion, et je sentais que la satisfaction de nous-même, qui réside essentiellement dans notre conscience, se maintient et se fortifie par le jugement que les autres portent de nous ; j’apprenais, s’il faut le dire, une vérité toute nouvelle ; c’est que l’homme en société, quelque progrès qu’il ait fait dans l’exercice de la vertu, ne peut se passer de considération, pour être justement content de lui, et qu’on est bien près de renoncer à sa propre estime quand on dédaigne celle du monde. Je me souvins heureusement que mon oncle avait laissé ses vieux habits à ma disposition, et j’en fis la revue avec une joie pareille à celle de Robinson, lorsqu’il se rendit compte des richesses utiles de son vaisseau, certain que le meilleur des parents et des amis ne me reprocherait pas d’en avoir usé, surtout quand je lui dirai dans quelle extrémité j’y avais recouru, car il croyait à ma parole. Il y avait en effet du beau linge bien net, et des habits si proprement accoutrés qu’on les aurait crus faits à ma taille. Seulement, des deux vestes qu’il n’avait pas comprises dans son bagage, l’une, qui paraissait toute neuve et qui m’allait comme un charme, était garnie de dix gros vilains boutons d’un drap fort grossier, et l’autre que je l’avais vu porter, et qui était taillée d’un goût plus ancien, se fermait de dix boutons d’une espèce de nacre dont la matière était fort brillante et le travail fort délicat. Je n’hésitai point à me mettre à la besogne pour substituer ceux-ci aux autres, et les dix boutons à l’œil de perle et aux reflets d’argent ne tardèrent pas à resplendir à mes yeux enchantés, comme autant de jolis miroirs.
Dès le premier coup de ciseau que je portai aux autres, soit précipitation, soit maladresse, le moule s’échappa ; il roula par terre aussi prestement que s’il avait été lancé par un joueur de siam ou par un discobole, jusqu’à la pierre de mon âtre, où il continuait à rouler avec une petite vibration sonore semblable à celle d’or, et je crois, je vous jure, qu’il roulerait toujours si je ne l’avais arrêté de la main. C’était en effet un louis double.
Vous pensez bien qu’il ne tomba pas de la vieille veste de mon oncle André un seul bouton qui ne fût un louis double aussi, et je n’en tirai pas un de son enveloppe que mes joues ne s’humectassent de quelques pleurs de reconnaissance pour la tendre prévoyance de ce père d’adoption, qui m’avait réservé si à propos cette ressource contre des revers inattendus. Je me retrouvais maître, en effet, de vingt louis, c’est-à-dire de la plus forte somme que j’eusse jamais possédée, et qui n’est pas de peu de conséquence dans la vie, puisqu’elle avait suffi au bonheur de la Fée aux Miettes. Comme c’était la juste mise des fonds de nos caboteurs, et que cet état industrieux et honnête, mais qui n’est pas sans périls et sans aventures, me plaisait beaucoup en espérance, je m’empressai de les prévenir que j’étais en état de contribuer de toute ma part aux entreprises de la société, dès le premier voyage qui devait avoir lieu dans trois jours. Et c’était précisément le temps qui m’était nécessaire pour accomplir, selon notre usage, le devoir de mon pèlerinage annuel à l’église de Saint-Michel, dans le péril de la mer.
Je partis le lendemain au point du jour, la résille sur l’épaule, la pointe à coques à la main, mes vingt louis dans la ceinture ; plus riche, plus heureux, plus dispos que je n’avais jamais été. — Voyez Michel, disaient les mères, quand j’embrassais sur le chemin les camarades que j’avais eus à l’école ! – Le pauvre garçon a perdu toute sa fortune, sans qu’il y eût de sa faute ; mais, comme il a toujours été laborieux, sage et craignant Dieu, il ne manque de rien ; et il porte une si belle chemise de toile fine à petits plis, et une si belle veste à boutons de nacre de perle, qu’on jurerait qu’il va se marier ce matin à la chapelle de son saint patron. Où avez-vous trouvé, bon Michel, ces superbes boutons de nacre qui brillent de loin comme des étoiles ?… » je répondais en rougissant que je devais tout à mon oncle André, dont la seule bonté m’avait préservé de la misère. – Mais je n’aurais pas rougi de la misère même, parce que je ne me reprochais rien.
Ma pêche aux coques fut si productive, que je m’étonnais en vérité qu’il en pût entrer un si grand nombre dans ma résille, quoique personne dans le pays n’en eût d’aussi large et d’aussi profonde. Cependant, j’en avais donné trois fois autant pour le moins à de pauvres gens si disgraciés, ce jour-là, qu’ils auraient retourné la grève de fond en comble sans en tirer une coquille. Cela me fit penser que la Providence me protégeait, et que saint Michel accueillait favorablement les prières que j’allais lui porter pour mon père, pour mon oncle, et pour la Fée aux Miettes, seuls protecteurs que Dieu m’eût donnés sur la terre. Aussi quand les pêcheurs eurent vendu leurs provisions, je régalai tous les pèlerins d’une partie de la mienne, et je payais l’apprêt du peu d’argent qui me restait, sans toucher à mes vingt louis, dont l’emploi était réglé dans mon esprit avant mon départ.
IX.
Comment Michel pêcha une fée, et comment il se fiança.
Je revenais gaiement du mont Saint-Michel, en chantant ce refrain d’une ballade que les jeunes gens de Granville avaient apprise de je ne sais qui, si ce n’est de la Fée aux Miettes :
C’est moi, c’est moi, c’est moi !
Je suis la Mandragore,
La fille des beaux jours qui s’éveille à l’aurore,
Et qui chante pour toi !
Je jetais cependant de temps à autre un coup d’œil sur le golfe de sable que domine avec tant de majesté la pyramide basaltique de Saint-Michel. C’était un de ces jours redoutables où la grève, plus mobile et plus avide encore que de coutume, dévore le voyageur imprudent qui se confie au sol sans le sonder. Le sable enlisait, comme on dit communément, et le glas du clocher avait annoncé déjà deux ou trois accidents. J’entendis tout à coup des cris qui appelaient du secours, et je vis en même temps l’apparence d’un corps bizarre qui n’avait rien de la forme humaine, mais qui attirait les regards par sa blancheur, et qui semblait lutter contre l’abîme, par une force particulière de résistance que je ne m’expliquais pas. Je courus à l’endroit d’où le bruit parvenait ; mais à l’instant où j’eus lancé la corde d’enliseque nous portons toujours dans nos résilles, sur le point du gouffre où j’avais vu disparaître cette créature infortunée qui gémissait encore, elle ne pouvait plus s’en emparer, et toute l’arène retombait sur elle en tourbillonnant comme dans un entonnoir profond. Je vous laisse à juger de mon désespoir, d’autant plus amer que j’avais cru entendre articuler mon nom dans son dernier appel à la pitié des voyageurs. Je me hâtai d’y plonger ma pointe à coques, pour la ressaisir par quelqu’un de ses vêtements, et je m’aperçus avec un plaisir inexprimable que mon bâton s’attachait par son croc de fer à un corps ferme et résistant qui me donnait la force de ramener à moi l’être incompréhensible que j’avais voulu sauver. Je luttai là, monsieur, contre Charybde acharnée à sa proie, et je ne fus pas peu surpris, quand j’eus traîné mon précieux fardeau jusqu’au lit de sable ferme et solide qui se trouvait tout auprès, comme à dessein, de reconnaître la Fée aux Miettes qui respirait, qui vivait et que mon harpon avait heureusement retenue, en s’engageant sous une de ses longues dents. — Parbleu, dis-je cette fois, la Fée aux Miettes n’a pas eu si grand tort que je le pensais, de conserver ces deux terribles dents qui choquaient ma délicatesse d’écolier, et l’expérience prouve aujourd’hui mieux que jamais que prudence et modestie valent mieux que beauté. – Cette idée m’inspira une gaieté si extravagante, quand je vis la Fée aux Miettes se relever sur ses petits pieds, et sautiller joyeusement comme une de ces figurettes fantasques qui vibrent sur le piano des jeunes filles, que je ne pus retenir mes éclats de rire. Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que la Fée aux Miettes, en deux pirouettes et en deux bonds, s’était débarrassée de toute la poussière qui chargeait cet attirail de poupée dont je vous ai parlé auparavant, et qui n’aurait fait aucun tort à l’étalage élégant d’un vendeur de jouets. — En vérité, Fée aux Miettes, m’écriai-je en riant toujours, car elle n’avait pas cessé de danser, c’est affaire à vous de rajuster promptement une toilette endommagée, et vous en apprendriez de belles à nos marchands de modes, car vous voilà, sur mon honneur, plus leste et plus fringante que je ne vous ai vue autrefois, quand vous étiez mon amoureuse. Mais oserais-je vous demander, Fée aux Miettes, par quel singulier hasard cette riche suzeraine de tant de domaines, qui a daigné appuyer sa maison de campagne contre les murs d’un pauvre arsenal du Renfrew, s’enlisait dans les sables du mont Saint-Michel, quand tous ses amis la croyaient à Greenock ?
À ces paroles, la Fée aux Miettes pinça les lèvres d’un air moitié humble et moitié coquet, autant que ses longues dents pouvaient le lui permettre, et, après avoir minuté dans sa pensée quelques formules oratoires, elle me répondit ainsi :
— Je serais fâchée, Michel, que la suffisance, qui est si ordinaire aux jeunes gens, surtout quand ils sont beaux et bien faits comme vous êtes, aveuglât votre esprit au point de vous faire croire que c’est une passion insensée qui me ramène dans les environs de Granville. Non, Michel, poursuivit-elle d’une voix émue, dont l’expression mélancolique et presque larmoyante contrastait singulièrement avec les accès de gaieté où je venais de la voir, non, la déplorable princesse de l’Orient et du Midi, la malheureuse Belkiss, ne s’est point flattée de vaincre l’obstination d’une âme insensible qui ne peut la payer de retour ! Elle ne s’est pas dissimulé qu’elle ne devait qu’à un mouvement de pitié l’illusion dont vous avez un jour entretenu sa vaine espérance, au moment où vous pensiez vous en séparer pour jamais ! N’imaginez donc pas que le sentiment invincible qui la domine ait pu la porter à oublier toutes les bienséances de sa naissance et de son sexe, et qu’elle vienne s’exposer encore une fois à des mépris qui briseraient son cœur, ou implorer de votre compassion des consolations passagères et des promesses trompeuses qui trahiraient votre pensée !…
J’avouerai que ce langage imprévu changea subitement les dispositions joyeuses de mon esprit, et que je me trouvai presque aussi triste en l’écoutant que la malheureuse princesse Belkiss elle-même. Je ne doutais pas en effet que l’horrible danger auquel la Fée aux Miettes venait d’échapper par une espèce de miracle n’eût achevé de déranger son esprit, et qu’elle ne fût devenue folle à lier. Cette idée m’affecta péniblement, car la conversation des fous m’a toujours inspiré un attendrissement profond, et je sentis que je n’avais pas fait assez pour cette pauvre femme en la rappelant à la vie, si je ne parvenais à rendre quelque espérance à son esprit et quelque bonheur à son imagination, pour le peu d’années que son grand âge lui permettait encore d’espérer.
— Écoutez, Fée aux Miettes, lui dis-je, puisque vous prenez tout ceci au sérieux, je vous proteste qu’il n’a jamais été dans mon intention d’abuser de votre crédulité par un mensonge, car le mensonge me fait horreur. Je fais plus ; je prends à témoin le grand saint Michel, mon patron, que je vous recommandais encore ce matin à la protection du ciel, au pied de sa glorieuse image devant laquelle nul homme n’oserait déguiser le moindre secret de sa conscience ; et que le nom d’aucune autre femme ne s’est présenté à moi dans mes prières, le vôtre étant le seul qui me rappelle une affection et un devoir, depuis le moment où j’ai reçu tout à la fois le premier et le dernier baiser de ma mère. Quant à l’amour, que je regarde, sur la foi des autres, comme une des plus douces distractions de la paresse, il ne trouve guère de place dans une vie partagée entre les travaux du corps et les études de l’esprit, surtout avant l’âge de dix-huit ans que j’ai à peine atteint depuis quelques jours. Dieu sait donc que s’il me fallait choisir aujourd’hui une femme, je n’en connais pas une autre au monde sur laquelle je pusse arrêter ma pensée ; mais il ne serait pas bienséant, vous en conviendrez, que je m’occupasse de mariage, en l’absence de mon père et de mon oncle, avant d’avoir vingt et un ans accomplis. Ce que je vous dis là, Fée aux Miettes, est la véritable expression de mes sentiments, et vous ne liriez point autre chose dans mon cœur, si vous aviez le privilège d’y lire tout ce que j’éprouve, comme je l’imaginais quand j’étais enfant.
— Tu m’épouseras donc, dit-elle, quand tu auras trois ans de plus ?
Et, comme je la regardais pour m’assurer de l’effet que mon petit discours avait produit sur elle, je m’aperçus qu’elle sautillait, sautillait, et qu’elle souriait d’un air de satisfaction qui n’était pas sans malice. Tout à fait rassuré sur sa santé et sur son bonheur, qui tenait à si peu de chose, je me laissai retourner au penchant de ma gaieté de jeune homme avec un entraînement dont, à dire vrai, je n’étais pas tout à fait le maître.
— Oui, divine Belkiss, m’écriai-je en lui tendant la main en signe de fiançailles, je vous promets par ces constellations éclatantes du Sud et de l’Orient qui baignent maintenant de leurs lumières argentées les vastes États que vous possédez dans les royaumes favoris du soleil, que je vous épouserai dans trois ans, si mon père et mon oncle y consentent, ou si leur absence, prolongée contre tous mes vœux, me permet alors de disposer de moi-même. Je vous le promets, princesse du midi, à moins que votre auguste famille, dont vous venez de me révéler les titres imposants, ne porte obstacle à la mésalliance, peut-être unique dans l’histoire, qui introduirait un simple garçon charpentier dans la couche d’une personne royale.
En achevant ces derniers mots, je mis un genou en terre, et je baisai respectueusement la main blanche de la Fée aux Miettes, qui dansait si haut que j’étais obligé de la retenir, de peur qu’à force de s’élever elle ne m’échappât tout à fait.
— C’est assez, me dit-elle en rayonnant de plaisir, et en se suspendant à mon bras pour gagner Granville, mais il faut maintenant que je t’apprenne pourquoi je suis restée dans le pays, et pourquoi je cherchais à t’y retrouver. Pendant deux ans, je n’avais osé me présenter devant toi, parce que l’argent que tu m’as si gracieusement prêté m’avait été volé par les bédouins.
— Sur les côtes d’Afrique, Fée aux Miettes !… et qu’alliez-vous faire là ? Ce n’est pas, si la carte n’est trompeuse, le droit chemin de Greenock !
— Sur les côtes de la Manche, mon cher Michel, par des voleurs du pays. Pardonne-moi cette confusion de noms qui se ressent de mes vieilles habitudes de voyage. – Après un tel accident, et dans la position où je te connaissais, je n’aurai pu me montrer à tes yeux sans rougir de ma déconvenue, et peut-être sans t’affliger. Je me réfugiai donc au hasard partout où j’avais lieu d’espérer l’accueil de la charité, en me rapprochant autant qu’il m’était possible des endroits où je pouvais entendre parler de toi. Je ne tardai pas à savoir que les dernières ressources du travail venaient de t’échapper, et que tu étais au point de manquer d’un habit neuf à la Saint-Michel. La pauvre Fée aux Miettes se serait inutilement évertuée à te secourir, mais j’allais trottant de côté et d’autre pour trouver quelque voie à te tirer d’embarras, et j’avais ce succès d’autant plus à cœur qu’il m’était revenu que tu penchais d’entrer dans le cabotage, qui n’est pas une profession malhonnête, mais qui te réduirait à un ordre d’habitudes incompatibles avec ton éducation et avec tes mœurs. Je me hâtais donc d’aller t’apprendre qu’il n’est question dans le pays d’où je sors que de belles entreprises à la gloire de la Normandie, et qui demandent l’intelligence et les bras des plus habiles ouvriers, comme de relever la maison de Duguesclin à Pontorson, de décorer celle de Malherbe à Caen, d’étayer celle de Corneille à Rouen, où elle menace d’encombrer avant peu la rue de la Pie de ses ruines, et peut-être de consacrer quelque monument au Havre à la mémoire de ton cher Bernardin. Ce qu’il y a de plus sûr encore, c’est qu’on frète, qu’on radoube et qu’on carène tous les jours des navires à Dieppe, et que je t’ai ménagé, grâce à Dieu, assez de débouchés sur la côte pour pouvoir t’assurer positivement que l’ouvrage ne t’y manquera pas. C’était le besoin de te faire part de ces nouvelles qui me ramenait aux environs de Granville, quand la Providence a permis que tu te rencontrasses sur les grèves du mont Saint-Michel pour me sauver la vie, et, bien mieux que cela, cher enfant, pour l’embellir d’une perspective délicieuse qui me la rendrait maintenant plus regrettable que jamais. –
Pendant que la Fée aux Miettes parlait, et, quoiqu’elle parlât fort vite, elle parlait fort longtemps, j’avais été en mesure de me recueillir sans perdre le fil de ses idées et de ses enseignements.
— Je vous remercie, ma bonne amie, lui répondis-je, des soins que vous avez pris pour moi, et qui me sont aussi chers qu’ils me seront profitables ; mais je vois par ce que vous dites que vous vous êtes seule oubliée dans nos communs malheurs, car je me souviens de la passion avec laquelle vous désiriez de rentrer dans votre jolie maison de Greenock, et je comprends tout ce que cette espérance frustrée a dû vous laisser de chagrin. Puisqu’il m’est permis de vivre du produit d’un travail que j’aime, sans tenter la fortune inconstante du cabotage, à laquelle je ne m’étais livré qu’à défaut d’un genre de vie plus assorti à mon goût et à ma capacité, allons maintenant chacun de notre côté où nos inclinations nous appellent. Voilà, continuai-je en tirant mes dix doubles de ma ceinture, voilà vingt louis que j’allais exposer aux caprices de la mer, et qui vous ouvriront facilement cette fois la route de Greenock, si vous prenez mieux vos précautions contre les voleurs, qui doivent être naturellement alléchés par la coquette élégance de votre toilette. Quant à moi, je serai dans deux jours à Pontorson, et je rapporte plus de coques dans ma résille, même quand vous en aurez pris double part, si cela vous convient, Fée aux Miettes, qu’il ne m’en faut pour une semaine.
La Fée aux Miettes paraissait embarrassée de quelque scrupule dont je n’eus pas de peine à me rendre raison.
— Allons, allons ! repris-je en riant, vous savez, Fée aux Miettes, qu’il n’y a plus de façons à faire entre nous ; souvenez-vous que nous sommes fiancés, et qu’entre fiancés toutes les chances de l’avenir se partagent ; moi, une bonne industrie, vous, un peu d’argent, c’est notre dot ; nous réglerons nos comptes à Greenock, le propre jour de la noce.
— J’accepte, répondit la Fée aux Miettes, si je te suis effectivement fiancée, et il m’est avis que tu ne t’en trouveras pas mal.
— Fiancé, comme Rachel le fut à Jacob, Ruth à Booz, et la reine de Saba, qu’on nommait Belkiss, ainsi que vous, au puissant roi Salomon !
Là-dessus, je baisai sa main encore une fois, et nous nous séparâmes, la Fée aux Miettes plus riche de vingt louis, et moi de la satisfaction d’une libéralité juste et utile, qui ne peut s’estimer au prix d’aucun des trésors de la terre.
J’arrivai bien tard à Granville, et je dormis aussi cette nuit-là plus longtemps que d’habitude, plongé dans un rêve singulier qui se reproduisait sans cesse, et qui consistait à pêcher dans le sable une multitude de jeunes princesses, éblouissantes de charmes et de parure, et à les voir danser en rond autour de moi, chantant, sur l’air de la Mandragore des paroles d’une langue inconnue, mais que je trouvais harmonieuse et divine, quoiqu’il me semblât l’entendre par un autre sens que celui de l’ouïe, et l’expliquer par une autre faculté que celle de la mémoire. Ces princesses ne se lassaient donc pas de chanter, de danser, et de déployer devant moi mille séductions ravissantes qui me gagnaient le cœur, quand je fus tout de bon réveillé par mes camarades, les caboteurs, qui répétaient le même refrain sous ma fenêtre, à gorge déployée :
C’est moi, c’est moi, c’est moi !
Je suis la Mandragore,
La fille des beaux jours qui s’éveille à l’aurore,
Et qui chante pour toi !
Je compris qu’ils étaient sur le point de partir, et qu’ennuyés de m’attendre au port, ils s’étaient décidés à venir rompre mon sommeil, pour m’emmener avec eux.
— Hélas ! mes chers amis, dis-je en ouvrant ma haute croisée, je n’ai plus l’argent que je croyais avoir et que Dieu m’a repris comme il me l’avait donné ; je ne puis maintenant que vous accompagner de mes vœux, et vous serez plus heureux s’ils sont exaucés que je n’aspire à l’être jamais. Allez donc sans moi, camarades bien-aimés, et souvenez-vous quelquefois de votre pauvre frère Michel, qui se souviendra toujours de vous.
Ce fut alors pendant quelques moments un profond et triste silence ; mais tout à coup le plus malin et le plus hardi de la bande se détacha des autres et me cria d’une voix railleuse et amère : — Malheur à toi, Michel, car tu manques la plus belle occasion de fortune qui puisse se présenter de ta vie entière à un ouvrier de Granville, et cela par ton obstination dans d’extravagantes amours ! – Croiriez-vous, compagnons, ajouta-t-il en se retournant de leur côté, que ce visionnaire, auquel vous avez cru, comme moi, du bon sens et de l’esprit, s’est assez entiché d’une femme pour lui prodiguer le reste de l’argent que son oncle André lui avait laissé, et qu’elle dépense insolemment, la folle qu’elle est, à des pommades parfumées, à des gants glacés de Venise, à des falbalas aux petits plis, et en autres inutiles bagatelles ? Ce qui vous étonnera bien davantage, c’est que cette malicieuse étourdie, qu’il entretient secrètement des débris de sa fortune, et qui nous enlève notre malheureux ami !… c’est la Fée aux Miettes !
À ce mot, la risée fut si générale que je n’en pus supporter l’humiliation, et que je revins tomber sur mon lit en me disant : — Pourquoi pas la Fée aux Miettes ? – Car il y a quelque chose dans l’esprit de l’homme qui lutte contre le jugement de la multitude, et qui s’opiniâtre en raison directe de la contrariété qu’elle oppose à nos sentiments.
— Pourquoi pas la Fée aux Miettes, si cela me convient ? répétai-je avec force, pendant que les caboteurs s’éloignaient en chantant la Mandragore, qui retentissait encore à mon oreille quand je m’endormis. – Et comme les rêves qui ont vivement occupé l’imagination se renouvellent plus facilement que les autres, surtout dans le sommeil du matin, mes yeux n’étaient pas clos que je pêchais encore des princesses plus belles que les anges, aux grèves du mont Saint-Michel.
Quelque chose de surprenant que je ne dois pas omettre, c’est qu’il n’y en avait pas une qui ne me rappelât plus ou moins les traits de la Fée aux Miettes, à part ses rides et ses longues dents.
X.
Ce qu’était devenu l’oncle de Michel, et de l’utilité des voyages lointains.
Je me levais tout disposé à me mettre en route pour Pontorson, mais je ne voulus pas partir sans chercher une dernière fois au port quelques renseignements sur la destinée de mes parents, dont je n’avais rien appris, et sans voir en même temps si mes amis avaient la mer favorable pour leur petite expédition. Nos caboteurs filaient lestement par un joli vent frais, et je prenais plaisir à les suivre du regard dans un horizon riant où il n’y avait pas l’apparence du moindre grain, quand je crus reconnaître à quelques pas de moi un honnête marin qui était parti comme pilote sur le bâtiment de mon oncle André.
— Est-ce bien vous, maître Mathieu, m’écriai-je, et quelles nouvelles m’apportez-vous ?…
— Aucune qui soit bonne, me répondit-il tristement, et c’est ce qui me retenait de vous en faire part, quoique je fusse de retour à Granville depuis trois jours.
— Mon Dieu, ayez pitié de moi, dis-je les larmes aux yeux ; mon pauvre oncle est mort !
— Rassurez-vous, bon Michel ! votre oncle n’est pas mort, mais il vaudrait tout autant, car il est devenu fou, le cher homme, et si fou qu’on ne vit jamais folie pareille à la sienne !
— Expliquez-vous, Mathieu…
— Imaginez-vous, monsieur, qu’après dix-huit mois de voyages heureux et lucratifs, un jour que nous étions arrivés… – Mais je ne saurais vous dire en vérité à quelle hauteur nous nous trouvions…
— Épargnez-moi ces détails inutiles… Expliquez-vous, je le répète.
— Soit, monsieur. À peine avions-nous débarqué sur un beau sable, mêlé comme à dessein de petits coquillages de toutes les couleurs, dans une île dont aucun itinéraire n’a fait mention, je le certifie, depuis le jour où la navigation est en usage, que votre oncle s’enfonça, d’un air satisfait et délibéré, à travers des bois délicieux qui couronnent une des baies les plus magnifiques du monde…
— Et il ne revint pas ?…
— Il revint le soir, ingambe, joyeux, et comme rajeuni, si je ne me trompe, de quelques bonnes années ; et, après nous avoir réunis : J’ai trouvé ce que je cherchais, dit-il en se frottant les mains, et mon voyage est fini ; à cette heure, enfants, vous avez bonne aiguade et vivres frais qui dureront sans malencontre jusqu’aux eaux de la Manche, où le ciel vous conduise ; je donne à l’équipage le bâtiment avec ses gréements neufs et sa riche cargaison, moyennant que vous ayez regagné le port de Granville avant la Saint-Michel…
— Prenez garde, Mathieu, je tremble de vous entendre ! Qu’avez-vous fait de votre capitaine ?
— Monsieur, répartit Mathieu d’un ton calme et sévère, je suis porteur de cette donation écrite en forme, et il convient si peu à l’équipage de s’en prévaloir, qu’il a décidé d’un commun accord de vous rendre une propriété que nous ne pouvons regarder comme la nôtre, quoique nous ayons rempli toutes les conditions qui nous étaient imposées pour l’acquérir ; mais j’ai commencé par vous dire que le capitaine était fou, et que ses actes nous paraissaient nuls en bonne justice.
— Qui vous le prouve, Mathieu, repris-je avec force ? Mon oncle était maître de sa fortune, et il ne pouvait mieux en disposer qu’en faveur de ses vieux camarades de mer. Ce qu’il vous a donné est à vous, et loin d’avoir fait en cela preuve de folie, il a très sagement agi, puisqu’il savait que l’éducation dont je suis redevable à ses bienfaits me met en état de me passer des ressources que son vaisseau m’aurait rendues, tandis qu’elles ne seront pas inutiles à soulager la vieillesse et les fatigues de vos camarades.
— C’est précisément ce qu’il nous dit, interrompit Mathieu, quand nous nous empressâmes de faire valoir vos droits, et l’incertitude de votre position. — D’ailleurs, ajouta-t-il dans son délire, dont vous ne douterez plus, mon neveu a usé de ses économies en faveur de la Fée aux Miettes, et s’il n’est pas content de son sort, qu’il épouse la Fée aux Miettes ! Après quoi il nous quitta en éclatant de rire.
— Voilà qui est extraordinaire, dis-je à demi-voix en laissant retomber ma tête sur ma poitrine.
— C’est ce que nous avons pensé ; mais quelque chose de plus extraordinaire encore, c’est qu’en cherchant à pénétrer le mystère de sa folie, nous avons appris que le bon vieillard se croit surintendant des palais d’une princesse Belkiss, qui règne suivant lui sur ces parages depuis je ne sais combien de milliers d’années, et dont son frère cadet, votre père, feu Robert, d’honorable mémoire, commande en chef toutes les forces maritimes.
— Cela n’est pas possible, Mathieu ; et c’est vous qui êtes fou d’oser soutenir des choses pareilles. La princesse Belkiss, qui pourrait bien avoir en effet l’âge que vous dites, se trouve à Granville de sa personne, et je puis même attester qu’elle a passé la dernière nuit sous le porche de l’église.
— Incompréhensible puissance de Dieu ! cria le pilote en se couchant de sa longueur sur un vieux mât vermoulu qui gisait là sur le port, et en étouffant de ses deux mains un mélange de rires et de larmes, la princesse Belkiss sous le porche de l’église de Granville ! Pourquoi faut-il que la même infirmité ait frappé en même temps toutes les dernières espérances d’une si digne famille !
— Taisez-vous, Mathieu ; et, si vous m’aimez, n’ébruitez pas ces paroles qui n’ont point de sens pour vous, et qui, à vrai dire, ne me paraissent guère plus raisonnables à moi-même. Passez seulement dans ma chambre, où je confirmerai avec plaisir la donation de mon oncle, afin de satisfaire aux inquiétudes de votre conscience, et ne tardez pas surtout, car il faut que j’arrive incessamment à Pontorson pour y chercher de l’ouvrage. –
Ma dix-neuvième et ma vingtième année furent donc employées comme les deux années qui les avaient précédées ; mais elles me furent plus profitables, parce que le travail tenait trop de place dans mes journées pour que j’eusse le temps de contracter de nouvelles amitiés, dont les douces obligations se seraient mal conciliées avec les petites habitudes de l’économie, devenues pour moi si nécessaires. Ce n’était pas qu’on s’occupât de toutes les nobles opérations dont la Fée aux Miettes m’avait offert la perspective, et qui flattaient délicieusement mon imagination, mais on travaillait partout ; et, comme elle me l’avait promis, je n’avais qu’à m’appuyer de son crédit chez un maître charpentier, pour y trouver sur-le-champ de la besogne à faire et de l’argent à gagner. À peine me restait-il une heure par jour pour feuilleter mes livres d’affection, dont je n’avais jamais eu le triste courage de me défaire ; encore fallait-il la prendre souvent sur mon sommeil. Les dimanches seulement, après l’office, je pouvais donner le reste de la journée à l’étude ; et si c’était trop peu pour apprendre, c’était presque assez pour ne pas oublier. Je finissais au Havre ces années errantes, et cependant laborieuses, le propre jour de la Saint-Michel, quand je fus averti du départ d’un petit bâtiment, nommé la Reine de Saba, dont le capitaine ne devait connaître sa destination qu’en mer, parce qu’il était chargé d’une mission fort secrète, mais où l’on recevait sans frais de passage les ouvriers de bonne volonté, ce qui me fit penser qu’il s’agissait probablement d’une entreprise de colonisation. Mon livret était si bien tenu que je fus reçu sans objection, et je dois ajouter que le nom de la Fée aux Miettes, qui se retrouvait, je ne sais pourquoi, dans tous mes certificats, ne tombait jamais sous les yeux de personne, sans m’attirer des marques particulières de bienveillance, tant l’esprit et la vertu ont de privilèges, même dans les conditions les plus misérables de la vie humaine, et au jugement des hommes que la pratique des affaires dispose le moins à condescendre aux intercessions de la pauvreté.
J’avais vingt louis d’épargne dans ma ceinture, et j’étais sûr de vivre sans peine partout où le travail ne serait pas compté pour rien ; mais ce qui me décidait par-dessus toutes choses à tenter la fortune chanceuse de ce bâtiment sans but et sans direction connue, c’est que je me flattais que la Providence me ferait peut-être aborder cette côte incertaine où elle avait relégué mon oncle et mon père, et que ma jeunesse, et mon zèle à les servir, ne leur seraient pas inutiles. Cette idée s’était fixée dans mon esprit, à force d’y descendre, comme une divine inspiration, à la fin de toutes mes prières.
XI.
Qui contient le récit d’une tempête incroyable, avec la rencontre de Michel et de la Fée aux Miettes en pleine mer, et ce qui en arriva.
Ce fut là, monsieur, un voyage extraordinaire, et dont aucune aventure de mer ne vous donnerait l’idée. Nous commençâmes à cingler, par un beau temps fixe, avec une rapidité si incroyable, qu’il nous fallait filer plus de nœuds par heure que jamais fin voilier de la côte n’en avait compté dans un jour. Le matin du lendemain, le temps se brouilla, et l’horizon devint si confus qu’il nous était impossible de déterminer la hauteur du soleil. Bientôt l’aiguille de la boussole se mit à tourner sur son pivot d’une manière extravagante, au point qu’elle s’effaçait à l’œil comme le rayon d’un char emporté par des chevaux effrayés. Tous les rhumbs de vent couraient les uns sur les autres, comme si l’atmosphère n’avait été qu’une trombe, et le vaisseau, avec ses voiles carguées, sifflait horriblement en roulant sur l’Océan comme une toupie gigantesque. Des oiseaux d’une figure épouvantable se prenaient dans les mailles de nos bastringues, des poissons monstrueux tombaient en bondissant sur le tillac, et le feu Saint-Elme jaillissait de toutes les pointes de nos mâts et de nos manœuvres, en flammes si pressées qu’on aurait dit la gerbe épouvantable d’un volcan. Ce qui m’étonnait le plus dans ce spectacle, c’est que le capitaine fumait paisiblement sa pipe sur le pont, sans prendre garde aux phénomènes de la mer et du ciel, et que l’équipage dormait tranquille autour de lui, quand tout s’abîma.
Je fus un moment couvert par les flots, et quand je revins à la surface, je n’aperçus rien que le ciel, qui me paraissait plus pur qu’à notre départ, et une côte peu éloignée qu’il n’était pas impossible de gagner à la nage. J’étais près d’y atteindre, lorsqu’il me sembla que je voyais à quelque distance de moi une espèce de sac alternativement poussé et repoussé par les eaux, mais qui perdait progressivement de l’espace, et que la première vague devait infailliblement reporter en pleine mer. Je ne me serais pas détourné pour m’en saisir, si je n’y avais soupçonné que de vaines dépouilles de notre naufrage, car mes forces commençaient à s’affaiblir, mais il me sembla qu’il avait un mouvement qui lui était propre, et qui manifestait la résistance et les efforts d’un être vivant. Je me confirmai dans cette pensée au moment de le saisir, tant il bondissait étrangement sur les flots, et je me hâtai de me glisser dessous, en le retenant fortement d’une main, pendant que je nageais de l’autre pour arriver à la plage, qui était par bonheur la plus accessible et la plus douce du monde. J’y fus déposé si mollement que je n’aurais pas choisi moi-même un lit plus commode où me reposer de mes fatigues, si je n’avais pensé avant tout à remercier Dieu de mon salut, et à rendre des soins qui pouvaient être pressants à la pauvre créature qu’il venait de me permettre de sauver. Vous jugerez de mon étonnement, monsieur, quand, après avoir ouvert le sac avec précaution, j’en vis sortir la Fée aux Miettes, qui, sans prendre garde à moi, se sécha de la tête aux pieds, en deux ou trois pirouettes au soleil, et vint s’asseoir ensuite à mes côtés sur le sable où j’étais retombé, en riant, mais plus blanche, plus proprement ajustée, et plus agaçante encore que de coutume.
— Ô Fée aux Miettes ! lui dis-je, que le ciel m’est favorable de me faire trouver partout où vous avez besoin de moi pour vous retirer des périls de la mer ! Vous en avez encore échappé une belle, cette fois ; mais aussi qu’aviez-vous à faire de retarder pendant deux ans votre voyage à Greenock ?
— C’est ainsi, répondit-elle, que parlent ceux qui n’aiment pas. Crois-tu qu’il soit si aisé de se séparer de l’être adoré auquel on a lié sa vie, et dont on attend son bonheur ? Que savais-je d’ailleurs si tu trouverais les ressources que je t’avais un peu légèrement promises, et si tu n’aurais pas plus d’une fois besoin de l’or dont ta générosité t’avait engagé à te dessaisir pour moi ! Je te suivais donc, sans me laisser voir, dans les villes que tu habitais, toujours prête à te secourir en cas de nécessité, car les aumônes que je recevais en chemin suffisaient abondamment à ma subsistance. Quand j’appris enfin que tu étais muni d’assez bonnes économies, et que tu avais d’ailleurs ton passage franc pour Greenock, où tu dois m’épouser dans un an, selon ta promesse, à pareil jour qu’hier, touchée de cette marque de ton souvenir et de ta fidélité, je me décidai à faire route sur le même bâtiment que toi ; mais, pour ne pas te tourmenter d’une poursuite importune, je me cachai soigneusement à un coin de l’entrepont, dans le sac qu’une heureuse inspiration t’a porté à sauver du naufrage, afin que je te dusse encore une fois la vie.
— Permettez, Fée aux Miettes ! il y a ici quelque chose qui m’embarrasse, et qui fait trop d’honneur à mon exactitude de fiancé pour que j’accepte vos éloges sans explication. Je ne savais point que ce bâtiment fît voile pour Greenock, et je pensais même que sa destination était ignorée de tout l’équipage.
— Cela est possible, reprit la Fée aux Miettes, et je ne répondrais pas moi-même qu’il ne fût entré quelque erreur de sentiment dans les calculs de mon amour. Tu comprendras un peu plus tard, mon cher Michel, ces tendres surprises de la passion quand tu les auras éprouvées !
— Je le crois, Fée aux Miettes, mais nous n’en sommes pas encore là, puisque je n’ai que vingt ans, qu’une année de plus peut vous apporter des réflexions sérieuses, et que mon cœur n’est, grâce au ciel, pas plus ouvert aux impressions de l’amour, sur cette rive inconnue, qu’il ne l’était il y a deux ans sur les grèves du mont Saint-Michel, où vous faillîtes vous engloutir, et où vous dansâtes si bien ! Mais vous, qui savez toutes choses, ne sauriez-vous pas, Fée aux Miettes, en quel endroit nous sommes si aventureusement débarqués ?
— Si je me suis bien orientée, et tu ne saurais croire combien cela est difficile dans un sac, nous devons être tout à fait à l’est des îles Britanniques, à très peu de distance d’une ville riche et bien peuplée, où tu ne manqueras pas de moyen d’existence pour réparer la perte de tes nippes et de ton argent. Quant à moi, qui avais malheureusement payé d’avance les frais de mon passage, et qui m’estime à plus de cinquante lieues de ma petite maison de Greenock, il faut que je renonce à y rentrer jamais ! –
Cette horrible perspective contrista si horriblement la Fée aux Miettes, qu’elle fut obligée de presser sa lèvre inférieure de ses deux grandes dents, et de toutes les jolies petites dents qui les séparaient, pour ne pas laisser échapper un soupir.
— Voici qui tourne bien mieux que vous ne pouviez l’imaginer, dis-je gaiement à la Fée aux Miettes. Mes nippes, qui sont de peu de valeur, consistent en quelque linge que je porte dans ce havresac, et mon argent, auquel vous me faites penser, ne doit pas être sorti de cette ceinture. –
En parlant ainsi, je la déroulai sur le sable, et il en tomba ma bourse de vingt louis d’or.
— Prenez donc hardiment, continuai-je, et retournez sans vous fatiguer, par des voitures commodes, à votre petite maison de Greenock, pour que le faible service que j’ai voulu vous rendre deux fois en ma vie, ne reste pas imparfait. Puisque nous ne sommes pas loin d’une ville, je ne suis pas embarrassé de gagner honnêtement ce qu’il faut pour ne pas mourir de faim, et je me flatte qu’il n’y a point de charpentier dans toute la Grande-Bretagne qui ne se trouve heureux de m’avoir à ce prix ; quant à cet argent, qui ne représente dans mes mains que le triste besoin des jours de paresse, il me ferait horreur si vous m’obligiez de le garder comme un avare, pendant qu’une amie dont les conseils m’ont été si utiles en a besoin. Prenez, prenez, je vous le répète, et ne vous mettez en peine de rien que du devoir d’exécuter les volontés d’un fiancé qui sera dans un an votre époux. C’est à cette marque d’obéissance, ajoutai-je avec une gravité burlesque, c’est à elle seule, Fée aux Miettes, que je puis mesurer la foi que j’ai mise en vos engagements, et dans la promesse que vous m’avez faite de vivre à notre ménage en femme soumise et respectueuse.
— Souffre au moins, dit la Fée aux Miettes qui s’était relevée en ramassant ma bourse, et qui sautillait à l’ordinaire sur sa béquille : souffre, avant cette cruelle et dernière séparation, que je te laisse un gage de ma tendresse, dont la vue puisse adoucir ton impatience amoureuse. C’est mon portrait, poursuivit-elle, en tirant de son sein un médaillon suspendu à une chaîne. Qu’il te souvienne seulement de ne jamais l’offrir aux regards d’un homme, car je connais son funeste effet sur les cœurs ; il trouble du premier abord les raisons les plus éprouvées, et ce n’est que pour toi, mon bien-aimé, qu’il est sans danger de contracter cette folie, dont la prochaine possession de ma main te guérira. –
J’avoue que l’heureuse confiance avec laquelle la Fée aux Miettes débitait ces sornettes, me jeta, comme à l’ordinaire, en des transports de gaîté impossibles à contenir ; mais elle était si disposée à juger d’elle avantageusement, qu’elle ne s’en aperçut que pour y prendre part, dans la pensée, comme j’imagine, que c’était la délicieuse perspective de notre union qui commençait à me faire extravaguer.
— Regarde, regarde ce portrait, reprit-elle en me montrant le ressort qui servait à le découvrir ; regarde, je te prie, et ne t’afflige pas si la ressemblance en est un peu altérée. Il était frappant, quand il fut fait par un artiste inimitable ; mais il est probable que le temps a donné à mes traits une expression plus sérieuse ; et peut-être, si je ne me trompe, un certain air de majesté qui n’est pas moins séant à un beau visage que la grâce coquette des jeunes filles. Cependant, je ne suis pas fâchée que tu me voies telle que j’étais alors, et que tu m’en dises ton avis. –
Je me taisais…, ou je laissais à peine échapper quelques exclamations confuses, comme les balbutiements d’un homme endormi qui se croit frappé d’une apparition…
— Ô miracle du ciel ! m’écriai-je enfin, l’âme attachée tout entière à cette image, Dieu a plus fait en vous produisant de sa parole, ange adorable entre tous les anges, qu’en faisant éclore du chaos le reste de sa création !… Prodige de grâce et de beauté, ravissante Belkiss, où êtes-vous ?
— Elle est devant tes yeux, répondit la Fée aux Miettes ; ne la reconnais-tu pas ?… –
Je détachai en effet mes regards du portrait magique pour savoir si ce miracle ne s’était pas opéré ; mais je ne vis que la Fée aux Miettes, qui prenait pour elle de si bonne foi les éclats de mon admiration, qu’elle ne pouvait plus résister à l’instinct pétulant de ses inclinations dansantes, et qu’elle sautait sur elle-même avec une élasticité incroyable, comme une balle sur la raquette, mais en augmentant progressivement, et suivant une sorte d’ordre chromatique, la portée de son élan vertical, au point de me faire craindre encore qu’elle finît par ne plus redescendre.
— Pour Dieu, Fée aux Miettes, lui dis-je en imposant fermement mes deux mains sur ses épaules, afin de la retenir au bond, ne vous obstinez donc pas à faire des tours de force pareils, si vous ne voulez vous estropier de manière à ne jamais vous trouver au rendez-vous nuptial !
— Oh ! j’y serai, j’y serai, j’y serai, dit la Fée aux Miettes en me narguant de sa béquille. Tu verras comme j’y serai !… –
Cependant, je ne l’écoutais plus, je ne la voyais plus. Je ne voyais, je n’entendais que ce portrait de femme qui parlait pour la première fois à un sens de mon âme, nouvellement révélé. Je ne sais comment cela se faisait, mais j’éprouvais que le sentiment même de ma vie venait de se transformer en quelque chose qui n’était plus moi, et qui m’était plus cher que moi ?… Ce n’était pas une femme comme je l’avais comprise ; ce n’était pas non plus une divinité, comme je l’avais imaginée. C’était cette divinité, revêtue d’un extérieur où elle daignait s’assortir à la faiblesse de mes organes, sous des apparences qui troublent sans faire tout à fait mourir. C’était cette femme radieuse d’une expression indéfinissable, et dont la vue comblait mon cœur d’une félicité plus achevée et plus parfaite que toutes les félicités fantastiques de l’imagination. Et je me perdais dans cette contemplation, comme le dévot extatique pour qui le ciel des mystères vient de s’ouvrir.
Tout à coup une de mes mains faisant tomber un peu d’ombre sur le médaillon, du côté d’où provenait la lumière du soleil, je m’aperçus que les pierres qui le bordaient jetaient une petite clarté qui leur était propre, et qui tremblait dans mes doigts, à la manière de ces lueurs phosphoriques dont on voit scintiller le feu bleuâtre sur les anneaux du ver luisant. Cela me rappela les escarboucles dont les anciens et les voyageurs ont si souvent parlé, et je m’avisai que ce médaillon devait être une chose fort précieuse, d’autant plus que je reconnus à l’instant qu’il était d’or pur. Cette idée me tira de la préoccupation passionnée où j’étais plongé, et ramena mon esprit à la Fée aux Miettes, sans distraire entièrement mes regards de l’image délicieuse de Belkiss.
— Sur ma foi de chrétien, Fée aux Miettes, pour une femme intelligente, savante, prudente, et en qui l’âge au moins n’a pas manqué à l’expérience, il faut que vous ayez été bien maladroitement chanceuse dans toutes vos aventures, puisque vous voilà pauvre et mendiante, depuis je ne sais combien d’années, avec un médaillon que le lapidaire du roi ne pourrait certainement pas payer, mais sur lequel il vous aurait fondé de belles rentes qui vous donneraient maison de ville, maison de campagne, un carrosse à quatre chevaux, et huit laquais galonnés sur toutes les coutures. Hâtez-vous donc de me reprendre, non pas ce portrait qui m’est plus précieux que la vie, mais ce médaillon qui vaut intrinsèquement mieux que votre maison de Greenock, même quand on vous rendrait l’arsenal et la ville avec ! –
La Fée aux Miettes ne répondant pas à cette allocution, je la cherchai des yeux à mes côtés, et je vis qu’elle était à plus de deux cents pas au détour que faisait la grève, tant j’avais été absorbé longtemps dans mes réflexions, ou tant la Fée aux Miettes allait vite quand elle était pressée. Je me pris sur-le-champ à courir de toutes mes forces, en l’appelant à grands cris, mais elle avait déjà disparu. Le besoin de me défaire le plus tôt possible d’un trésor dont elle ne connaissait pas le prix, me donnait des ailes aux talons, et je ne doutais pas de la rejoindre à l’instant, lorsqu’en arrivant à un autre angle de la côte d’où l’on découvrait plus de demi-lieue d’étendue, je l’aperçus tout au sommet d’une petite montée qui fermait fort nettement l’horizon, et sur laquelle elle sautillait, la béquille en arrêt d’une main, l’autre bras étendu en balancier, et la jupe arrondie au vent, comme vous avez vu, sur la corde des marionnettes, la gracieuse Pretty, l’objet des passions illégitimes de Master Punck. J’aurais eu beau crier pour la retenir, mais je précipitai cette fois ma course avec tant d’impétuosité qu’un de nos bons chevaux de Normandie aurait eu peine à me suivre, et que je me réjouissais de tomber à ses côtés comme une bombe à la première descente, quand je me trouvai au-dessus d’une route d’une lieue en ligne droite qui était terminée au point où ses deux parallèles allaient se rejoindre, en vertu de la perspective et en dépit de la géométrie, par une petite figure toute blanche, si preste, si leste et si modeste qu’on n’en vit jamais de plus avenante, et qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à la Fée aux Miettes, regardée par le grand verre d’une lorgnette d’opéra.
Là je m’assis d’accablement, en calculant que, dans la même progression, la Fée aux Miettes se retrouverait nécessairement derrière moi avant que j’eusse parcouru la circonférence de la terre, et en me consolant, dans l’intérêt de cette pauvre femme, par la pensée qu’un bijou si rare, et si longtemps exposé à tant de hasards, fût au moins tombé dans des mains fidèles.
— Je ne suis pas en peine, dis-je, de lui faire parvenir sûrement ce médaillon à Greenock, avec une lettre où je lui en expliquerai la valeur, puisque ce genre de connaissances paraît être le seul qui ait échappé à l’immense étendue de son esprit.
Quant au portrait qu’elle m’a donné, je le garderai, si elle le permet !… — S’il faut y renoncer, ajoutai-je les yeux collés sur le cristal, les lèvres tremblantes, et le cœur gonflé, s’il faut y renoncer, je mourrai !… –
Je ne cessai de contempler le portrait de Belkiss jusqu’à la ville que la Fée aux Miettes m’avait annoncée, et comme elle m’avait appris que nous étions dans les îles britanniques, je me proposais de m’informer en anglais à la première personne qui se rencontrerait sur ma route de l’endroit où j’arrivais. Ce fut une jolie petite fille, toute roulée, à cause du froid, dans un plaid quadrillé, et qui regagnait le pays sur des jambes aussi blanches qu’ivoire, en piétinant comme un oiseau de rivage.
— By God, me dit-elle en me frappant légèrement du bout de son plaid, comme pour me punir d’une plaisanterie de mauvais goût, il faut, beau charpentier, que mistress Speaker n’ait pas mis aujourd’hui d’eau dans votre vin, ou que l’honnête Finewood, votre maître, vous ait régalé lui-même d’un peu plus d’ale que de coutume, pour que vous ayez oublié le nom de votre petite Folly Girlfree.
— Ce n’était pas cela que je vous demandais, Folly, répondis-je en riant à cette méprise de ressemblance ; c’est le nom de cette ville où nous entrons ensemble, et que j’ai oublié, je ne sais comment, quoique je n’aie bu aujourd’hui ni le vin de mistress Speaker, ni l’ale de l’honnête Finewood, mais une eau maussade et salée qui m’a peut-être troublé la mémoire…
— Le nom de Greenock ! s’écria Folly en arrêtant sur moi ses deux yeux ronds et noirs. Vous êtes donc fou, mon ami !
— Greenock, dites-vous !… serait-ce là Greenock !… –
Et au chemin que la Fée aux Miettes m’avait fait faire, je me doutais bien que j’avais gagné beaucoup de terrain. – Mais cent cinquante lieues, c’était un peu fort.
XII.
Où il est traité pour la première fois de la cérémonie du mariage légal chez les chiens civilisés.
Comme le soleil était déjà très bas quand j’arrivai à Greenock, je ne jugeai pas à propos de me présenter ce jour-là chez ce maître Finewood dont m’avait parlé Folly, et j’allai demander un asile pour la nuit dans la première auberge qui se trouva sur mon chemin, car il me restait quelques petites pièces de monnaie qui n’étaient pas entrées dans le compte net de mes épargnes. Je tombai justement chez cette mistress Speaker dont je venais d’apprendre le nom, et qui, probablement trompée ainsi que Folly par une ressemblance singulière m’accueillit d’une voix éclatante, avec de grandes, éloquentes et prolixes démonstrations d’amitié.
— Cependant, mon cher enfant, me dit-elle, je ne peux te rendre ce soir ni ta chambre, ni ton lit, la maison étant occupée de fond en comble par la noce du bailli de l’île de Man, et je ne saurais t’offrir que ce pailler où couchent ordinairement les deux dogues de la maison qui sont aujourd’hui de fête. – Comme j’étais plus pressé de me reposer que de soutenir conversation avec mistress Speaker, dont le flux de paroles menaçait de ne pas tarir, je me hâtai de rompre un morceau de pain, arrosé d’un verre de small-beer, et de gagner la couche coutumière de ces deux chiens de bonne humeur qui avaient eu la complaisance très grande de choisir le jour précis de mon arrivée à Greenock pour se mettre en frairie.
Mais, à peine étendu sur la paille, je m’aperçus, à mon grand déplaisir, que le lieu de réunion où s’étaient rendus les principaux locataires de mon appartement ne pouvait pas être fort éloigné, tant mon oreille fut assourdie d’un mélange confus de hurlements, de jappements, d’abois, de grognements, de grondements, de pioulements, de murmures, pris dans toute l’échelle de la mélopée canine, depuis la basse ronflante du mâtin de basse-cour jusqu’à l’aigre fausset du roquet, et qui formait certainement le morceau d’ensemble le plus extraordinaire dont il ait jamais été question en musique.
Mes yeux n’ayant pu se fermer de la première moitié de la nuit, je ne fus réellement pas fâché d’être distrait de mon impatience et de mon insomnie par la noce du bailli de l’île de Man, qui passait solennellement de la salle du festin à la salle du bal, et qui traversait pour s’y rendre le vestibule sous lequel j’étais couché. Le tintamarre épouvantable qui m’avait incommodé jusque-là s’était changé d’ailleurs en une sorte de glapissement doux et presque mélodieux, qui n’était pas modulé sans coquetterie. Je m’assis sur ma paille pour considérer ce spectacle, et vous serez d’accord, monsieur, qu’il valait la peine d’être vu !… C’était, en vérité, une société galante et choisie, mais composée de simples chiens, différents seulement de tailles et d’espèces, et remarquables, à l’envi les uns des autres, par la politesse recherchée de leurs manières et par le goût exquis de leur toilette, la crinière retapée dans le dernier genre, la moustache troussée et cirée à l’espagnole, l’épée horizontale, l’habit leste et pincé, le chapeau sous le bras gauche, et la main droite à leurs dames, avec toute la bienséance requise. Jamais je n’avais vu tant de rubans, de paillettes et de galons ! Il me sembla reconnaître même les deux dogues de mistress Speaker, au regard profondément dédaigneux qu’ils laissèrent tomber sur moi, en passant devant le chenil qu’ils avaient occupé la veille.
Quand le cortège eut défilé tout entier, je me recouchai en méditant sur les bizarreries de la nature, qui a répandu des variétés si incroyables dans l’œuvre de la création ; car, bien que j’eusse entendu souvent parler de cette race d’hommes cynocéphales dont il est fait mention dans Hérodote, Aristote, Ælien, Plutarque, Pline, Strabon, et une multitude d’autres auteurs dont la sagesse, l’expérience et la sincérité ne sauraient être révoquées en doute, je n’y avais pas eu trop de foi jusqu’à ce jour, et je n’aurai jamais soupçonné surtout qu’elle eût jeté, près de l’embouchure de la Clyde, une colonie douée d’une aptitude si soudaine aux perfectionnements les plus raffinés de la civilisation. Aussi avais-je peine à me persuader à mon réveil que je n’eusse pas fait un songe, et que ce ne fût pas la Fée aux Miettes qui se divertissait, dans je ne sais quel dessein, et au moyen peut-être de je ne sais quel secret qu’elle avait rapporté de ses voyages, à infatuer mon esprit de ces visions fantasques. Cette pensée m’absorba tellement que je commençai à douter de ce qui m’était arrivé depuis deux jours, et que j’eus peur de chercher inutilement sur mon sein le portrait enchanteur auquel j’avais dû la veille des extases si délicieuses.
— Hélas ! dis-je en moi-même, toute ma vie n’est que chimères et caprices, depuis que la Fée aux Miettes s’en mêle, probablement pour mon bien, et tout ce qui me survient d’impressions heureuses comme d’illusions grotesques, n’est sans doute qu’un jeu de ses fantaisies. Je n’ai peut-être jamais vu le portrait de Belkiss ! –
Au même instant, je portai machinalement la main sur le médaillon ; le ressort s’ouvrit, je crois, sans que je l’eusse touché, et Belkiss m’apparut plus belle encore que la veille.
— Dieu soit loué ! m’écriai-je en me précipitant à genoux devant cette image vivante, car elle parlait à mon âme par une voix mystérieuse, et le céleste sourire de ses lèvres et de son regard répondait à ma pensée avec une expression si fidèle que j’aurais craint de le troubler par une émotion inquiète… –
— Dieu soit loué, Belkiss ! je n’avais pas tout rêvé… –
XIII.
Comme quoi Michel fut aimé d’une grisette et amoureux d’un portrait en miniature.
Je ne manquai pas de me trouver à l’ouverture du chantier de maître Finewood ; et comme j’étais accoutumé à me présenter partout sous les auspices de la Fée aux Miettes, je crus que son nom me serait de meilleure recommandation que jamais, dans un pays où elle devait être connue au moins par tradition.
— Qu’est-ce donc que la Fée aux Miettes ? s’écria maître Finewood les mains sur les côtés, et où diable avez-vous été élevé, si vous êtes Écossais, comme je le pense, car vous parlez la langue du pays mieux qu’un Hume ou un Smolett ? Nous ne connaissons de fée à Greenock, au moins entre nous autres charpentiers, mon enfant, que l’industrie et la patience, avec lesquelles on vient à bout de tout, moyennant la grâce de Dieu, notre souverain maître. Cependant, continua-t-il en parlant à sa femme et à ses filles, la figure de ce garçon me revient ; je ne sais où je l’ai rêvé, et pourquoi il m’est avis qu’il portera bonheur à ma maison. Il faudra le voir tantôt à la besogne, car c’est la véritable épreuve de l’ouvrier, et s’il est capable et laborieux, comme le témoignent ses certificats, qui sont réellement des meilleurs que j’aie vus, nous ne serons pas arrêtés par quelques fantaisies joviales et folâtres qui sont de l’âge et de l’état. Allez donc vous essayer, monsieur le protégé des fées ! je vous trouverai au travail. –
Là-dessus il me serra cordialement la main, et mistress Finewood me sourit avec une expression de touchante bienveillance qui se reproduisit de la manière la plus gracieuse sur le joli visage des six charmantes filles dont elle était entourée.
Encouragé par cet accueil, je me mis donc de bon cœur à montrer mon savoir-faire aux maîtres ouvriers, qui jugèrent du premier abord que j’étais propre aux opérations les plus difficiles et les plus compliquées de la profession. – Il est probable, pensai-je intérieurement alors, en tirant mes lignes et prenant mes mesures, que la Fée aux Miettes s’est effacée de la mémoire des habitants de Greenock, pendant le cours de sa longue absence, et qu’elle n’y a pas encore été remarquée depuis son retour, quoiqu’elle ait dû y arriver de bonne heure au train qu’elle allait. –
J’avais été si âpre à mon ouvrage que je ne m’aperçus qu’en finissant que maître Finewood était là depuis longtemps à m’observer.
— Courage, mon brave, dit-il en me frappant sur l’épaule, avec un air tout riant ; vous avez fait montre aujourd’hui de tant de goût et d’habileté qu’on imaginerait volontiers que vous avez quelque fée dans votre manche, s’il était vrai que les fées se mêlassent encore de nos affaires. – Puis, se retournant du côté des ouvriers : — Holà ho, vous autres, éclaircissez-moi d’un doute ? Auriez-vous entendu parler à Greenock de la noble patronne de ce gentil compagnon, parmi les bonnes et notables dames du pays ? C’est, s’il faut l’en croire, une naine de deux pieds et demi, de quelques centaines d’années, et nommée la Fée aux Miettes, qui parle toutes les langues, qui professe toutes les sciences, et qui danse dans la dernière perfection. –
Pendant qu’il disait ceci, le mouvement de toutes les scies était suspendu, toutes les haches étaient restées immobiles, et toutes les cognées muettes. Après un moment de silence, mes nombreux camarades répondirent par un éclat de rire tellement unanime qu’il était impossible d’y distinguer la moindre modulation ou la moindre dissonance. C’était le tutti le plus plein, le plus compact et le plus simultané qu’il soit possible d’ouïr ; et à dire vrai, j’en fus presque aussi assourdi que mortifié.
À compter de ce moment, je pris le ferme dessein de ne plus parler de la Fée aux Miettes, d’autant qu’il me semblait réellement assez difficile d’en donner une idée avantageuse aux gens qui ne la connaissaient pas ; mais j’avoue que cette expansion de gaieté m’inspira peu de penchant pour les ouvriers qui se l’étaient permise aux dépens de la seule amie que je me fusse connue au monde, et qu’elle jeta depuis dans mes rapports avec eux une sorte de froideur et de malaise qui ne fut pas favorable à la réputation de mon jugement et de mon esprit. Je les surprenais souvent à se frapper le front du doigt en me regardant, avec des signes d’une pitié dédaigneuse, comme pour se faire entendre les uns aux autres que maître Finewood ne s’était pas trompé, le jour de mon arrivée, en me croyant travaillé de quelque sotte manie.
Quoi qu’il en soit, je m’étais tellement distingué par mon assiduité et mon aptitude au travail, dès les premières semaines, que maître Finewood m’avait plus en gré qu’aucun de ses autres ouvriers, et qu’il me tenait presque au même rang, dans son affection, que ses six garçons et ses six filles. Mon inclination à la solitude et à la méditation, lorsque je ne travaillais pas, ne lui paraissait plus qu’une disposition naturelle de mon caractère, et il ne s’en inquiétait point.
— Que voulez-vous ? disait-il, c’est son plaisir, à lui, d’être seul, et de rêver au bord de la mer, plutôt que de passer les jours de fête à faire sauter des bouchons d’ale, ou que de faire danser, dans le bal des charpentiers, Folly Girlfree et d’autres évaporées de la même espèce. Il n’y a peut-être pas grand mal à cela, car je suis bien trompé si un honnête homme n’apprend, dans la société des buveurs et dans celle des grey gowns, plus de mauvaises choses que de bonnes !… –
Je ne pensais guère à ces plaisirs ! Il n’y en avait plus qu’un pour mon cœur, celui de contempler ma chère Belkiss et de converser avec elle, car je vous ai dit qu’il s’était formé entre son portrait et moi une espèce d’intelligence merveilleuse qui suppléait à la parole, avec plus de mouvement, de rapidité, d’entraînement peut-être, comme si la plus légère des impressions de ma pensée allait se refléter, par je ne sais quelle puissance, dans ces linéaments immobiles, dans ces couleurs fixées par le pinceau, et mettre en jeu sur l’émail une âme qui m’entendait. À peine étions-nous seuls, Belkiss et moi, que cette conversation imaginaire s’établissait entre nous, et durait pendant des heures délicieuses, variées par toutes ces alternatives de la crainte et de l’espérance qui font la douleur et la joie des amants. Si je paraissais épouvanté de la distance qui nous séparait, et de l’impossibilité de la franchir jamais, on aurait dit que Belkiss voulût me rassurer par un sourire. Si je désespérais de réaliser le bonheur que j’aspirais dans ses regards, on aurait dit qu’elle compatissait à mes souffrances par une larme ; et jamais je ne me séparais d’elle quand j’y étais forcé, que l’expression de sa physionomie tout entière ne me laissât un sentiment de consolation inexprimable, plus vif que toutes les extases de la vie. – Un jour, un seul jour, le désordre de ma passion m’avait emporté si loin, et Belkiss semblait y céder elle-même par une si invincible sympathie, que mes lèvres se rapprochèrent en frémissant du médaillon, tandis qu’un prestige dont le délire de l’amour peut seul expliquer le mystère prêtait à l’image animée le mouvement et les proportions de la nature, et me la montrait émue, agitée, palpitante, prête à s’élancer pour joindre ses lèvres aux miennes, hors de son cercle d’or et de son auréole de diamants. Je sentis que la chaleur de son baiser versait des torrents de flammes dans mes veines, et que ma vie défaillait à ma félicité. Ma poitrine se gonfla comme si elle était près d’éclater, ma vue se voila d’un nuage de sang et de feu, mon âme se réfugia sur ma bouche, et je perdis connaissance en prononçant, en balbutiant le nom de Belkiss.
Le hasard, ou une rencontre plus naturelle, faisait que Folly Girlfree se trouvait là, au moment où ce nom adoré expirait avec ma voix, avec ma dernière pensée, avec le désir et le besoin de mourir dans cette volupté suprême. Folly, qui valait qu’on l’aimât, parce qu’elle était effectivement la plus gentille des petites robes grises de Greenock, Folly, la bizarre Folly s’était piquée de se faire aimer de moi, sans doute parce que l’austérité de mes mœurs solitaires avait agacé sa vanité de jeune fille ; et il était rare que je me recueillisse dans un endroit si écarté que Folly n’y vînt apparaître comme par hasard et sans être attendue, au creux de quelques rochers fendus par le temps, ou au débouché d’un massif de bouleaux, avec sa jolie toilette calédonienne, sa tournure de sylphide, sa gentillesse fantastique, et sa gaieté éveillée.
— Par l’honnête mère qui m’a engendrée, disait-elle alors en levant les mains vers le ciel, c’est donc vous, Michel, que je verrai partout ! Il faut que vous soyez bien subtil à vous retrouver au-devant de mes pas, car je vous évite, pour moi, avec autant de soin qu’une pauvre colombe le milan qu’elle a vu tourner sur son nid ! C’est une grande misère à une jeune femme de bien qui n’a que son innocence, ajoutait-elle en portant ses dix jolis doigts à ses yeux comme si elle avait pleuré, de ne pouvoir jamais se dérober à la malice et aux embûches des séducteurs.
— Hélas, ma chère Folly, lui répondais-je d’ordinaire, je conviens que cette circonstance se renouvelle assez souvent pour vous causer quelque surprise, mais je puis attester sur vos beaux yeux noirs que ma volonté n’y est pour rien, et que je comprends au contraire assez le danger de vous voir pour me tenir loin de votre chemin, si je savais où vous devez passer, car mon cœur est engagé dans un lien qui m’est plus précieux que la vie, et qui lui défend d’être jamais à vous.
Le jour dont je parle, mon émotion m’entraîna plus loin que ne le permettaient la discrétion et la prudence, et j’ajoutai, dans le transport auquel j’obéissais encore : — Non, Folly ! jamais à vous, jamais à une autre qu’à la divine princesse Belkiss.
Comme j’avais évité de tourner ma vue sur Folly, après lui avoir fait connaître d’une manière si positive l’obstacle invincible qui s’opposait au succès de ses vœux, et que son profond silence me faisait craindre qu’elle ne cédât tout à fait à son désespoir, je courus à elle pour lui donner quelque consolation, et je la trouvai en effet dans un état qui m’alarma au premier coup d’œil, mais sur lequel je fus bientôt tranquillisé à ma grande humiliation, quand je m’aperçus qu’elle se pâmait de rire. Cependant, cette convulsion de joie délirante et d’éclats étouffés menaçant réellement de la suffoquer, je m’empressais à lui porter du secours, lorsqu’étendant sa main vers moi, et reprenant un peu haleine :
— Assez, assez, me dit-elle ; je me remettrai toute seule ; mais pour Dieu ! Michel ! ne me dites plus rien, si vous ne voulez que je meure !
Alors, je m’éloignai en me demandant à moi-même, si je n’avais pas donné quelque juste prétexte à sa folie, et si la passion qui me dominait n’était pas mille fois plus insensée encore. Je ne me rassurai entièrement qu’en revenant au portrait de Belkiss, dont la douce et riante sérénité, plus pure que de coutume, éclaircissait tous mes soucis et calmait toutes mes douleurs.
Cette anecdote circula bientôt parmi les filles de Greenock, avec toutes les circonstances comiques que pouvait y ajouter la maligne jalousie de Folly, et passa rapidement des petites robes grises aux ouvriers de bon air qui étaient peu disposés à me vouloir du bien, parce qu’ils prenaient mal à propos ma timidité sauvage pour de l’insouciance ou du dédain. Quelques jours après, je ne passais plus dans les groupes joyeux des fêtes et des dimanches, quand le caprice de mes promenades errantes me faisait tomber au milieu d’eux, sans entendre murmurer à mes oreilles :
— Oh ! ne troublez pas les méditations de Michel, du plus sage et du plus savant des charpentiers de Renfrew ! Si vous le voyez ainsi refrogné et absorbé dans ses pensées, c’est qu’il rêve incessamment à la princesse Belkiss dont il est le galant, et qu’il emporte suspendue à cette belle chaîne dans une boîte de laiton !
— La princesse Belkiss, disait une matoise plus impertinente que les autres, qui sortait de la bande, en frottant lestement l’index de sa main droite sur celui de sa main gauche en signe de mépris ; la princesse Belkiss, vraiment, n’est pas faite pour les charpentiers ! Il l’épousera, si Dieu permet, quand il aura trouvé le trèfle à quatre feuilles ou la mandragore qui chante !
Les hommes ne disaient rien, car ils savaient que je n’aurais pas subi une insulte ; mais ils riaient à leurs maîtresses, et je me hâtais de passer assez confus, parce que ces plaisanteries n’étaient pas au fond dépourvues de bon sens.
La nouvelle de ma passion arriva dans le chantier, mais j’y étais aimé, et l’on ne se serait pas avisé d’ailleurs d’y badiner à mes dépens. Un soir que maître Finewood avait à se louer de quelque pièce de travail que j’avais exécutée pour lui :
— Ô mon pauvre Michel, dit-il, en me prenant la tête aux deux mains, tu es un si honnête jeune homme et un si digne ouvrier, que je regretterai jusqu’à mon dernier jour de n’avoir pu faire assez en ta faveur, et que je me le reprocherais à l’égal des plus noires ingratitudes, si ton esprit singulier ne s’était opposé à mes bonnes intentions. Je t’aurais voulu pour gendre, et pour le principal héritier de mon riche établissement ; et tu sais que j’ai six filles, dont trois sont plus blanches que les lis, et trois plus vermeilles que les roses. Il n’y a pas un laird d’Écosse qui n’eût été enchanté de mener la moindre des six à l’autel, et je t’aurais donné le choix. Pourquoi faut-il que tu sois amoureux comme un fou, pardonne-moi le mot, d’une princesse Belkiss qui était, sans doute, une fort honorable personne, puisqu’elle refusa la main du grand roi Salomon, s’il ne commençait par répudier ses sept cents femmes et ses trois cents concubines, ainsi que le rapporte le Talmud, au témoignage de mon voisin Jonathas le changeur ; mais qui, si elle vivait encore et s’il lui restait des dents, en porterait de telles, j’imagine, qu’elles dépasseraient d’un pouce au moins la longueur de son menton !…
— Croyez-vous, lui répondis-je, que c’est ainsi que serait aujourd’hui Belkiss ?
— Et qui en doute ? répliqua gaiement maître Finewood.
— Adorable Belkiss, m’écriai-je, en pressant le médaillon sur mes lèvres sans l’ouvrir, vous m’êtes témoin que rien ne peut effacer de mon cœur les engagements que j’ai pris envers vous, et que j’ai préféré le bonheur de vous appartenir sans espérance aux avantages les plus doux et les plus séduisants qui puissent flatter un homme de ma condition !
Maître Finewood était si consterné, qu’il ne s’aperçut pas de mon départ, et je me retirai dans la pensée qu’il était temps de quitter Greenock, où mes extravagantes amours deviendraient de plus en plus un objet de douleur pour mes amis, et de dérision pour tout le monde.
XIV.
Comment Michel traduisait l’hébreu à la première vue, et comment on fait des louis d’or avec des deniers, pourvu qu’il y en ait assez ; plus, la description d’un vaisseau de nouvelle invention, et des recherches curieuses sur la civilisation des chiens danois.
Comme je rentrais chez moi, je vis la foule assemblée devant une grande affiche qui portait en guise de vignette l’image d’un vaisseau fort bizarre pour le gréement et la voilure, et qui était imprimée en lettres si extraordinaires que les plus savants n’avaient jamais rien vu de pareil. — Parbleu, maître Michel, vous qui n’ignorez de rien, me dit un des ouvriers que Folly Girlfree avait égayés à mes dépens les jours précédents, voici une belle occasion de nous montrer votre science ; et c’est à faire à vous de nous expliquer cet effroyable grimoire auquel tous les docteurs du pays perdent leur latin ! – En parlant ainsi, on me poussait au pied du placard avec de mordantes railleries qui me faisaient réfléchir péniblement sur mon ignorance, mais je me rassurai promptement en m’apercevant que ce n’était que de l’hébreu, dont la Fée aux Miettes m’avait fait prendre quelque connaissance, du temps où elle dirigeait mes études.
« Par la grâce de Dieu tout-puissant qui s’assied au-dessus du soleil et de la lune, » dis-je alors, car je lisais plus couramment cette langue que je ne m’en serais cru capable : –
» À la garde de ses brillantes étoiles, et sous la protection des saints anges qui couvrent de leurs ailes le commerce de la mer, les mariniers, les charpentiers et les marchands de Greenock sont avertis du départ du grand vaisseau la Reine de Saba, qui fera voile après-demain, jour de Saint-Michel, prince de la lumière créée et bien aimé du seigneur souverain de toutes choses, hors de ce port d’élite et de salut, qui brille au front des îles de l’océan comme une perle très choisie. »
— Le grand vaisseau la Reine de Saba vient en effet d’entrer dans le port, reprit l’ouvrier d’un air plus réfléchi.
— Mes amis, continuai-je en leur adressant la parole, il ne faut pas vous étonner que le capitaine de ce bâtiment s’adresse à vous dans sa langue, probablement parce qu’il ne sait pas la nôtre, comme cela pourrait nous arriver à tous si nous venions à mouiller dans un port inconnu ; ou bien, parce qu’en abordant sur des plages chrétiennes, il n’a pas supposé qu’elle fût ignorée des docteurs de notre sainte loi, que vous n’avez pas encore pris le temps de consulter. La langue dans laquelle cette affiche est écrite est celle de la divine écriture.
— Est-il vrai ? dirent les ouvriers, en se regardant les uns les autres, et en se croisant les bras.
Je poursuivis ma lecture :
« La Reine de Saba est frétée pour l’île d’Arrachieh dans le grand désert libyque, où elle parviendra, si Dieu ne l’a autrement résolu dans les desseins impénétrables de sa sagesse, devant laquelle l’univers entier est un faible atome, par les canaux souterrains qu’a ouverts à un petit nombre de navigateurs choisis la puissante main de la très sage Belkiss, souveraine de tous les royaumes inconnus de l’Orient et du Midi, héritière de l’anneau, du sceptre et de la couronne de Salomon, et l’unique diamant du monde. Que sa gloire soit éternelle, comme sa jeunesse et sa beauté !
— Belkiss ! dit une voix étouffée qui paraissait venir de loin.
— Belkiss ! répétai-je en moi-même avec surprise ; car il y avait dans le rapprochement de ce nom et de celui qui occupait ordinairement mes pensées je ne sais quel mystère sous lequel ma raison fut un instant anéantie.
— Belkiss ! s’écria enfin Folly Girlfree, qui avait réussi à se faire jour à travers les spectateurs, vous voyez bien que le malheureux retombe dans sa folie !
Au même instant se leva à mes pieds un vieux petit juif, que je n’avais pas encore aperçu jusque-là, tant il était modestement accroupi dans ses haillons ; et, collant contre le tableau sa figure amincie et macérée par l’âge, et sa longue barbe d’un blanc d’argent, aiguisée en alène, comme si elle avait été affilée à la lime et au polissoir :
— Il y a Belkiss, répondit-il en allongeant sur le mot un doigt décharné, plus pâle que celui des squelettes blanchis qui sautillent, au branlement des armoires, sur leurs faux muscles de laiton, dans les cabinets d’anatomie : –
Il y a Belkiss vraiment, et ce jeune homme traduit l’hébreu aussi nettement qu’un massorète !…
Je me retirai alors avec respect pour qu’il achevât.
« Le trajet, dit-il, ne durera que trois jours, et les passagers ne payeront que vingt guinées. Fête perpétuelle au Seigneur dans les hauteurs de sa puissance ! »
— Un trajet de trois jours d’ici au grand désert libyque, murmurait le peuple en se retirant ! – un voyage de mer dans des canaux souterrains ! Voyez-vous ce charlatan de corsaire qui cherche à nous soutirer vingt guinées, et à nous enlever nos ouvriers et nos enfants !
— Qu’il a peut-être déjà vendus d’avance aux chiens de l’île de Man, grommelait une vieille femme toute cassée. Maudit qui te donnerait vingt schellings, damné de juif !…
— Pour naviguer sur un vaisseau de la princesse Belkiss ! ajoutait Folly indignée…
— Belkiss, Belkiss ?… répétais-je intérieurement en m’écartant, seul et pensif, de la cohue qui commençait à se dissiper. – Cette ressemblance de nom n’a rien d’extraordinaire. C’est ainsi qu’on appelait, dit-on, la reine de Saba ; et les orientaux, plus fidèles que nous aux traditions antiques, sont coutumiers de perpétuer la mémoire des souverains sous lesquels ils ont joui de quelque bonheur ou de quelque gloire. – Mais si cette princesse Belkiss était celle qui a recueilli dans l’île fantastique dont me parlait Mathieu, l’oncle et le père que je pleure, ne serait-ce pas un devoir sacré pour moi de courir à leur recherche, tant que l’expérience d’une nouvelle misère ne m’aurait pas détrompé ? – Oh ! si j’avais seulement le temps de vendre mes livres, mes collections, mes instruments de mathématiques ! Mais quand tout cela vaudrait vingt guinées, il me faudrait six mois pour en retirer la moitié !… – Et c’est après-demain !
Je mis la main dans ma poche, mais je n’avais qu’une guinée en monnaie.
J’allai dormir, si je ne dormais, car pour dire la vérité, monsieur, mes impressions de la veille et du sommeil se sont quelquefois confondues, et je ne me suis jamais fort inquiété de les démêler, parce que je ne saurais décider au juste quelles sont les plus raisonnables et les meilleures. J’imagine seulement qu’à la fin, cela revient à peu près au même.
Le lendemain, j’arrivai triste au chantier, soit que l’idée de ce voyage me préoccupât, soit peut-être parce que je n’avais jamais travaillé la veille de la fête de mon patron, jour auquel commençait mon pèlerinage, et qui ne revient guère comme aujourd’hui, sans me rappeler ma pointe à coques, ma large résille, les grèves inconstantes du mont Saint-Michel dans le péril de la mer, et surtout les bons enseignements et les conversations instructives de la Fée aux Miettes.
Ma mélancolie fut remarquée d’abord par maître Finewood, dont j’étais aimé comme d’un autre oncle ou d’un autre père. — Écoute, Michel, me dit-il, je ne suppose pas que tu veuilles t’embarquer sur le vaisseau la Reine de Saba, qui doit te rappeler assez désagréablement ton bâtiment de Granville, et un horrible naufrage auquel tu as seul échappé, puisqu’on n’a jamais pu retrouver la Fée aux Miettes, probablement rendue depuis longtemps à son peuple de sorciers et de lutins. Ce voyage ne me promettrait rien de bon pour toi, la princesse Belkiss dont tu t’es amouraché, je ne sais comment, ne me paraissant guère plus capable que la Fée aux Miettes de te prêter une protection assurée contre une nouvelle tempête ; mais il en sera d’ailleurs ce que tu voudras, et l’intérêt que j’ai à te conserver dans mon chantier ne me fera pas mettre d’obstacle aux félicités que tu te promets. Ce que je voulais te dire aujourd’hui, c’est qu’à ton refus, mon enfant, je marie demain mes six filles, et que ta vue me ferait du mal ce soir au festin de leurs noces, parce que je me rappellerais en dépit de moi que j’espérais t’y voir à un autre titre, car tu es aussi près qu’elles-mêmes du cœur de maître Finewood. Promets-moi donc, Michel, d’aller passer la soirée chez mistress Speaker, à l’enseigne de Calédonie, et d’y souper en mon honneur d’une bonne gélinotte à l’estragon, et d’une fine bouteille de vin de Porto. Je sais bien que tu ne dois pas avoir beaucoup d’argent, car tu dépenses tes bénéfices en aumônes et en livres, et tu ne demandes jamais. Viens donc, que nous comptions ensemble… –
— Vous me devez, maître, lui dis-je en étendant la main, plein tout cela de plaks ou de bawbies, c’est-à-dire une vingtaine de ces pièces que nous appelons en France des deniers, et que nous laissons tomber en écartant nos doigts à plaisir, pour qu’il reste quelque chose à ramasser aux pauvres. – Et si c’était aussi bien des guinées, l’amitié fidèle et dévouée que je ressens pour vous ne m’empêcherait pas de courir sur le vaisseau de Belkiss à la recherche de mon père !…
Pendant ce temps-là, maître Finewood alignait des chiffres sur sa longue planche d’ardoise, et ce n’était jamais que des plaks et des bawbies.
— Ceci est merveilleux ! dit-il ; de quelque côté que je retourne cette malheureuse addition, j’y trouve toujours vingt guinées ! Ce n’est pas que le prix me déplaise, car je t’en dois trois fois plus pour tes bons services, mais on n’a jamais fait vingt guinées avec une colonne de plaks et de bawbies, à moins qu’elle ne fût aussi élevée que celle de maître Christophe Wren !
— Cela n’est pas possible en effet ! m’écriai-je en saisissant la craie pour vérifier son calcul ; mais il était parfaitement exact, sauf une petite erreur que je ne voulus pas rectifier, parce qu’elle était, je crois, d’un demi-plak à l’avantage de mon maître.
— Voilà tes vingt guinées, me dit maître Finewood en m’embrassant ; et je devine trop l’usage que tu en vas faire. Puisse au moins la bonté de Dieu ne t’abandonner jamais dans tes entreprises !
Ensuite il s’éloigna en essuyant quelques larmes auxquelles les miennes répondaient.
Une demi-heure après, j’étais au port, et j’avais payé mon passage sur le grand vaisseau la Reine de Saba, qui était, suivant la promesse de l’affiche, ce qu’on a vu de plus extraordinaire en construction pour l’usage de la mer. Vingt-quatre cheminées comme celles des steam-boats, mais d’une proportion incomparablement plus grande, garnissaient chacun des deux flancs de son immense carène, et semblaient destinées à faire mouvoir autant de paires de roues qu’un mécanisme simple et ingénieux rendait propres à mordre en tous sens sur les flots. Ses vingt-quatre mâts d’un bois léger, mais incorruptible, et qu’on disait impossible à rompre, soutenaient des voiles découpées en ailes d’oiseau, et verguées d’un métal souple et obéissant, qui se déployaient, prenaient le vent, planaient comme un vautour, filaient comme une hirondelle, et se refermaient à volonté sous la main d’un enfant, au gré d’un simple cordage de fil d’or ; et ses hunes balançaient autour d’elles des centaines d’aérostats captifs, aussi propres à le soutenir au besoin dans les airs qu’à l’entraîner sur les eaux. Derrière la poupe, sur de hauts pliants inclinés en spirale, qui fuyaient en s’élevant, reposait un vaste appareil suspendu comme le siège postérieur d’un landaw, devant lequel le vaisseau était tout entier retranché, et qui ouvrait sur tous les points de la voilure des bouches démesurées. On m’apprit que c’était de là qu’une troupe d’habiles physiciens distribuait tous les rhumbs, et poussaient le bâtiment comme un projectile dans les routes de l’Océan. Je m’étonnai que la navigation eût fait tant de progrès dont on n’avait jamais entendu parler ; mais certainement, le fameux James Watt, le Stevinus de Greenock, n’aurait rien conçu de pareil en mille ans.
La physionomie du capitaine me frappa au premier regard, parce qu’elle me rappelait quelque chose de ce marin peu soucieux qui avait vu périr son équipage et sa cargaison, l’année précédente, à l’embouchure de la Clyde, sans prendre le temps de secouer les cendres de sa pipe, et de porter un coup d’œil au gouvernail ; mais celui-ci mouillait pour la première fois dans les eaux de l’Occident.
Je vous ai dit qu’il me restait une guinée, et que je m’étais engagé envers maître Finewood à souper à l’auberge de Calédonie. Quoique la Reine de Saba ne fît voile qu’à midi du lendemain, j’étais peu tenté cependant d’une de ces soirées de bien-être et de ces nuits de long sommeil dont la vie de l’ouvrier m’avait fait perdre depuis plusieurs années l’habitude, et je ne pensais guère à demander à mistress Speaker que deux harengs du lac Long, arrosés d’une bouteille d’ale ou de small-beer, quand elle vint à moi les bras ouverts, en me criant de l’office : — Eh ! arrivez donc, sage Michel, avant que votre gélinotte ne brûle, et que votre Porto ne s’échauffe ! Le digne maître Finewood a commandé tout cela dès le matin, et un bon lit d’édredon avec ! Il y a une heure que nos filles s’égosillent à crier : — Que fait donc monsieur Michel, qu’il laisse brunir au feu le plus joli ptarmigande montagne qu’on ait jamais plumé au Bas-Pays ? Il faut qu’il s’égare au long de la côte à déchiffrer quelque livre irlandais, ou qu’il rêve à la princesse Belkiss dont il est, dit-on, le fiancé. – Ah ! j’ai toujours prédit, Michel, que vous feriez un beau chemin ! Et maître Finewood est bien fou, le cher homme, de vous préférer ces six petits lairds qu’il marie à ses six filles, dont vous êtes bien mieux l’affaire, surtout Annah, la blondine, qui ne vous nomme jamais qu’avec de grosses larmes ! Hélas, Michel ! je puis en parler !… Annah est ma filleule : j’avais pour elle des entrailles de mère ; et je disais souvent à maître Finewood : Que ne la donnez-vous à Michel, qui en est aimé ? Là-dessus, savez-vous ce qu’il faisait ? Il hochait la tête, et regardait de côté. Il est vrai, lui disais-je, que Michel est bizarre, mais c’est d’ailleurs un garçon si discret, si honnête et si laborieux !…
— C’est trop, c’est trop ! lui dis-je, en lui pressant la main, ne laissez pas brûler le plus joli ptarmigan de montagne qu’on ait jamais plumé au Bas-Pays !…
Et j’allai m’asseoir à la salle à manger pour prendre le temps de regarder le portrait de Belkiss. Elle riait. Cette illusion que je me faisais sur l’expression de ses traits ne manquait jamais de régler, comme je vous l’ai déjà dit, tous les mouvements de mon cœur – Il est probable, pensai-je, que la joie de Belkiss a quelque motif secret qui me touche ; peut-être a-t-elle deviné que ce voyage aventureux va me réunir à mes bons parents. Qui sait si je ne suis pas réservé au bonheur de la voir elle-même, car il est impossible qu’un type si achevé de toutes les perfections soit le simple résultat du caprice de l’art ? Il faudrait pour cela que Dieu se fût dessaisi en faveur de l’homme du plus beau privilège de la création ! – Mais si ces traits avaient appartenu en effet à quelque princesse des temps anciens, comme le pense maître Finewood, – à cette Belkiss, qui fut autrefois reine de Saba, par exemple, – ou à la Fée aux Miettes, – eh bien, le bonheur que je dois à ce prestige n’est-il pas assez vif et assez pur pour me dédommager de quelques plaisirs empoisonnés par la jalousie, affaiblis par la possession, incessamment menacés dans leur objet par les progrès inévitables du temps ? Que m’importent à moi ces grâces fugitives de la vie que l’âge décolore et détruit, et qui effeuillent leurs roses passagères au courant de toutes les brises, et au midi de tous les soleils ?… À moi dont le cœur, dévoré du besoin d’une félicité éternelle, se briserait de désespoir à la moindre altération du modèle idéal de beauté, de constance et d’amour, qu’il s’est formé dans des songes mille fois plus doux que la vérité ! Ce portrait seul pouvait le remplir, et le remplir à jamais. Passent maintenant, sans que je m’en soucie, toutes les belles que la terre admire pendant quelques printemps, puisque mon heureuse destinée m’a donné une amante qui ne changera point !
En disant cela, j’appuyai mon front sur ma main, obsédé d’idées vagues et confuses qui me saisissent ordinairement à la suite de toutes les impressions puissantes, et je suppose qu’il en est ainsi chez les autres hommes que domine une pensée profonde et passionnée.
Quelque mouvement qui se faisait auprès de moi m’ayant forcé à ouvrir les yeux, je m’aperçus que j’étais servi :
— Félicitez-vous, Michel, me dit mistress Speaker en plaçant devant moi une paire de gélinottes à l’estragon, et deux bouteilles de Porto. C’est monsieur le bailli de l’île de Man, qui est venu à Greenock pour réaliser en bank’s notes les contributions de sa province, et qui vous fait l’honneur de souper avec vous pour vous entretenir, parce qu’il a entendu parler de votre science et de votre bonne conduite.
Je me hâtai de me lever, et de saluer le bailli de l’île de Man, qui avait bien une des prestances les plus honorables que vous puissiez imaginer, et qui joignait aux apparences imposantes que donnent les hautes fonctions, les manières recherchées des meilleures compagnies. Ce qui m’étonna plus que je ne saurais le dire, c’est que ses épaules étaient surmontées d’une magnifique tête de chien danois, et que j’étais le seul, parmi les nombreux pensionnaires de mistress Speaker, qui parût en faire la remarque. Cette circonstance m’embarrassa, parce que je ne savais trop quelle langue lui parler, et que j’entendais d’abord assez difficilement la sienne, qui consistait dans un petit aboiement fort gravement modulé, et accompagné de gestes fort expressifs. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il me comprit à merveille, et qu’au bout d’un quart d’heure de conversation, je fus aussi surpris de la netteté de son langage et de la délicatesse exquise de ses jugements, que je l’avais été au premier coup d’œil de la nouveauté de sa physionomie. On est vraiment confus de penser au temps que les hommes perdent à feuilleter les dictionnaires, quand on a eu le bonheur de causer quelque temps avec un chien danois bien élevé, comme le bailli de l’île de Man.
Nous nous séparâmes avec une effusion réciproque d’amitié qui ne me surprenait plus. Il y a au monde de si étranges sympathies ! Mais comme ce vin de Porto dont je n’avais jamais fait usage me disposait au sommeil, je me hâtai de gagner le bon lit d’édredon que maître Finewood m’avait fait préparer. J’y fis mes adieux du soir au portrait toujours riant de Belkiss, et je commençais à sommeiller quand j’entendis la voix de mistress Speaker s’introduire dans mon oreille comme un souffle.
— Pardon si je vous réveille, mon enfant, me dit-elle, mais c’est un si terrible embarras dans ma maison, avec tous ces voyageurs qui s’embarquent demain sur le grand vaisseau la reine de Saba, que je ne sais où mettre tout le monde, et vous m’obligeriez beaucoup de partager votre lit avec ce respectable seigneur qui vous a tenu compagnie à souper.
— J’y consens volontiers, lui répondis-je, et c’est un inconvénient de si peu de conséquence pour un ouvrier que de coucher à deux dans un lit si large et si commode, qu’il ne valait pas la peine de m’en parler.
Cependant je me détournai un peu pour m’assurer que je ne me trompais pas sur la personne ; et je vis en effet le bailli de l’île de Man, qui, après avoir revêtu à petit bruit un déshabillé fort rassurant pour la propreté la plus ombrageuse, et glissé sous l’oreiller un gros portefeuille de maroquin à fermoir, s’insinuait entre nos draps avec une modeste et silencieuse discrétion, en conservant de lui à moi une distance décente, sur laquelle j’avais pris soin d’avance de lui donner toutes ses aises. Je m’apercevais seulement de sa présence à la tiédeur de sa respiration, qui m’échauffait de loin sans m’importuner, car il est évident qu’un chien danois ne peut dormir commodément que de profil. Au bout de quelques minutes, il ronfla d’une manière si harmonieuse et si cadencée que je n’y pris plus garde. – Et je m’endormis aussi.
XV.
Dans lequel Michel soutient un combat à outrance avec des animaux qui ne sont pas connus à l’Académie des Sciences.
Je rêvais peu dans ce temps-là, ou plutôt je croyais sentir que la faculté de rêver s’était transformée en moi. Il me semblait qu’elle avait passé des impressions du sommeil dans celle de la vie réelle, et que c’est là qu’elle se réfugiait avec ses illusions. Je ne rentrais, à dire vrai, dans un monde bizarre et imaginaire que lorsque je finissais de dormir, et ce regard d’étonnement et de dérision que nous jetons ordinairement au réveil sur les songes de la nuit accomplie, je ne le suspendais pas sans honte sur les songes de la journée commencée, avant de m’y abandonner tout-à-fait comme à une des nécessités irrésistibles de ma destinée. La nuit dont je vous parle fut cependant troublée de songes étranges, ou de réalités plus étranges encore, dont le souvenir ne se retrace jamais à ma pensée, que tous mes membres ne soient parcourus en même temps d’un frisson d’épouvante.
Cela commença par le bruit aigre d’une croisée qui roulait lentement sur ses gonds, et à travers laquelle je sentis poindre l’air pénétrant des brumes humides de septembre. — Ho ! ho ! dis-je à part moi ! le vent a aussi beau jeu, si je ne me trompe, à l’hôtel de Calédonie que dans la mansarde de l’ouvrier ! Et je ne m’en souciai point. – Un instant après, je crus entendre des mouvements confus, des murmures sinistres et articulés comme des chuchotements, une rumeur de paroles sourdes et de rires étouffés qui bourdonnaient dans mon oreille. — Voilà qui est bien, repris-je. L’ouragan va faire des siennes chez mistress Speaker ; mais grand sot qui s’en dérangerait sur un si bon édredon. – Et je me contentai de ramener la couverture sur mon compagnon et sur moi, et de me replonger dans le duvet, tant je craignais de perdre la douceur de ce repos voluptueux que je n’avais pas goûté depuis la maison de mon père, quand mon oncle André venait soigneusement, avant de se coucher, relever mes matelas entre les ais du châlit débordé, et me baiser sur le front.
— L’autre dort, dit une voix rauque, aussitôt couverte de quelques grognements inintelligibles.
Et pendant que je suspendais ma respiration pour écouter, le globe lumineux d’une lanterne dont je sentais presque la chaleur me perça de rayons ardents qui s’enfonçaient entre mes paupières comme des coins de feu ; car, dans l’agitation vague du sommeil à peine interrompu, je m’étais retourné machinalement vers l’intérieur de la chambre. – Je vis alors, chose horrible à penser, quatre têtes énormes qui s’élevaient au-dessus de la lanterne flamboyante, comme si elles étaient parties d’un même corps, et sur lesquelles sa clarté se reflétait avec autant d’éclat que si elle avait eu deux foyers opposés. C’étaient vraiment des figures extraordinaires et formidables ! – Une tête de chat sauvage qui grommelait avec un frôlement grave, lugubre et continu, à travers les rouges vapeurs du soupirail de la lampe, en arrêtant sur moi des regards plus éblouissants que le ventre bombé du cristal, mais qui, au lieu d’être circulaires, divergeaient minces, étroits, obliques et pointus, semblables à des boutonnières de flamme. – Une tête de dogue toute hérissée, toute écumante de sang, et qui avait des chairs informes, mais animées, palpitantes et gémissantes encore, pendues à ses crocs. – Une tête de cheval plus nettement dépouillée, plus effilée et plus blanche que celles qui se dessèchent dans les voiries, à demi calcinées par le soleil, et qui se balançait sur une espèce de col de chameau, en oscillant régulièrement comme le pendule d’une horloge, et en secouant çà et là de ses orbites creuses, à chaque vibration, quelques plumes que les corbeaux y avaient laissées. – Derrière ces trois têtes, – et ceci était hideux, – se dressait une tête d’homme ou de quelque autre monstre, qui passait les autres de beaucoup, et dont les traits, disposés à l’inverse des nôtres, semblaient avoir changé entre eux d’attributions et d’organes comme de place, de sorte que ses yeux grinçaient à droite et à gauche des dents aussi stridentes qu’un fer réfractaire sous la lime du serrurier, et que sa bouche démesurée, dont les lèvres se tordaient en affreuses convulsions, à la manière des prunelles d’un épileptique, me menaçaient d’œillades foudroyantes. Il me parut qu’elle était soutenue d’en bas par une large main qui s’était fortement nouée à ses cheveux, et qui la brandissait comme un hochet épouvantable pour amuser une multitude furieuse attachée par les pieds aux lambris des plafonds qu’elle faisait crier sous ses trépignements, et qui battait vers nous ses milliers de mains pendantes, en signe d’applaudissement et de joie.
À ce spectacle effrayant, je poussai brusquement le bailli de l’île de Man, mais il retomba sur moi comme un cadavre, parce qu’à force de me tapir au fond de mon lit pour ne pas l’incommoder, je m’y étais creusé un trou, et je ne vis plus ce qui se passait qu’au peu de jour que me laissait son museau allongé entre ses oreilles droites et menues. Cependant un levier musculeux, noir et velu, un bras peut-être qui fouillait sous notre oreiller, et qui effleura mon cou avec la froideur âpre et saisissante de la glace, m’avertit qu’on en voulait à mon portefeuille. Je m’élançai, je me saisis du poignard que j’avais acheté le matin pour ma traversée, je me ruai au milieu des fantômes, je frappai partout, sur le chat, sur le dogue, sur le cheval, sur le monstre, à travers des hiboux qui battaient mon front de leurs ailes, des serpents qui me ceignaient de leurs plis en se roulant autour de mes membres et qui me mordaient les épaules, des salamandres noires et jaunes, qui me mangeaient les orteils, et qui se disaient entre elles, pour s’encourager que je tomberais bientôt. – J’arrachai enfin le trésor de mon ami, à qui ? – Je ne le sais ! – car mon poignard s’enfonçait dans leurs corps comme dans une nuée, – et puis je les vis se rapprocher, sursauter, bondir par la croisée ouverte, se confondre en peloton, tourner les uns sur les autres pêle-mêle, se diviser au choc d’une pierre, se réunir de nouveau à la pente de la jetée, tourner encore en fuyant toujours, et s’abîmer dans la mer avec le bruit d’une avalanche.
Je revins triomphant, et toutefois haletant de fatigue et de terreur, – cherchant toutes les portes, mais elles étaient murées, ou présentaient à peine des passages si étroits qu’une couleuvre n’aurait osé s’y introduire, – ébranlant le cordon de toutes les sonnettes, mais toutes les sonnettes frappaient en vain leurs limbes de liège, d’un battail de queue d’écureuil ; – implorant à grands cris une parole, une seule parole ; mais ces cris, qui n’étaient entendus que de moi, ne pouvaient s’échapper de ma poitrine prête à éclater, et venaient expirer sur mes lèvres muettes comme l’écho d’un souffle.
Et on me trouva le lendemain, couché à plat auprès de mon lit, le portefeuille du bailli d’une main, et un couteau de l’autre.
Je dormais.
XVI.
Où l’on voit ce que c’est qu’une enquête judiciaire, et autres choses divertissantes.
Le crime est évident, dit un vieux robin qui paraissait pérorer depuis quelque temps, au chevet sur lequel le bailli de l’île de Man reposait encore immobile, et attendre la réponse d’un autre homme si grave et si empesé qu’on aurait imaginé au premier coup d’œil qu’il pensait à quelque chose. – Quoique le corps que voilà, et qui était de son vivant l’honorable sir Jap Muzzleburn, de très gracieuse mémoire, ne présente aucune trace de blessure comme vous l’avez admirablement démontré tout à l’heure, en termes aussi savants que choisis, il est trop certain qu’il est mort à n’en pas revenir, l’infortuné sir Jap, lui qui a toujours eu le sommeil si léger, surtout le matin, qu’au premier bruit de la poêle où l’huile bouillante frissonne autour des harengs, ou de deux verres qui tintent gaillardement comme des grelots aux doigts de l’hôtesse, il ne faisait qu’un saut du dormitoire à la salle à manger, sans prendre le temps de passer sa main blanche et agile derrière ses oreilles, et quelquefois, j’en suis témoin, sans avoir filé ses moustaches.
— Il m’est avis, continua-t-il avec autorité en me désignant du geste, que ce misérable l’a empoisonné hier au soir dans le vin de porto qu’ils burent ensemble, si mieux vous n’aimez croire qu’il l’a fasciné de quelque sortilège, ou endormi au moyen de quelqu’une de ces mixtions diaboliques de mandragore dont l’usage n’est que trop familier chez ces bandits d’outre-mer. Il ne se disposait probablement à l’égorger quand nous sommes arrivés de façon si opportune, que dans la crainte de laisser son crime imparfait. –
Le docteur ne répondit pas ; mais je crus remarquer qu’il accueillait l’abominable conjecture du juge d’instruction de ce hochement de tête affirmatif et de bourdonnement complaisant, qui dispensent les ignorants d’approfondir et les faibles de contester.
— Eh quoi ! m’écriai-je indigné !… L’assassin d’un inconnu que j’ai accueilli dans mon lit, malgré le peu de sympathie de nos espèces, et quoique son profil aigu occupât sur le traversin hospitalier dont je lui ai cédé la moitié, plus d’espace qu’il n’en faudrait pour se bercer commodément à trois têtes aussi rondes et aussi joufflues que celle de M. le docteur ! moi, l’assassin d’un digne chien d’ailleurs, dont je n’ai eu qu’à me louer pour sa politesse et ses manières, et que j’ai protégé durant des heures plus longues que des siècles, contre je ne sais quels ennemis qu’il a le malheur de traîner à sa suite, qui glapissent, qui hurlent, qui miaulent, qui vagissent, qui font peur à entendre et à voir, et auxquels j’ai arraché ce portefeuille, objet de leur envie, pour le rendre intact à son maître !… – Ah ! c’est une calomnie si révoltante, qu’elle ferait bouillonner la moelle dans les os d’un squelette !… –
Ce furent mes dernières paroles. Le juge et le médecin étaient partis pour déjeuner ; il ne resta autour de moi qu’une poignée de constables impassibles et sourds, qui me poussèrent brutalement dans un escalier long, étroit, tortueux, par où l’on descendait à la chambre de justice ; car elle était assemblée, par un hasard favorable qu’on me fit remarquer comme un témoignage particulier des bontés de la Providence.
— Il faut que ce misérable joue d’un grand bonheur, dit un de ces messieurs, dont le ton décidé annonçait quelque ascendant de grade ou de considération sur le reste de la bande. – Pris in flagrante delicto pendant les assises, et pendu entre deux soleils ! il y a des coquins prédestinés ! –
— Pendu entre deux soleils, murmurai-je sourdement, parce qu’il a plu à mistress Speaker de me faire manger de la gélinotte à l’estragon avec un chien danois ; parce que j’ai eu la complaisance de céder la moitié de mon matelas d’édredon à ce pauvre et malencontreux animal, et parce que j’ai passé une nuit épouvantable à le défendre contre une ménagerie de démons dont le seul aspect aurait fait mourir de terreur toute cette valetaille insolente !… Ô mon père ! ô mon oncle !… que direz-vous si jamais l’Adviser du Renfrew vous porte la nouvelle du crime dont on m’accuse, par le grand vaisseau de la Reine de Saba, ou par quelque autre voie inconnue, sans vous éclairer sur mon innocence ! Que direz-vous, Belkiss, si vous soupçonnez jamais ce cœur qui n’a battu que pour vous d’avoir conçu la pensée d’un attentat dont le seul récit épouvanterait les scélérats les plus endurcis ! –
Et tandis que je me confondais ainsi en inexprimables douleurs, je m’aperçus à je ne sais quelle pulsation impossible à décrire que le portrait de Belkiss ne m’avait pas quitté, car il palpitait contre mon cœur comme un autre cœur. – Mais je n’osais le regarder. La physionomie atroce de ces hommes de l’ordre public que la loi m’avait donnés pour gardiens me glaça d’effroi.
— En vérité, dis-je en frémissant, si les gens de justice voient cet or et ces bijoux, il les voleront !
XVII.
Qui est le procès-verbal naïf des séances d’une cour d’assises.
La rumeur excitée par mon entrée dans la salle d’audience ne s’apaisa que lentement.
Et puis elle se renouvela sourde et confuse, au dehors de la barrière que les curieux n’avaient pu franchir.
Honneur soit rendu à l’innocence du genre humain ! l’aspect d’un grand criminel a toujours quelque chose de nouveau pour lui. Cela est si rare !
Je me trouvai alors en face du tribunal, et je me hâtai à mon tour d’embrasser l’assemblée d’un regard large et effaré, pendant que ses regards fixes, aigus et pénétrants me criblaient comme des flèches, car c’était moi qui faisait ce jour-là les principaux honneurs du spectacle.
J’éprouvai peu à peu une impression singulière qui ne s’expliqua que successivement à mon esprit par l’habitude de celles qui tenaient mon attention et mes organes subjugués depuis la veille. Quoique toutes les figures qui m’entouraient fussent à peu près des figures humaines, il ne dépendait pas de moi de les entrevoir d’abord autrement qu’à travers de vagues ressemblances d’animaux, et la réflexion seule me les rendait l’une après l’autre sous leur type réel, c’est-à-dire aussi raisonnables que peut le comporter l’incroyable obligation d’envoyer mourir légalement, au milieu de la place publique, un être organisé comme nous, qui est notre égal, si plus ne passe, dans l’exercice de toutes nos facultés naturelles ; et cela pour l’instruction morale de ses compatriotes, de ses parents et de ses amis.
— N’est-il pas extraordinaire, dis-je intérieurement, si l’homme est, comme on l’assure, le plus parfait des ouvrages de Dieu, que ce grand artiste de la création qui avait à sa disposition tous les moules d’une invention inépuisable, ait été réduit par impuissance comme un ignoble fabricant de pastiches, ou se soit amusé par caprice, comme un peintre de caricatures, à composer son chef-d’œuvre des rognures de tous ses essais, et à reproduire sur le masque de ce triste quadrupède vertical toutes les formes plastiques des brutes ? Qui le forçait, par exemple, à imprimer au front de cette meute de juges, dont la moitié bâille en limiers endormis, et l’autre moitié en panthères affamées, le sceau caractéristique de la populace des êtres vivants ? – M. le président ne représenterait-il pas aussi dignement un Minos, un Æacus ou un Rhadamante, si ses bras, plus raccourcis et plus disproportionnés que les pattes antérieures des gerboises, avaient moins de peine à se rejoindre au-dessous d’un mufle de taureau, sur le ventre orbiculaire comme un turbot qui plastronne son buste d’hippopotame ? – Le formidable magistrat qui remplit le devoir, sans doute pénible, d’accuser les pauvres diables de mon espèce, et de les dépêcher à leurs frais vers le pilori ou la potence, ferait moins peur à voir, peut-être, mais il ne serait pas investi pour cela d’un caractère moins imposant, si la nature, dans la confusion de ses galbes capricieux, n’avait pas articulé à la base de son os frontal cet énorme bec de vautour qui lui sert de nez, et qu’elle s’est cruellement égayée, pour compléter la ressemblance, à enchâsser de tous côtés entre des membranes rugueuses et livides qui n’ont jamais rougi, même de colère ! – Quant à mon avocat d’office qui était tout à l’heure à l’extrémité de la banquette, qui est maintenant juché sur le dos de ma chaise, qui sera bientôt ailleurs, s’il plaît à Dieu, et dont tous les soubresauts menacent le parquet d’escalade, il aurait pu se passer sans inconvénient, dans l’exercice de sa noble profession, de son timbre éclatant de perroquet, et de son incommode agilité de sapajou… –
— Il faut convenir, ajoutai-je à demi-voix, sans abandonner cette pensée, que le mystère du sixième jour de la Genèse est encore loin d’être éclairci, et qu’en réduisant l’homme dégradé par sa faute à l’état des animaux relevés jusqu’à son abaissement, le Seigneur aurait tiré une digne vengeance de l’orgueil insensé du père de notre race. – Et alors, ou je me trompe, les enfants d’Adam qui auraient conservé sans altération, pendant la nouvelle épreuve de la vie, le germe d’immortalité qui a été déposé en eux, pourraient espérer de retourner un jour à ce paradis de délices, œuvre facile de la toute-puissance, œuvre naturelle de la toute-bonté. Le reste retournerait d’où il vient : dans le foyer de la matière éternelle !
— Que diable dit-il là, cria mon avocat d’un ton de fausset à déchirer le tympan d’une statue de bronze, probablement parce que j’avais eu la maladresse de prononcer ces dernières paroles assez haut pour être entendu.
— Que dit-il là ? répéta-t-il. Je le tiens, je le tiens, messeigneurs. J’ai son critérium phrénologique ad unguem. Monomanie toute pure. Insanus aut valdè stolidus. C’est ce que je vais démontrer péremptoirement dans ma plaidoirie. – Je le tiens, reprit-il avec une explosion plus bruyante encore, en retombant d’un élan sur mes épaules.
Et il me tenait en effet, parcourant ce clavier moral que d’habiles philosophes ont découvert sur la boîte osseuse de notre cerveau, avec un doigté si brutal et si aigu, que j’imaginai qu’il ne se proposait rien moins que d’en extraire la substance médullaire du cerveau, pour la déployer devant le tribunal, à l’appui de son opinion, suivant l’admirable procédé du savant Spurzheim…
— Au nom de Dieu, lui dis-je, en me débarrassant assez vivement de ses mains pour le forcer à exécuter une des plus belles virevoltes dont sa souplesse ait jamais étonné le barreau, abstenez-vous de me défendre par cet indigne moyen ! Quoiqu’il y ait dans tout ce qui m’arrive, surtout depuis hier, de quoi faire extravaguer les sept sages, et, comme disent les Italiens, impazzare Virgilio, je ne suis, grâce au ciel, pas plus stupide et pas plus fou que je ne suis coupable. Je suis innocent, et je n’ai besoin, pour me justifier que de mon innocence. Je prie seulement la cour de faire comparaître ici maître Finewood, le charpentier de l’arsenal, et mistress Speaker, l’hôtesse de Calédonie.
— Mad, mad, very mad, interrompit le petit avocat, en couvrant ma voix d’une note si élevée et si stridente qu’on parierait à coup sûr qu’elle manque à la mélopée des oiseaux.
— De quoi va-t-il parler, messeigneurs, je vous le demande ? Le charpentier de l’arsenal, et l’hôtesse de Calédonie n’ont jamais été de votre juridiction !
Quoique je comprisse mal comment je pouvais être privé de leur témoignage, il ne me vint pas à l’esprit qu’on osât me condamner sur une simple apparence, et je continuai à me défendre avec autant de sang-froid que m’en permettaient les trémoussements tumultueux, les passes étourdissantes, les écarts et les estrapades gymnastiques de mon avocat, et surtout les points d’orgue perçants, les sibilations déchirantes, et les cadences à perte d’ouïe qu’il brodait avec une richesse impitoyable sur la basse solennelle du tribunal profondément ronflant. J’alléguai mes derniers, mes seuls témoins, les années peu nombreuses mais irrécusables d’une vie laborieuse et sans reproche, et je croyais toucher à une péroraison assez entraînante, car si l’éloquence n’avait plus d’interprète sur la terre, elle se réfugierait, peut-être, dans la parole de l’innocent opprimé, quand je fus interrompu par un râlement effrayant, comme ceux qui viennent quelquefois, après trois nuits muettes, éveiller le silence de la mort dans les ruines d’une ville saccagée, et je vis au même instant se fendre et béer, sous le bec de vautour de l’accusateur, je ne sais quel affreux rictus qui avait la profondeur d’un abîme et la couleur d’une fournaise !
Celui-là ne bondissait pas. Il vibrait seulement tout d’une pièce avec une majestueuse lenteur, sur ses jambes immobiles, en articulant de la voix factice et pénible à entendre des automates parlants, quelques groupes de mots entremêlés d’interjections froides, mais qui avaient l’air de former un sens, et parmi lesquels un mot seul revenait dans un ordre de périodicité fort industrieux, avec une netteté sonore et emphatique. C’était LA MORT. Je conjecturai que le facteur de cette machine à réquisitoires tragiques devait en avoir ajusté les ressorts dans l’accès de quelque fantaisie atrabilaire ou de quelque fureur désespérée.
— Faut-il, dis-je en me recueillant, que le génie, aigri par le spectacle de nos misères, se livre à d’aussi déplorables caprices !… et de quelle erreur ne s’aveugle pas la multitude qui les reproche à la Providence !…
Tout ce que je pus saisir de sa diatribe mécanique, à part le refrain trop intelligible dont elle était coupée en paragraphes assez réguliers, c’est qu’il opposait aux garanties que j’avais cru tirer de ma vie passée une objection foudroyante, fondée sur des crimes antérieurs que je ne me connaissais pas. Mais je ne puis la faire passer dans mes paroles avec l’harmonie sauvage que prêtait aux siennes une sorte de clappement rauque et convulsif, tout à fait étranger au système de notre organisme vocal, qui les rompait par saccades, comme le criaillement d’un écrou mal graissé.
— Ah, vraiment, une jeunesse innocente et pure ! – LA MORT ! LA MORT ! LA MORT ! je ne sortirai pas de là ! – Si l’on s’en rapportait à eux, on n’en pendrait jamais un ; et à quoi servirait alors le code des peines ? À quoi la justice ? à quoi les tribunaux ? à quoi LA MORT ?
— Je prie messieurs de noter pour mémoire avant de se rendormir que j’ai conclu à LA MORT. – Quoique la rapidité de l’instruction ne nous ait pas permis d’enfler à notre contentement le dossier du condamné, je voulais dire du prévenu, mais c’est tout un, nous tenons assez de pièces probantes, – ou probables – ou au moins suffisamment idoines à former la conviction de ce gracieux tribunal, pour démontrer qu’avant l’attentat énorme dont il est chargé, il était déjà coutumier d’actions détestables, damnables, et par conséquent pendables, dont la plus excusable est punissable de MORT. – LA MORT ! LA MORT ! LA MORT ! s’il vous plaît, et qu’il n’en soit plus question. – Ce drôle est en effet véhémentement soupçonné, comme il appert, – évidemment convaincu, je le répète, de séduction sous promesse de mariage, et de soustraction fraudulente de portrait et joyaux précieux à une femme infortunée dont il a trompé la candeur, et qui lui a sacrifié son innocence ! Pour ne pas abuser des utiles moments de la cour, je me résume dans l’intérêt de l’humanité. – LA MORT ! –
Et les lèvres sanglantes du rictus homicide se resserrèrent lentement, comme les dents acérées d’une tenaille que la clef à vis rappelle de cran en cran à l’endroit où elles se mordent.
— Ô perversité de ce siècle de décadence ! meugla le gros réjoui de président, en relevant ses petits bras de toute l’extensibilité dont ils étaient susceptibles jusque près de la soudure horizontale de sa toque judiciaire avec la partie de sa tête où aurait pu être contenue sa cervelle, et que dépassait amplement des deux côtés le pavillon pourpré de ses larges oreilles. – Nous sommes donc arrivés aux temps calamiteux annoncés dans les prophéties ! Il était sans exemple dans notre jeunesse qu’on eût abusé par fausses et hallucinatoires pollicitations de la crédulité de ce sexe débile et fantasque, avant d’avoir atteint l’âge de majorité ! Encore cela n’était-il toléré qu’aux gens de race ! – Rapt ! furt ! homicide commis dans le dessein de nuire ! Désolation des désolations ! – Cependant, comme il serait insolite, illicite, et d’ailleurs physiquement impossible de pendre trois fois l’individu ici présent, – je ne me rappelle pas son nom, – j’opine pour qu’il soit pendu haut et court le plus incessamment possible, sauf à éclaircir les griefs douteux aux prochaines assises. Mais dépêchez, dépêchez, morbleu ! non festina lentè pour parfiler des périodes philanthropiques et sentimentales, monsieur du barreau, car voilà, si j’ai bien compté, vingt de ces garnements que nous expédions d’aujourd’hui ; et il m’est avis que nous siégeons dans les fonctions de notre doux ministère de propitiation paternelle, à diluculo primo, comme parle Cicéron, c’est-à-dire, messieurs, depuis que la naissante aurore a ouvert de ses doigts de roses les portes de l’Orient. On a beau prendre plaisir à faire son devoir : toujours pendre est insipide.
J’avais compris vaguement qu’il s’agissait de la Fée aux Miettes. Je me levai.
— Il est bien vrai, messieurs, dis-je en pressant le médaillon de Belkiss sur mes lèvres, car je pressentais trop la nécessité de m’en séparer, que je suis fiancé à une digne femme de Greenock, que j’y ai cherchée inutilement ; mais le terme de cet engagement n’expire qu’aujourd’hui, et ce n’est pas ma faute si je n’en ai pas rempli les conditions, puisqu’on m’a fait prisonnier ce matin, et qu’il me restait un jour pour la découvrir, si elle existe encore quelque part, ce dont il est permis de douter à cause de son grand âge. Quant au portrait dont vous parlez, il le faut, et j’y renonce, quoique sa perte brise mon cœur. Mes malheurs m’ont privé du droit de le conserver ! J’avais remarqué aussi qu’il était entouré de brillants assez riches dont je connais mal le prix, mais je prends Dieu à témoin que je n’ai pu le rendre à ma fiancée, dont la prestesse incroyable ne le cède pas même à celle de mon avocat d’office que voilà juché dans les attiques du prétoire, comme le mascaron d’un architecte hétéroclite. Je vous rends ce portrait que la Fée aux Miettes, ma prétendue, avait la simplicité de prendre pour le sien, quoiqu’il ne lui ressemble en aucune manière. Prenez-le, monseigneur, continuai-je en le mouillant de larmes, et prenez ma vie avec lui, car c’était par lui et pour lui que je vivais.
— Tudieu ! s’écria le président en saisissant le médaillon, qui avait circulé de main en main jusqu’à son fauteuil, et en promenant un regard avide sur l’entourage avant de l’arrêter sur la figure, – tudieu ! le maraud a de quoi payer largement les frais du procès ! L’affaire est plus digne d’attention que je ne l’avais pensé d’abord, et mérite quelques éclaircissements. – Attention au parquet ! Et vous, les gens de la cour, que l’on me fasse venir Jonathas le changeur, celui que l’on trouve toujours, le vieux coquin, sedentem in telonio. – Mais que vois-je, grands Dieux ! ce sont les traits vivants, c’est la peinture parlante de l’auguste reine des îles de l’Orient ! c’est notre souveraine en personne avec sa beauté dédaigneuse, son fier regard, et ses belles dents qu’elle semble toujours grincer quand elle me regarde. C’est la divine Belkiss !
— Ô prodige plus impénétrable à ma pensée que tout le reste des événements de ma vie, m’écriai-je à mon tour, ce sont les traits de la reine de Saba aujourd’hui régnante que vous reconnaissez dans cette image ! –
— Prodige, drôle ! reprit le juge en colère, et de quel prodige parles-tu ? Voilà-t-il pas un beau prodige qu’un homme de mon âge, de mon expérience et de mon savoir, qui a toujours passé, je le dis sans orgueil, pour être doué d’un sentiment très exquis des arts, et qui fait depuis quarante ans une étude spéciale de signalements et d’identités, reconnaisse au premier coup d’œil la toute ravissante Belkiss dans cette fidèle image que ta future, ou toi, vous avez volée je ne sais où ? Si tu entends par là que tu ne pensais pas que l’art pût atteindre à exprimer les perfections inimitables de l’original, je le concéderai pourtant volontiers, car je trouve moi-même dans cette peinture quelque chose de rébarbatif et de maussade qui rend mal la miraculeuse suavité de cette riante et céleste physionomie. Mais que peut le génie humain à l’expression de tant de charmes, et qu’y pourrait le pinceau même des anges et des archanges de Dieu, s’ils avaient le temps de s’occuper à cet exercice ?… –
Or çà, continua-t-il en s’adressant à maître Jonathas qui venait d’entrer, tenez-vous ici à distance respectueuse de notre personne et pour cause, entre ces deux braves gripers de notre bénévole justice, et dites-nous aussi loyalement que faire se pourra ce que doit valoir en monnaie royale le bijou qui est retenu à mes doigts par cette chaîne d’or. Parlez surtout sans ambiguïtés, maître Jonathas, car la cour est à jeun.
Jonathas le batteur d’or, – c’était le vieux juif que j’avais vu deux jours auparavant au pied de la pancarte hébraïque du capitaine, – me parut cette fois plus décharné, plus diaphane et plus misérable encore que l’avant-veille. Son échine cassée qui se pliait en cerceau, soutenait avec peine à la hauteur de sa poitrine une tête branlante, qui ne se soulevait sur l’espèce de rameau fatigué auquel elle pendait comme un fruit trop mûr qu’au tintement ou au nom de quelque métal précieux. Tout exiguë que fut cette apparence de corps, elle n’avait certainement pas pu entrer sans un effort incroyable dans le juste étriqué de serge autrefois noir qui la comprimait comme le fourreau d’un mauvais parapluie tordu, et qui ne descendait jusqu’au-dessus de ses genoux, avec une somptuosité un peu prolixe, que pour dissimuler le délabrement d’un caleçon de toile cirée que le temps avait réduit à la plus simple expression de sa trame grossière, en enlevant par larges écailles l’enduit solide qui l’avait protégé pendant une moitié de siècle. Le tissu de cet habit, blanchi par le frottement de ses omoplates, et percé symétriquement par la saillie de ses vertèbres, rappelait aux yeux le vent ou la nuée textile dont parle Pétrone, tant les frêles réseaux qui lui prêtaient encore une consistance fugitive semblaient près de se dissoudre au frottement flexible du premier arbuste, ou au souffle espiègle du premier passant ; et vous les auriez confondus avec ceux de l’araignée travailleuse qui avait tendu sur leur canevas presque invisible une doublure de peu de valeur, prudemment respectée par la brosse de Jonathas, brosse innocente et vierge, si elle a réellement existé, qui ne frotta jamais rien de peur d’user quelque chose.
— Sela, Sela, dit le vieil hébreu, qui tournait en même temps sur tous les points de l’auditoire un œil aussi brillant que mes escarboucles, pour s’assurer qu’il ne s’y trouvait point d’autre acheteur, mais en évitant soigneusement d’intéresser la partie inférieure de son corps dans cette inspection circulaire, de crainte d’user la semelle de ses pantoufles : — Sela Sela ! ce médaillon vaut dix-neuf schellings comme un plak. Attendez, attendez, monseigneur, et ne vous emportez pas comme à l’ordinaire contre votre pauvre serviteur Jonathas ! Est-ce dix-neuf cents guinées, mon doux seigneur ! ce n’est pas la conscience qui manque à votre honnête client et sincère admirateur Jonathas, et vous pouvez le savoir, car je vous ai vu tout petit, déjà beau et bien proportionné comme vous voilà. – Mais la vieillesse et la pauvreté obscurcissent l’intelligence, comme les ténèbres le soleil. Ceci est dans le saint livre de Job. – Hélas ! je suis si affaibli d’esprit que je ne saurais dire le verset ! – Cependant, si j’ai offert du premier mot quatorze cents guinées, je suis prêt à les envoyer tout de suite au greffe à M. le recorder ! – Sela, Sela, je ne les porte pas dans mes poches, parce que cela pèse et que ce qui pèse troue ; et c’est beaucoup, par la dureté des temps qui courent, que de trouver la somme exorbitante de neuf cents guinées chez soi et chez ses amis.
— Sela, Sela ! s’écria le président, qui ne se contenait plus de colère ! Voici qui est bon quand il s’agit de l’argent d’autrui, et je t’en ai passé jusqu’ici de quoi faire figurer vingt synagogues aux fourches de Saint-Patrick ; mais il s’agit de l’argent de la justice et de notre pécule magistral, et si tu me mens d’un seul grain de laiton faux, je te fais hisser avec ce vaurien, par le beau soleil du midi, à la plus haute potence de Greenock dans une chemise de mailles de fer, pour jouer par cet appât un tour mémorable aux corbeaux ! Tu n’auras jamais été vêtu aussi solidement.
— Sela, Sela, reprit Jonathas avec une inflexion de voix doucereuse et caressante ! Monseigneur a toujours le mot pour rire ! Il était déjà comme cela tout enfant quand je le vis la première fois, un enfant si joli, si affable et si gracieux ! – Mais il me semblait que dix-neuf mille guinées étaient un assez beau prix, et si j’ai dit vingt mille neuf cents guinées, je tâcherai de parfaire la somme avec mes pauvres hardes, pour l’honneur de ma parole. Je prie cependant la cour de considérer la misère du malheureux juif obligé de mendier son pain depuis la ruine du temple de Jérusalem, et qui n’a de fortune quand il est vieux que son industrie et sa probité ! – Oh ! ne vous emportez pas ainsi, monseigneur, car votre aimable physionomie devient alors terrible à voir, comme disait la reine Esther au roi Assuérus ! – S’il ne tient qu’à une charretée de méchants sacs de guinées pour acquérir ce bijou, j’en donnerai deux cent mille pour mon dernier mot. – Va donc pour deux cent mille guinées !
— Va pour deux cent mille cordes qui t’étranglent ! dit le président, pâle d’avarice et de fureur. – Deux cent mille guinées d’un pareil trésor ! – Qu’on fasse venir le schériff, et qu’on pende tout le monde !
Mon avocat sauta par la fenêtre.
— Ce n’est pas la crainte qui me touche, dit Jonathas, dont la tête pendait jusqu’à terre, et aurait balayé les tapis de ses cheveux blancs, si la nature lui avait laissé ce noble ornement d’une sage vieillesse. – En vérité, ce n’est pas pour moi, mais pour la gloire de mon peuple et la consolation d’Israël. – Mais, quand je devrais être pendu, je ne pourrais donner de ce médaillon plus de deux millions de guinées. – Votre grâce entend bien que je n’y comprends pas le portrait, dont j’aurais peine à trouver le débit, car il menace les regardants de deux rangées de dents si effroyables qu’il m’est avis qu’on ne verrait pas leurs pareilles dans toute la gendarmerie du bailli de l’île de Man. Je le céderai à l’amiable pour la dépouille du bandit, qui me paraît un peu plus soignée qu’il ne convient à cette espèce.
Il tournait sur moi, au même instant, un petit monocle bordé de cuivre, pendu à une vieille ficelle. — Ma dépouille, maître Jonathas ! et mon cadavre dedans ! et vingt guinées que vous pourrez réclamer du capitaine de la Reine de Saba, si je ne suis pas au port à midi ! et vingt guinées plus ou moins que vaut la pacotille que j’y ai fait arrimer ! et tout ce qui me reste sur la terre de propriétés légitimes, par droit d’acquêts ou de successions, en titres, en créances, en espérances, en jouissances actuelles et à venir ! – Tout pour le portrait de Belkiss ! – Tout pour le toucher, tout pour le voir encore une fois !
— Bien, bien, dit le juif ; c’est une affaire comme une autre, et qui me donne recours légitime sur tous vos débiteurs, dont la liste est tombée de hasard entre mes mains, gens peu solvables, comme vous savez, parmi lesquels je vois comprise une misérable mendiante qui a élu pour domicile le porche de l’église de Granville. Qu’il vous plaise donc de me bailler cédule de nos dites conventions avant le prononcé du jugement, vu que l’on ne peut plus contracter de marché valable en justice, une fois que l’on est pendu.
— Malédiction, Jonathas ! gardez le portrait de Belkiss ! j’aime mieux perdre cette image adorée que le repos de mon cœur, où je suis du moins sûr de la retrouver, tant qu’il battra dans ma poitrine.
Pendant ce temps-là, les juges avaient conféré entre eux, et les deux millions de guinées de Jonathas leur faisaient aisément oublier les débats de ma procédure. Ma condamnation n’était plus qu’un incident imperceptible dans une magnifique opération. Comme j’entendais parler de partage, il me sembla quelque temps que les voix se divisaient et que mon innocence, protégée par le zèle équitable de deux ou trois hommes de bien, finiraient par prévaloir ; mais je m’aperçus, en y prêtant un peu plus d’attention, que le partage qui était si vivement débattu par les souverains arbitres de ma vie, c’était le partage des diamants.
Cependant le débat se prolongeait, et il paraissait même qu’il eût changé de nature depuis qu’un des tipstaffs de la cour, qui venait de pénétrer dans la salle d’audience, avait déposé ostensiblement devant le président une missive scellée de sept sceaux, dont l’ouverture et le dépouillement s’étaient accomplis avec toutes les formalités d’une respectueuse déférence.
Ce nouvel épisode me laissa le temps de réfléchir pendant quelques minutes.
— Étrange créature, dis-je, que la Fée aux Miettes, si brillante d’esprit et de savoir, si instruite d’étude et d’expérience, et qui a mendié deux cents ans, de pays en pays, avec un colifichet de cinquante millions pendu au col !
XVIII.
Comment Michel le charpentier était innocent, et comment il fut condamné à être pendu.
Voici bien autre chose ! dit tout à coup le président en déployant sa dépêche sur la table du tribunal. Rara avis in terris ! L’auguste Belkiss, qui ne s’occupe jamais de nous qu’à ses jours de récréation pour nous faire quelques bénignes espiègleries, daigne intervenir comme partie civile dans la cause de ce garnement, et, usant à son égard de sa générosité ordinaire, elle entend et ordonne qu’il lui soit permis de choisir entre ce portrait et sa garniture, afin d’en jouir et disposer comme il lui conviendra jusqu’à son heure dernière. – Hélas ! cela ne sera pas long, et ma sensibilité naturelle s’en afflige :
Homo sum ; nihil humanum a me alienum puto.
Donc si tu as ouï, Raphael, Gabriel, ou comme on t’appelle – cela est écrit – si ta naturelle ineptie t’a permis de pénétrer les suprêmes intentions de notre bien-aimée maîtresse, je t’enjoins en son nom de nous faire connaître ta résolution élective ou optative, qui ne me paraît pas difficile à prévoir.
Mais, en vérité, continua-t-il à demi-voix en se retournant du côté des juges, n’était que notre adorable souveraine brille de tout l’éclat de son printemps et de sa beauté, j’aurais quelque velléité de croire que sa raison s’affaiblit, et qu’elle tombe dans l’état que les juristes ont appelé pueritia mentis.
— Je voudrais bien savoir, pensai-je en me rongeant les doigts, depuis quand et à quel propos on rend la justice à Greenock au nom de la reine de Saba ! Il faut que la peur ait un peu détraqué mon cerveau, ou que tous ces gens-là soient eux-mêmes devenus fous !
— Est-ce ainsi, reprit-il avec emportement, que tu accueilles cette marque de magnificence haute et royale, et attends-tu que je prenne acte de ton silence insolent pour confisquer ce bijou au profit de la justice ?
— Non pas, s’il vous plaît, monseigneur ! m’écriai-je à l’instant. Il me semblait seulement qu’un magistrat placé si haut dans la confiance de l’illustre Belkiss ne douterait pas de mon choix, et je croyais vous l’avoir entendu dire. – C’est le portrait que je veux, le portrait seul et dépouillé de tous ses ornements, qui n’appartiennent ni à la justice ni à moi, mais à la Fée aux Miettes. C’est le portrait de Belkiss !
Une rumeur d’étonnement courut dans le tribunal et dans l’auditoire, mais j’y fis peu d’attention, parce qu’un huissier me rapportait en courant, pour ne pas me laisser le temps de me dédire, cette image consolante et chérie dont la possession comblait mes derniers vœux et rachetait toutes mes douleurs. Elle n’était plus revêtue que d’une capsule de métal d’un blanc terne qui paraissait aussi vil que le plomb, et qu’on aurait pu d’ailleurs en détacher sans la rompre, tant le ressort qui la faisait jouer y était artistement uni.
Je ne perdis pas un moment pour regarder Belkiss, dont la joie passait toute expression, tandis que le digne président, absorbé par un autre soin, faisait sauter deux à deux les plus belles escarboucles de la bordure d’or, pour payer sur leur produit les frais de la procédure, et que Jonathas, à demi désappointé essuyait du revers de sa main de momie les seuls pleurs qu’il eût jamais versés. Ma satisfaction était si pure et si complète que je craignis de m’en distraire, en m’égayant aux détails de cette scène grotesque, et je restai plongé si longtemps dans la contemplation qui m’enivrait, que je n’avais changé ni de posture ni de pensée, quand la cour revenue de ses opinions me notifia ma sentence. J’étais condamné sans appel, et les termes du jugement ne m’accordaient aucun délai.
— Belkiss, chère Belkiss, dis-je en la regardant avec plus d’ardeur que jamais, comme pour accumuler sur mon cœur, dans l’espace de quelques minutes qui me restaient à la voir, toutes les impressions d’une longue et heureuse vie ; chère et adorée Belkiss, il faudra donc bientôt vous quitter !…
Et alors Belkiss, qui ne se contenait plus, rit à faire éclater l’émail. Je me hâtai de refermer le médaillon et de le replacer sur mon sein, de peur de compromettre l’existence de mon trésor, pour le peu d’instant que j’avais à le conserver, en laissant une trop libre carrière à l’expansion de sa gaieté. Cependant cette précaution me coûta, je l’avoue, un léger mouvement de dépit.
— En vérité, murmurai-je avec une secrète amertume, je voudrais bien savoir ce qu’elle trouve de plaisant dans tout cela, et de quoi elle s’amuse ! Il faut convenir que les femmes ont des caprices bien singuliers !
Pendant que je me faisais cette allocution intérieure, les constables s’étaient rangés en cercle autour de moi, et le schériff m’avait touché de sa canne d’ébène en signe de prise de possession.
Bientôt on marcha, et je marchai. Je descendis les longs escaliers du palais. Je traversai lentement ses vastes et froids vestibules entre deux lignes d’hommes armés ; je parvins au guichet de la dernière porte, d’où je devais gagner la place fatale. J’y passai presque en rampant, et je me relevai à la lueur du soleil qui arrivait au plus haut point de sa course, et que je venais voir pour la dernière fois dans la splendeur de son midi.
Jamais le jour n’avait été si beau. La nature ne porte pas le deuil de l’innocent.
Mille voix qui ne formaient qu’une voix s’élevèrent comme une bourrasque.
— Le voilà ! le voilà ! cria la foule en agitant en l’air des bras, des chapeaux, et des plaids.
Et elle s’ouvrit pour me laisser passer en répétant : Le voilà !
XIX.
Comment Michel fut conduit à la potence, et comment il se maria.
Je ne m’étais jamais exercé à la cruelle idée de mourir pour un crime sous les regards du peuple. Mes sens restèrent quelque temps confondus dans l’horreur de cette accusation, qui me faisait oublier l’horreur du supplice, et toutes les voix de la multitude se perdirent à mon oreille dans je ne sais quel écho grave et menaçant dont le retentissement inexorable me poursuivait des noms de voleur et d’assassin. Tout à coup je me rappelai que Belkiss était assurée de mon innocence puisqu’elle paraissait si contente ; j’avais lieu de croire qu’elle devait connaître mon oncle et mon père, et qu’elle ne manquerait pas de me justifier à leurs yeux s’ils existaient encore. Je récapitulai ma vie passée, qui me paraissait exempte de reproche, au moins selon le jugement de ma conscience, et j’en fis hommage à Dieu. Dès ce moment, je m’avançai plus paisible au rapide passage qui allait m’introduire, sans crainte et sans remords, dans les secrets de l’éternité, et je ne vis plus dans l’étrange tableau qui se mouvait autour de moi comme une scène de vertige, qu’une espèce de spectacle.
Je craignais cependant, je l’avouerai, d’apercevoir, parmi les curieux qui se ruaient au-devant de mes pas, quelques-unes de ces figures connues dans lesquelles je n’étais accoutumé à lire qu’une bienveillance peut-être un peu inquiète, mais dont l’expression m’avait plus d’une fois pénétré d’attendrissement et de reconnaissance, parce qu’elle ressemblait à celle de l’amitié. En effet, je me croyais aimé des enfants mêmes de Greenock, âge qui sait rarement aimer, et si je les avais entendus se dire quelquefois en passant près de moi, avec leur malice rieuse : « C’est lui, c’est le beau charpentier de Granville qui est fiancé à la veuve de Salomon, » je me flattais au moins de leur avoir inspiré quelque sentiment plus doux par mon empressement à les aider dans leurs études, et à leur apprendre le nom des fleurs et des papillons. Heureusement, je ne rencontrai personne que j’eusse rencontré jamais, et comme la population de Greenock n’est pas telle qu’on ne puisse la passer en revue dans un an, je fus sur le point d’imaginer qu’elle s’était renouvelée tout entière, durant le cours de cette terrible nuit ; j’allai même jusqu’à m’en féliciter dans mon cœur, parce qu’il serait meilleur de mourir au milieu d’une génération à laquelle on ne coûterait du moins point de larmes.
Je ne tardai pas à me détromper. J’ai dit qu’il était midi, et c’était l’heure où la Reine de Saba devait mettre à la voile. Comme le vent était contraire, je supposai d’abord que le capitaine n’y penserait pas ; mais j’aperçus, en arrivant à la hauteur du port, le bâtiment tout appareillé qui se berçait majestueusement sur sa quille, et qui donnait ses derniers signaux de départ, avec une assurance si nouvelle, même pour les fameux mariniers de Greenock, qu’elle partagea un instant l’attention entre l’infortuné qui allait mourir et le vaisseau qui allait voguer. Je finissais ma course, et il commençait la sienne à travers des hasards aussi aventureux que ceux de la vie, pour aborder comme moi à quelque plage inconnue. — La Reine de Saba, dis-je en frissonnant, le vaisseau triomphant de Belkiss qui devait me rendre à mes parents ! C’était donc hier !
Une clameur s’éleva sur la rive, les câbles sifflaient, et le navire, qui ne nous apparaissait plus que par sa poupe, silla si promptement à l’horizon de la mer qu’au bout d’une seconde ce n’était qu’un point noir, et qu’au bout d’une autre seconde ce n’était rien.
Le vaisseau parti, on revint à moi. De jolies petites filles au teint un peu hâlé, et aux cheveux noirs et bouclés, comme la plupart des jolies petites filles de Greenock, me précédaient en distribuant au peuple, pour un plak, l’histoire lamentable du bailli Muzzleburn que j’avais égorgé à l’auberge de Calédonie. D’autres jeunes filles se disputaient la feuille tout humide d’impression, afin de la reporter plus vite à un amant ou à un père qui les soulevaient d’un bras caressant pour leur montrer un homme qu’on allait tuer au nom de la justice et des lois.
Nous allions à pas mesurés, soit à cause de la solennité qui s’attache parmi les peuples les plus sauvages à un sacrifice humain, soit pour satisfaire à loisir aux empressements de ce concours d’hommes, et surtout de femmes et d’enfants, palpitants de curiosité et de joie, qui composent le public ordinaire des exécutions. La lenteur de ce convoi vraiment funèbre, et qui ne diffère de l’autre que parce que le cadavre marche, me permettait de saisir à mes côtés quelques paroles des spectateurs.
— Qui ne s’y serait trompé, disait une blonde à l’œil triste et doux, qui s’était arrêtée là, son carton de modiste sous le bras ? Voyez comme son regard est assuré sans être fier, et modeste sans être abattu ! Croirait-on qu’un coupable sût mourir ainsi ? Oh ! pour tout l’or du vieux Jonathas, je ne voudrais pas reposer ma tête la nuit prochaine sur le chevet de son juge.
— Il faut cependant, reprit une de ses compagnes, que ce soit un coupable bien convaincu, pour avoir été condamné, puisqu’on dit qu’il est riche à plus de 50 millions ; et Dieu sait qu’il aurait eu meilleur marché de la conscience de toutes les cours souveraines, d’ici au royaume de Belkiss, si son crime avait pu s’excuser.
— Que dites-vous de 50 millions, mes belles dames ? reprit un jeune homme qui cherchait à se mêler à leur conversation. Le seul collier de ce bandit valait infiniment davantage, et le banquier Jonathas vient de payer 100 millions une seule des escarboucles qui en avaient été retirées pour les frais de justice.
— À quel propos alors, interrompit un vieillard assez morose, que le mouvement de la foule avait poussé dans ce groupe, à quel propos et dans quel intérêt aurait-il assassiné le pauvre sir Jap Muzzleburn, dont le revenu, contenu, dit-on, dans le portefeuille volé, ne passait pas, à mon avis, quelque 100,000 malheureuses guinées ?
— À quel propos, en effet ? s’écria la petite modiste aux cheveux blonds. Il faudrait que ce malheureux fût fou.
— C’est que je crois qu’il l’est réellement, repartit le jeune homme en souriant. Imaginez-vous qu’on assure qu’il s’était proposé de rebâtir le temple de Salomon !…
Là-dessus il mordit son bambou pour s’empêcher d’éclater, et je passai.
Les stations se ralentissaient cependant de plus en plus, au point de me permettre de presser de temps en temps sur mes lèvres le portrait de Belkiss, quand le schériff s’arrêta tout de bon pour réprimer l’impatience frénétique de la populace, en lui annonçant par un signe imposant que mon exécution était suspendue d’un moment ; car la vie de l’homme est au bout du bâton d’un officier de justice, comme au bout du doigt de Dieu. Ces deux autorités, par bonheur, ne sont en partage que sur la terre.
Il s’agissait d’annoncer qu’en vertu d’un vieil usage d’Écosse, que je croyais depuis longtemps tombé en désuétude, ma vie pouvait être rachetée par l’amour d’une jeune fille qui me prendrait en mariage. Cette idée me fit hausser involontairement les épaules, et je portai ma main avec force sur le portrait de Belkiss, pour qu’elle n’eût pas le temps de douter de l’assurance de ma résolution ; mais je dois avouer que mon indignation s’augmenta du déplaisir que me causait le mauvais langage de cette proclamation légale, dans une circonstance assez sérieuse. — Hélas ! ces gens-ci, me disais-je, ont raffiné la parole pour les plus puériles frivolités de la vie, pour échanger de faux souhaits et des compliments imposteurs, et la loi qui tue ou qui sauve est encore écrite dans le jargon des sauvages ! Assassiner judiciairement un homme, c’est un crime effroyable ! mais le plus grand des crimes, c’est de tuer la langue d’une nation avec tout ce qu’elle renferme d’espérance et de génie. Un homme est peu de chose sur cette terre, qui regorge de vivants, et avec une langue on referait un monde.
La patience me manqua, et je crois que j’aurais maudit le schériff et le patois barbare des lois, si je pouvais maudire.
Mon émotion fut remarquée, car la petite blonde me suivait toujours.
— Je croyais, dit-elle, qu’il irait jusqu’à la mort sans montrer de colère.
— C’est qu’il comptait peut-être, pour échapper au supplice qui l’attend, sur les impressions que vous venez de trahir, dit le jeune homme en jetant le bras autour de son cou, et je conviens qu’il vaudrait la peine d’être sauvé sans la confiscation ; mais la confiscation est de règle, et c’est même quelquefois pour cela qu’on est pendu.
— Si j’ai bien compris le sentiment qui a rembruni son visage, interrompit le vieillard qui les suivait encore, parce que la foule était trop pressée pour se diviser en si peu de temps, je crois que les approches de la mort y ont moins de part que la sotte allocution du schériff. Vous ne sauriez croire, mademoiselle, combien il est fâcheux de monter à la potence, en dépit du bénéfice de clergie, pour satisfaire aux sanglantes conventions d’une société qui n’a pas encore mis à profit l’avantage de la parole.
Je voulais sourire à ce bon homme, et lui témoigner qu’il avait pénétré dans ma pensée ; mais il n’y était déjà plus, parce que la place élargie avait ouvert de libres issues aux curieux satisfaits. Quant à la jeune blonde et à son interlocuteur, je me doutai qu’ils s’étaient ménagé le plaisir de me voir passer plus loin, de la croisée d’un des cabinets particuliers de mistress Speaker.
Nous étions, en effet, parvenus à la place où s’exercent ces boucheries judiciaires qui maintiennent encore notre civilisation au niveau des lois et des mœurs des anthropophages. À l’extrémité s’élevait un échafaudage de mauvaise grâce dont les profils barbares n’avaient pu être dessinés que par quelque méchant manœuvre. L’appareil qui le surmontait n’était jamais tombé sous mes yeux ; mais je n’eus pas de peine à en deviner l’usage. Ma vue s’en détourna, non de terreur, car j’aspirais à la mort comme au réveil d’un songe pénible, mais d’un mélange d’attendrissement et de dégoût dont je fus un moment à me rendre compte. On ne saurait comprendre ce qui entre de dédain ou de compassion pour le genre humain dans le cœur d’un innocent qui va mourir.
C’était l’endroit de la seconde station du schériff, et, pendant qu’il reprenait sa détestable harangue, sans l’avoir émondée d’un solécisme, je cherchais à en distraire mon attention dans la solution d’un problème ou d’une étymologie, quand le son d’une voix connue vint vibrer au fond de mon sein.
— C’est moi, c’est moi qui le sauverai, criait Folly en se débarrassant avec violence des mains de ses compagnes, les petites grey gowns de Greenock, qui ne voulaient pas la laisser partir.
Je n’avais jamais eu d’amour pour Folly, dans le sens que j’attachais à cette passion inconnue. L’amour que je m’étais fait ne se composait que des sympathies les plus délicates de l’imagination et du sentiment. C’était toute une âme qu’il fallait à la mienne, une âme tendre, une âme sœur et cependant souveraine, qui m’enveloppât, qui me confondît et m’absorbât dans sa volonté, qui m’enlevât tout ce qui était moi pour le faire elle, qui fût autre chose que moi, un million de fois plus que moi, et qui cependant fût moi. Oh ! cela ne peut pas se dire !
Cette joie immense, accablante, indéfinissable, qui me manquait, et qui manque probablement à la plupart des hommes, j’en avais amassé tous les rayons au portrait de Belkiss, comme dans la lentille du physicien qui fond l’or et brûle le diamant à travers un froid cristal, en concentrant les tièdes chaleurs d’un jeune soleil d’avril. Je savais bien que c’était là une illusion ; mais je ne devinais pas de réalité qui valût mieux pour le bonheur.
Et cependant, monsieur, je concevais qu’un homme autrement organisé, – je vous l’ai dit sans doute, – pût être heureux de l’amour de Folly ; car Folly était jeune, jolie, éveillée, pleine de grâces dans sa marche et surtout dans sa danse, aimable, fraîche, ravissante comme une rose qui s’épanouit, et qui ne demande qu’à être cueillie. Les heures de délices que Folly pouvait me donner, je les avais rêvées aussi. J’avais rêvé ses blanches dents, qui semblaient rire avec ses lèvres ; j’avais rêvé son regard, non pas épanoui d’habitude sur sa large prunelle, mais jaillissant par traits de flamme entre tous les cils de ses yeux. J’imaginais facilement tout ce que Folly émue, troublée, palpitante, se défendant pour se laisser vaincre, Folly pressée sur ma poitrine, les doigts dans mes cheveux et la bouche près de ma bouche, devait répandre de charmes sur quelques minutes, sur quelques journées de ma vie. Je m’étais fait peut-être une chimère plus délicieuse que la vérité des voluptés de cet amour-là ; je croyais qu’il valait mieux que mille existences : mais ce n’était pas mon amour !
Si vous vous rappelez qu’il restait à peine quelques toises à parcourir entre l’échafaud et moi, vous trouverez cette digression bien longue. Je l’ai reprise dans mes réflexions ; elle ne tient pas une minute dans mon histoire.
— Eh ! que m’importe qu’il soit fou, disait Folly ! je le sais aussi bien que vous ! que m’importe qu’il soit pauvre et sans ressources que son métier ! que m’importe même qu’il ait tué sir Jap Muzzleburn, qui n’était au fond que le roi des chiens ! n’est-ce pas Michel, mon cher Michel que j’ai tant aimé, et que j’aime plus que jamais ! – Non, non, continua-t-elle en tombant à mes pieds, et en appuyant sur mes genoux sa tête échevelée, en les saisissant de ses mains tremblantes, non, tu ne mourras pas, tu vivras pour moi, pour ta petite Folly ! Je guérirai ton esprit égaré, je te réveillerai dans tes mauvais songes ; et tu seras heureux, parce que mon amour préviendra tous tes soucis, se jettera au-devant de tous tes chagrins, et fera passer ton imagination des folles erreurs qui la troublent dans un état constant de repos et de joie !… – Arrêtez, arrêtez, monsieur le schériff, ajouta Folly, en renversant en arrière son front d’où flottaient ses beaux cheveux ! n’allez pas plus loin, monsieur le schériff !… annoncez que Michel de Granville est pris en mariage par Folly Girlfree, vous savez bien, la petite mantua-maker ; j’ai travaillé pour madame !
— Hélas, chère Folly ! répondis-je les yeux mouillés de pleurs, le ciel m’est témoin qu’après ce qu’il m’est prescrit d’aimer, je n’aime rien mieux que toi, et que le dévouement que tu me prouves, pauvre enfant qui me crois coupable, surpasse toutes les idées que je me suis faites de la tendresse et de la vertu, mais tu n’ignores pas qu’un engagement sacré m’empêche de profiter de ton sacrifice.
— Eh quoi ! dit-elle en se relevant furieuse, c’est donc là ma récompense ! moi qui ai refusé ce matin la main du riche Coll Seashop, le maître du calfat, le plus beau et le plus sage des mariniers de Greenock, tu me rebutes pour l’image d’une princesse d’Orient qui n’existe peut-être pas, qui n’aurait jamais rien été pour toi si elle existe, ou qui t’aurait repoussé avec mépris au rang de ses derniers esclaves ! Malédiction sur Belkiss !
— Tais-toi, m’écriai-je en portant ma main avec respect sur le portrait de Belkiss ! tu as blasphémé, Folly, parce que tu ne me comprenais pas, et je sens que Belkiss te le pardonne ! Mon amour pour ce portrait n’est en effet qu’une illusion, et mon esprit, si malade que tu le supposes, n’a jamais conçu l’orgueilleuse prétention d’un retour ! Ce que je voulais te dire, c’est que je ne pouvais contracter de nouvel engagement, parce que j’étais fiancé avec une autre femme, et que c’est aujourd’hui même qu’elle aurait eu droit de réclamer l’exécution de ma promesse. Je n’ai pas besoin de t’apprendre, chère Folly, que les devoirs d’un honnête homme lui sont plus sacrés que sa vie et que son bonheur.
— Cette défaite humiliante, il faudrait au moins l’expliquer ! reprit Folly.
— Oui, oui, répondis-je en souriant, et en rapprochant sa main de mes lèvres. Je suis fiancé, et je te le jure dans ce moment imposant où le parjure me priverait pour l’éternité de la bénédiction de Dieu, je suis fiancé avec une vieille mendiante qui m’a communiqué tout ce que j’ai d’aptitude et de savoir au-dessus de la plupart des hommes, et qui a eu la même bonté pour tous les chefs de notre famille, en remontant jusqu’à mon septième aïeul. Cette bonne femme, qui est peut-être morte, mais qui ne m’a pas dégagé de mes obligations, s’appelle la Fée aux Miettes.
À ces mots, Folly croisa les mains, les laissa retomber, et secouant la tête avec une profonde expression de pitié :
— Va donc mourir, me dit-elle, pauvre infortuné, puisque rien ne peut te rendre à toi-même, et qu’il s’est trouvé des juges assez stupides et assez cruels pour te condamner. – Puis elle resta immobile, et les yeux attachés à la terre pendant que je suivais le cortège, qui s’était remis en marche sur les pas du schériff.
Un instant après, il avait gagné la partie supérieure de l’échafaud, d’où il jetait sa proclamation au peuple pour la troisième et dernière fois, et je prenais possession d’un pied ferme de ces fatals degrés que les condamnés ne redescendent jamais vivants, quand un brouhaha de l’espèce la plus extraordinaire en pareille circonstance vint distraire mon attention de l’idée sérieuse qui commençait à l’occuper. C’était une tempête d’éclats de rire frénétiques et à rendre les gens sourds, dont l’explosion venue de loin augmentait de force en approchant, comme si la foudre s’était déchaînée en tourbillons rivaux pour l’apporter à mon oreille. Je me retournai du côté du peuple, et vous pouvez juger de mon étonnement quand j’aperçus la Fée aux Miettes, la béquille étendue à l’horizon en signe de commandement, ainsi que je l’avais laissée quand je la perdis dans ces dunes de Greenock, où elle me fit faire tant de chemin. Ma première pensée fut qu’elle achevait son tour du monde par terre, depuis que nous ne nous étions vus, mais sa tournure pétulante et sa toilette plus ambitieuse encore que d’ordinaire n’avaient rien qui annonçât les rudes fatigues du piéton. C’était un luxe de dentelles, de rubans et de bouquets qui passait toutes les féeries de l’Opéra.
— Grand Dieu, lui dis-je en m’unissant de grand cœur à la gaieté universelle, que vous voilà magnifiquement accoutrée, Fée aux Miettes, et que j’aurais plaisir à vous voir de la sorte dans une meilleure occasion ! Mais vous savez de quoi il s’agit ici pour moi, et je suis désagréablement surpris, je vous l’avouerai, qu’une digne femme qui voulait bien m’aimer un peu, que j’ai connue si favorablement disposée envers ma famille, et qui s’est toujours distinguée par un tact si exquis des bienséances, ait réservé l’étalage des plus brillantes galanteries de son vestiaire pour le jour où son malheureux petit Michel doit être pendu !
— Pendu ! reprit vivement la Fée aux Miettes, en bondissant sur ses jolis souliers roses avec cette élasticité ascensionnelle que vous lui connaissez depuis longtemps ; – pendu ! et pourquoi seriez-vous pendu, méchant, puisque j’arrive pour vous sauver ? Ne me devez-vous pas merci d’amour et guerdon de loyauté au jour préfix où nous sommes, et ne venez-vous pas de le dire vous-même à ma jolie mantua-maker, Folly Girlfree ? Ce n’est pas, Michel, que je veuille abuser de votre foi à des engagements que vous avez peut-être pris trop légèrement ; je vous aime sans doute, et plus que je ne puis le dire, mais mon cœur se briserait, mon enfant, plutôt que de consentir à vous imposer un regret. Folly est jeune et piquante, et je sens que je me fais quelque peu vieille depuis notre dernière rencontre. Si vous trouvez votre bonheur à épouser Folly, je suis tout prête à vous rendre votre liberté au prix des plus chères espérances de ma vie !
Cela dépend de vous, continua-t-elle d’un son de voix qui s’était attristé de plus en plus, et l’argent que je vous dois a même assez profité dans mes mains pour vous assurer un bon établissement.
L’honneur de mon caractère n’exige qu’une chose, ajouta la Fée aux Miettes en se redressant avec toute la dignité que pouvait comporter sa petite taille, c’est que vous me rendiez mon portrait.
— Le portrait de Belkiss, Fée aux Miettes ! ah ! vous en êtes la maîtresse !
Et en disant cela, j’avais poussé machinalement le ressort de manière à entrouvrir assez le médaillon pour m’assurer que Belkiss pleurait.
— Voilà ce portrait qui a fait le bonheur d’une année de ma vie, et que je n’étais pas digne de posséder si longtemps ! Mais je ne vous le rends point à la condition que vous me proposez. J’aime dans Folly les agréments d’une jeune et bonne fille qui a pitié de moi, quoiqu’elle me croie insensé et coupable, parce que son âme, toute charmante d’ailleurs, ne vit pas dans la même région que la mienne. Les engagements qui m’attachent à vous, la protectrice et l’ange tutélaire de mes années d’écolier, pour être un peu plus bizarres au jugement du monde, ne m’en sont ni moins doux ni moins sacrés. Je les ai pris librement, et je les tiendrai sans effort, car mon cœur n’est lié d’aucun amour par les créatures de la terre. Vous êtes ma fiancée et mon épouse, Fée aux Miettes, et je vous donnerais ce titre aujourd’hui avec autant de plaisir que dans les grèves où je pêchais aux coques de Saint-Michel, si ce n’était pas à vous à le répudier. Vous ignorez sans doute ma fatale histoire, et vous ne savez pas que cette échelle sanglante où je monte, a été dressée pour un assassin !…
— Un assassin, toi, mon enfant ! dit brusquement la Fée aux Miettes ; eh ! mon Dieu, mon amour me trouble et m’étourdit tellement que j’ai oublié tout d’abord ce que j’avais à faire ici ! Personne à Greenock ne doute maintenant de la vérité. Sir Jap n’est pas mort, mon cher Michel ; il sait que tu as sauvé sa vie, sa fortune, et les revenus de l’île de Man. La léthargie dans laquelle la terreur le fit tomber quand il te vit aux prises avec tant de mauvais sujets ne l’a pas empêché de comprendre les prodiges de valeur que tu as dû faire pour le défendre. Depuis qu’il est revenu à lui, ses émissaires n’ont cessé de parcourir les rues en proclamant ton innocence, et voilà que le schériff la proclame aussi. Entends plutôt le peuple qui bat des mains ! Sir Jap lui-même ne m’aurait pas laissé l’avantage de le précéder, si quelque reste de son indisposition ne l’avait retenu, ou s’il ne s’était arrêté, en passant, à déjeuner avec le juge instructeur et le médecin légal que j’ai laissés disposés à faire largement honneur aux frais de la vacation. Tu es innocent, Michel, tu es libre, et je n’aurais plus contre toi qu’une action civile, que je n’exercerai jamais ; tu le sais bien ! Dispose donc à ton aise de ta main et de ton sort, et rends-moi mon portrait, si tu ne veux pas me tenir les promesses étourdies que tu m’as faites.
J’étais libre en effet. Le schériff avait brisé sa baguette, les constables avaient disparu ; et Jonathas, que je venais de voir roulé au plus haut degré de l’échafaud dans le linceul où il espérait emporter mon cadavre, se retirait confus pour la seconde fois de la journée, en s’enveloppant de son drap de mort.
— Votre portrait, je vous le rends, Fée aux Miettes, répondis-je en souriant : car mon extravagante passion pour une adorable princesse que je ne reverrai jamais s’accorderait mal avec les sentiments sérieux d’un époux. Mes promesses, je les accomplis en pleine liberté d’esprit et de cœur : j’atteste Dieu et les hommes que je vous épouse, Fée aux Miettes, parce que je vous l’ai promis, parce que je vous respecte comme une vieille et savante personne, et aussi parce que je vous aime.
Je tremblais que la Fée aux Miettes ne prît à ces mots un de ces élans prodigieux qui m’avaient étonné si souvent, et par lesquels sa joie se manifestait presque toujours dans les grandes occasions. Je me trompais : mes yeux la retrouvèrent à sa place en se rabaissant sur elle, et je fus frappé du sentiment doux et passionné qui semblait alors humecter les siens…
— Non, non, reprit-elle en rattachant de toute l’agilité de ses jolis doigts d’ivoire le médaillon à la chaîne… Oh ! vraiment non ! tu le garderas toujours ! je ne me croirais pas assez aimée de toi, si je n’en étais aimée aussi sous les traits de ma jeunesse !…
Je me penchai pour imposer sur son front le baiser solennel qui consacrait notre mariage, et je laissai tomber ma main à la hauteur de son petit bras, qui la ceignit fièrement à l’instant comme le bras d’une épousée.
— Merveille, merveille ! crièrent les spectateurs, le fiancé de la veuve de Salomon qui épouse la Fée aux Miettes !
— Ne les écoute pas, reprit à voix basse la Fée aux Miettes. La veuve de Salomon, ce n’est pas la beauté, c’est la sagesse ; et tu n’es pas aussi trompé qu’ils l’imaginent, si je parviens à te procurer un peu de bonheur…
Je lui fis entendre en pressant sa main que je n’avais rien à désirer, et que les risées stupides qui couraient sur notre passage n’humiliaient pas mon cœur. Je témoignai, au contraire, par mon assurance que j’étais fier de l’amour de cette pauvre vieille femme ; et de quoi s’enorgueillirait-on, si ce n’est du plus parfait des sentiments éprouvés par la raison et par le temps ?…
À quelques pas de là, nous fûmes arrêtés au détour d’une rue étroite par le concours d’une autre multitude qui suivait la noce de Coll Seashop, le maître du calfat, et de Folly Girlfree, la plus jolie mantua-maker de Greenock ; et mon âme se dégagea du seul poids qui l’oppressait. Je jetai cependant un regard sur la mariée, et je la trouvai bien jolie !…
— N’as-tu point d’émotion que tu me caches ? me dit la Fée aux Miettes un peu troublée.
— Aucune, ma bonne amie, repris-je avec transport. Coll est un habile, un honnête ouvrier, et je me réjouissais de penser que cette belle et tendre Folly pourrait être heureuse !
— Vraiment j’y compte bien aussi ! répondit la Fée aux Miettes.
XX.
Ce que c’était que la maison de la Fée aux Miettes, et la topographie poétique de son parc, dans le goût des jardins d’Aristonoüs de M. de Fénelon.
Nous arrivâmes enfin à l’endroit des murs extérieurs de l’arsenal où devait être appuyée cette maisonnette dont la Fée aux Miettes me parlait quelques années auparavant. Je l’avais souvent cherchée depuis sans la découvrir, et je ne fus pas surpris qu’elle m’eût échappé jusque-là, quand la Fée aux Miettes me la montra dans un recoin fort caché, en la touchant du bout de sa baguette. Je restai un moment stupéfait, et je retins mes pensées suspendues à mes lèvres dans la crainte d’humilier cette respectable femme par une observation inconvenante ; ce qu’il y a de plus bas au monde, c’est de mortifier la pauvreté ; mais c’est le comble de l’ingratitude et de la noirceur, quand la pauvreté nous donne un abri.
Je ne vous ai pas encore dit la cause de mon embarras. Vous avez infailliblement vu, monsieur, dans les jouets des enfants, et vous vous souvenez peut-être, car c’est la dernière chose qu’on oublie, d’avoir possédé parmi les vôtres une jolie petite maison de carton verni, aux murs de couleur d’ocre badigeonnés en perfection à la laque et au bleu de Prusse, avec ses trois croisées immobiles, sa ferblanterie en papier d’argent, son toit où l’ardoise s’est arrondie en écailles sous un pinceau naïf qui se ferait scrupule de prêter à l’illusion par quelque artifice imposteur. Vous l’avez vu, cet édifice innocent qui n’a rien coûté aux veilles de l’architecte, aux fatigues du maçon et du charpentier, avec son modeste jardin composé de six arbres que l’artiste expéditif a taillés à côté de l’allumette, et dont la cime, insensible aux vicissitudes des saisons, se couronne de feuilles découpées en taffetas vert. Telle me parut au premier regard la maison de la Fée aux Miettes, et telle vous la trouveriez encore si la direction ou le hasard de vos voyages vous conduisait un jour à Greenock. Il me devint impossible de contenir mon étonnement.
— Par le ciel, Fée aux Miettes, m’écriai-je, vous êtes-vous jamais mis dans l’esprit que nous puissions entrer là-dedans ? Le nain jaune lui-même, sur l’existence duquel les critiques ne sont pas d’accord, n’y trouverait où loger !
— Tu t’étonnes de tout, reprit gaiement la Fée aux Miettes, et c’est une mauvaise disposition pour vivre dans ce monde de l’imagination et du sentiment, qui est le seul où les âmes comme la tienne puissent respirer à leur aise. Laisse-toi conduire, car il n’y a que deux choses qui servent au bonheur : c’est de croire et d’aimer.
En même temps, elle me saisit par la main, se baissa sur la porte d’entrée, et m’introduisit dans une pièce élégante et spacieuse qui excédait mille fois les bornes dans lesquelles ma première conjecture avait circonscrit notre domicile. Je la parcourus rapidement du regard, et je vis qu’elle ne contenait qu’un lit.
La Fée aux Miettes pénétra dans ma pensée, elle en avait l’habitude, et poussant du doigt le ressort d’une porte qui suivait, elle me montra sa chambre à coucher, qui n’était ni moins commode, ni moins jolie que la mienne. Je ne revenais pas de ma surprise.
— Comme j’avais compté sur ta parole, dit-elle en rentrant, et que je ne voulais pas t’engager dans un établissement peu sortable pour ton âge, sans t’y procurer au moins les dédommagements de l’étude et les plaisirs de l’esprit, je te disposais ici de mes petites épargnes une bibliothèque à ton goût. Si je ne me suis trompée sur les auteurs qui charmaient tes premières études, je crois que tous tes amis y seront. – Et d’un nouveau mouvement, elle m’ouvrait un cabinet de quelques pieds carrés où mes livres favoris rayonnaient de maroquin et d’or sur de gracieuses tablettes.
— Attends, reprit-elle en faisant rouler sur ses gonds une troisième porte de bois de cyprès, voici tes outils de charpentier, d’un travail un peu plus soigné que ceux dont tu te sers aux chantiers de maître Finewood, et sur les gradins qui les surmontent un assez bon assortiment d’instruments de mathématiques. S’ils deviennent insuffisants à mesure que tu te perfectionnes dans tes connaissances, nous serons en mesure d’y pourvoir, car les soixante louis que je te devais ont heureusement prospéré dans mes mains. – Ne m’interromps pas, continua-t-elle avec un sourire, par tes exclamations d’enfant à qui tout semble nouveau. Ce qui devait te surprendre, pauvre Michel, c’étaient les épreuves de l’innocence malheureuse, et tu les as subies sans murmure. Accoutume-toi aussi sans efforts à un sort humble et doux, qui ne changera désormais pour toi que le jour où tu le voudras, mais dont tu resteras toujours le maître. Il y a de certains esprits, et je ne te confonds pas avec eux, pour qui la continuité d’un bien-être médiocre devient en peu de temps plus intolérable que les chances orageuses de l’ambition et de l’adversité. Si tu sais te contenter dans ton état, et te réjouir dans ton ouvrage, tu auras atteint à la suprême sagesse, et tu pourras te passer de moi, qui ne dois pas te rester longtemps, à en juger par la longue mesure d’années que j’ai déjà remplie. – Tu t’attendris, mon ami, tu pleures, tu m’aimes donc !…
— Ah ! Fée aux Miettes, qui pourrais-je aimer sur la terre, si ce n’est l’être généreux qui me comble de tant de bienfaits !…
— Ce mot est de trop entre nous, dit-elle d’un son de voix attendri ; mais puisque tu n’as pas craint de blesser les sentiments les plus délicats de mon cœur, j’épuiserai avec toi sans retard la seule conversation triste que nous devions avoir de notre vie. L’idée qu’à vingt et un ans tu t’es formée du mariage a dû te faire comprendre un autre bonheur que celui qui t’est promis par notre union. Je le sens, et tu me démentirais en vain, parce que je lis dans ton âme tout aussi avant que toi-même. Conserve-toi pur pour ce bonheur que je te prépare peut-être ; au moins es-tu en droit de l’attendre de ma prévoyance qui ne s’est occupée que de toi depuis ton berceau. Aime ces traits de mon jeune âge, aime ce portrait, le seul charme qui me soit resté pour te plaire, et ne t’inquiète pas du reste de tes obligations envers moi. Oublie jusqu’aux fougues de ma vieillesse encore trop jeunette qui s’éprit follement d’un joli enfant dans les écoles de Granville. Mon affection pour toi est plus vive que l’affection d’une mère, mais elle en a la chasteté. Des raisons que tu connaîtras avant peu ont amorti dans mon sein la dernière étincelle des passions que tu y avais rallumées, et s’il m’en reste un désir, c’est que tu conçoives un jour quelque bonheur à posséder l’âme de la Fée aux Miettes sous les traits de Belkiss ; la nature est si variée dans ses caprices que cela peut se rencontrer.
J’allais tomber à ses genoux ; elle me soutint, en enlevant aussi une larme de ses yeux, du bord de sa longue manchette : — Viens, viens, dit-elle ! tu me faisais perdre de vue quelques ordres que j’ai à donner pour notre repas de noces, quoique nous devions le faire tête à tête, comme il convient à notre condition. En attendant, continua-t-elle en soulevant une portière de soie, promène-toi dans notre petit jardin. Il n’est pas fort étendu, ainsi que tu as pu en juger du dehors, mais il est si adroitement distribué que tu t’y promènerais tout un jour sans repasser au même endroit !
La portière retomba sur moi, et je m’engageai en rêvant dans le jardin de la Fée aux Miettes ; j’étais si préoccupé que je marchai longtemps en effet sans prendre garde aux objets qui m’entouraient ; mais les sentiers se multiplièrent à tel point sur mon passage que je commençai à concevoir tout de bon la crainte de m’égarer, et que je cherchai à me faire, pour l’avenir, une idée plus distincte des localités. Ce qui m’y frappa d’abord, ce fut la douceur de la température et l’éclat du ciel, dont je n’avais jamais joui avec autant de délices à Greenock, même dans les journées les plus pures de l’été, car ce climat est froid, et le soleil n’y brille de quelque splendeur que pendant un petit nombre de semaines ; mais un phénomène encore plus nouveau pour moi vint me faire oublier celui-là : je ne sais par quel heureux artifice, dont la Fée aux Miettes devait sans doute le secret à sa longue expérience de toutes les sciences humaines, elle était parvenue à naturaliser dans ce jardin enchanté les plus rares merveilles de la végétation des tropiques et de l’Orient. C’étaient des lauriers-roses aux cymbales lavées d’un frais vermillon, des grenadiers chargés de bouquets de pourpre, des orangers dont les branches pliaient sous le poids de leurs fleurs d’argent et de leurs fruits d’or, des aloès dont la tige élancée comme un mât gracieux balançait à son sommet une riche couronne de girandoles, des palmiers dont la cime se déployait au souffle d’un vent parfumé comme un éventail de verdure. Entre les groupes de ces arbres élégants et de mille autres espèces que je connaissais à peine par leurs noms, coulait sous le dais échevelé des saules de Babylone une multitude de jolis ruisseaux dont les rives étaient toutes brodées des plus riantes fleurettes de la nature. Ne vous imaginez pas que le sable sur lequel ils glissaient à leur pente en cascade argentée fût emprunté à la blanche arène, formée de petits cailloux choisis, qui sert de lit de repos aux nymphes. Ce n’étaient ni plus ni moins, je vous jure, que des opales à l’œil de feu, des améthystes limpides comme le ciel, et des escarboucles rayonnantes comme celles qui avaient entouré le portrait de Belkiss ; et je sentis alors pourquoi la Fée aux Miettes y attachait si peu d’importance ; mais il est tout naturel qu’on ne parvienne pas communément à cette idée, avant d’avoir parcouru les jardins de la Fée aux Miettes.
Permettez-moi de ne pas oublier un genre de ravissement moins familier à la plupart des hommes, et que l’habitude de mes premiers goûts et de mes premiers plaisirs me rendait peut-être plus sensible que les autres. L’attrait de ce perpétuel printemps avait fixé dans les jardins de la Fée aux Miettes les plus élégantes et les plus aimables des créatures auxquelles Dieu n’a pas encore daigné donner une âme, les magnifiques papillons qui peuplent les solitudes et qui caressent les fleurs des deux mondes. Je les connaissais presque tous par les descriptions que j’en avais lues bien jeune, ou par les images que les peintres en ont faites ; mais je les voyais pour la première fois se croiser, s’éviter, se poursuivre, planer, tournoyer dans l’air, frémir en bourdonnant ou s’enfuir à peine visibles, sur des ailes fraîches et vivantes, et rivaliser d’éclat avec les corolles en coupes, en cloches, en bassinets, en cornets, en roses, en étoiles, en soleils qui pendaient, vermeilles, de tous les rameaux. Divine munificence de la création ! Sublime enchantement des yeux ! Spectacle digne d’embellir les rêves d’un homme de bien qui s’est endormi sur une bonne pensée !
J’y aurais passé une journée entière sans distraction et sans souvenirs, si la voix de la Fée aux Miettes ne m’avait appelé à notre petit festin ; et je ne m’attendais guère à me retrouver si près de notre maison. Comme la bonne vieille m’éclairait de la porte avec un flambeau, je m’aperçus que le jour était tout-à-fait baissé, et que mon imagination s’était entretenue longtemps dans des impressions délicieuses qui ne pouvaient plus lui être transmises par mes sens.
Je rentrai. Près d’une petite table servie simplement, mais avec une appétissante propreté, flamboyait un feu vif et pur, parce que, selon la Fée aux Miettes, la soirée s’était refroidie.
— Que dites-vous, du froid, ma bonne amie, m’écriai-je en revenant à moi ? Jamais le printemps n’a eu de plus douce chaleur et l’été plus de grâces ?
— Oh ! répondit-elle, dans mon jardin on ne s’aperçoit de rien, quand on est amant ou poète !
La Fée aux Miettes ne m’avait jamais laissé exprimer sans l’éclaircir un doute léger dont la solution pût être utile à mon instruction ou à mon bonheur ; et cependant, depuis notre dernière rencontre, elle avait affecté plusieurs fois de se défendre de mes étonnements, et de se dérober à mes questions.
— Voilà qui est bien, dis-je en moi-même. Ce vain besoin de tout savoir et de tout expliquer qui me tourmente ne serait-il pas une marque de la faiblesse de notre intelligence et de la vanité de nos ambitions, le seul motif peut-être qui nous empêche de goûter sur terre la part légitime de félicité qui nous y est dispensée ? Que m’importent les causes et les motifs du bien dont je ressens les effets, et de quel droit irais-je m’en informer avec une sotte et orgueilleuse curiosité, quand tout m’avertit que je suis né pour jouir de ma vie et de mon imagination, et pour en ignorer le mystère ? Funeste instinct qui ouvrit à Ève les portes de la mort, à Pandore la boîte où dormiraient encore toutes les misères de l’humanité, et à je ne sais quelle noble châtelaine, dont j’ai oublié le nom, le cabinet sanglant de la Barbe Bleue ! Ce que je ne sais pas, si j’avais intérêt à le savoir, la Fée aux Miettes qui le sait me l’aurait dit. C’est pour cela que mes interrogatoires l’affligent, moins parce qu’elle craint d’y voir percer l’apparence d’une défiance injurieuse, que du regret de s’y confirmer dans l’idée qu’elle commence à se faire de l’insuffisance et de la légèreté de mon esprit.
Et depuis ce moment-là je n’interrogeai presque plus. Je pris ma vie comme elle était.
XXI.
Dans lequel on lira tout ce qui a été écrit de plus raisonnable jusqu’à nos jours, sur la manière de se donner du bon temps avec cent mille guinées de rente, et même davantage.
Ah ! la conversation de la Fée aux Miettes avait des agréments si puissants que vous ne vous seriez jamais lassé de l’écouter ! Je remarquais seulement avec une sorte d’inquiétude que ses paroles, ses gestes, ses attitudes, avaient perdu cette vivacité folâtre et quelquefois bouffonne dont je m’étais si souvent réjoui au collège. Elle n’était devenue cependant ni sérieuse ni sévère, et la douce gravité de ses discours n’ôtait rien à leur aimable aménité, mais elle affectait de donner à nos entretiens un tour plus solennel et une direction plus élevée que dans les jours mémorables de la pêche aux coques et du naufrage sur les côtes d’Angleterre. Je supposai qu’elle croyait devoir cette réserve à la dignité de notre fête nuptiale, ou bien que l’âge de réflexion dans lequel j’étais entré ce jour-là imposait de lui-même une nouvelle forme à ses sages enseignements. Je cherchai en moi si notre vie morale ne se partageait pas, effectivement, entre les riantes déceptions de l’enfance, et les convictions austères que l’expérience apporte un jour à l’enfant qui s’est fait homme, et je me demandai si mon apprentissage était tout à fait fini.
J’en doutais, parce que les vicissitudes de ma jeunesse n’avaient pas été assez nombreuses et assez variées pour me fournir l’occasion d’embrasser sous tous les aspects toutes les chances d’une existence complète. Je regrettais de n’avoir éprouvé ni assez de malheurs, ni surtout assez de prospérité, pour être sûr de ma résolution dans tous les événements de la vie. Ce que je savais, c’est que le principal devoir qui me restât sur la terre, c’était de faire le bonheur de la Fée aux Miettes. Ce que je ne savais pas, c’est ce que je pouvais au bonheur de la Fée aux Miettes, mais mon cœur se serait brisé de l’idée qu’elle n’était pas heureuse.
J’ignore si elle me devina, mais elle me tira de ma préoccupation par un grand éclat de rire, et ses yeux vifs et brillants se fixèrent en même temps sur moi, humectés de ces larmes intérieures qui ne débordent pas la paupière, avec une si délicieuse expression d’attendrissement, de commisération et d’amour, que je ne pus résister au besoin de saisir sa jolie petite main d’un côté de la table à l’autre, et d’y imprimer un baiser.
Au même instant, un faible grondement, fort expressif et fort chromatique, se fit entendre à la porte.
— Ah ! vraiment ! dit la Fée aux Miettes, en s’élançant pour ouvrir avec son indevançable prestesse, je crois connaître cette voix harmonieuse, et je suis bien trompée si ce n’est pas l’élégant Master Blatt, le premier écuyer de notre ami sir Jap Muzzleburn !
C’était Master Blatt en effet, c’est-à-dire un barbet noir des plus propres et des plus mignons que l’on puisse imaginer, au poil frisé par larges anneaux comme s’il avait été tourné par le fer d’un perruquier fashionable, aux bottines de maroquin jaune frappées d’un gland d’or flottant, et aux gants de buffle à la Crispin.
C’était Master Blatt lui-même, qui entrait en s’éventant avec une grâce infinie de sa toque empanachée.
Comme c’était à ma femme que s’adressait la commission de Master Blatt, et qu’il aboyait son petit discours dans cette langue canine de l’île de Man à laquelle je n’étais légèrement initié que depuis la veille, je n’essayai pas de le suivre dans les développements de sa harangue. Cela m’aurait été difficile à la vérité, parce qu’il en précipitait le débit avec une si surprenante vélocité que jamais ni tironien ni sténographe ne l’eût rattrapé à la course, et qu’il avait d’ailleurs un peu d’accent.
Quand il eut fini de parler, Master Blatt ramena devant lui sa patte droite qu’il avait laissée jusque-là reposer sur sa hanche d’une manière pleine de dignité, et remit aux mains de la Fée aux Miettes un portefeuille dont la forme, la couleur, la dimension, le signalement tout entier était bien présent à ma mémoire ; le portefeuille de l’île de Man, que j’avais défendu de si grands hasards, et qui faillit me coûter si cher.
Ensuite il s’inclina profondément devant elle, me salua d’une manière plus grave, et se retira peu à peu sans se détourner, comme un chien diplomate qui est accoutumé aux grandes affaires, et qui connaît le cérémonial d’une ambassade.
— Bien, bien, bien, dit la Fée aux Miettes, en se renversant sur sa chaise longue avec une expansion de gaieté qui me charmait. – Tes cruels malheurs d’une nuit nous auront, du moins, comme tu le vois, servi à quelque chose !
— Je vous jure, Fée aux Miettes, lui répondis-je, que je n’en sais pas un mot !…
— Cher enfant, tu as raison, reprit-elle, et pardonne-moi ma distraction. Il faut que je t’explique cela. Ta triste aventure m’avait rappelé que l’île de Man appartenait de temps immémorial à une branche de ma famille dont l’héritage me revenait de droit, par le fâcheux bénéfice d’une longue vie, et je t’avouerai que j’attachais peu d’importance à cette propriété, à cause du caractère maussade et hargneux des habitants ; mais l’occasion me détermina, et comme j’étais sûre d’arriver assez à temps pour t’empêcher d’être pendu, je m’avisai d’expédier en passant mon homme d’affaires au bailli pour faire reconnaître mes titres. Ils étaient si authentiques et si clairs, que l’honnête sir Jap n’a pas hésité un moment à remettre à ma disposition les revenus de l’année, c’est-à-dire cent mille livres sterling de bon papier, continua-t-elle tout en feuilletant les traites et les billets, cent mille bonnes guinées que tu as tirées des griffes des voleurs.
Et là-dessus la Fée aux Miettes se reprit à rire d’aussi bon cœur qu’autrefois.
Je penchai ma tête sur ses mains, et je restai quelque temps sans répondre.
— Cent mille guinées, Fée aux Miettes, dis-je enfin ! Cent mille guinées de revenu ! – Oh ! Si vous aviez eu cette fortune quand vous veniez racheter ma vie au pied de l’échafaud, je n’y aurais pas consenti ! une si riche héritière que la Fée aux Miettes ne peut pas être la femme d’un ouvrier sans ressources et sans espérances !
La Fée aux Miettes me regarda d’un air chagrin et se mordit les lèvres. — Tu n’as point dit cela, Michel, dans l’intention de me blesser, répondit-elle avec un son de voix ému, et j’oublierai ce qu’il pourrait y avoir d’amer dans cette observation, si tu avais voulu en faire un reproche. Non, non, le généreux enfant qui m’a donné trois fois en sa vie tout ce qu’il possédait, et qui m’a engagé jusqu’à sa liberté pour me forcer à recevoir ses bienfaits, ne m’accuse pas dans son cœur d’avoir manqué aux lois de la délicatesse quand j’ai consenti à lui tout devoir. C’est cependant ce qu’il ferait en hésitant à recevoir de moi cent fois moins qu’il ne me sacrifiait, en effet, quand il se dépouillait en ma faveur des derniers débris de sa fortune. Mais ceci même lui appartient, car je ne me serais jamais avisée de réclamer mes droits sur une propriété inutile et oubliée, sans l’événement presque miraculeux qui t’a mis en possession de ce portefeuille comme d’une propriété légitime. Il faut bien t’apprendre du reste, continua-t-elle en reprenant une complète assurance, que tes richesses n’ont rien à envier aux miennes, et qu’elles les égalent si elles ne les excèdent pas. Encore n’est-ce pas de tes espérances sur les biens de ton père et de ton oncle que j’entends parler, quoique les nouvelles qui m’en arrivent depuis longtemps me fassent concevoir une grande idée de la prospérité de leurs entreprises et de la magnificence de leurs établissements.
— Ils vivent tous les deux ! m’écriai-je en pleurant de joie. Dieu soit loué à jamais !
— Dieu soit loué en toutes choses, dit la Fée aux Miettes. Ils vivent, et tu les reverras avant peu si mes projets s’accomplissent. En attendant, rien ne manque à ton opulence, puisqu’ils m’ont autorisée à fournir à tous tes besoins aussitôt que je t’aurais retrouvé, et que le seul produit de l’or dont tu m’avais si charitablement confié le dépôt passe déjà d’ailleurs, si je ne me trompe, la portée de tous les vœux que tu peux former en ta vie. Il me suffira de te prévenir aujourd’hui que je l’ai placé dans un commerce qui doit rapporter cent mille pour un à chaque voyage du grand vaisseau sur lequel tu te proposais de t’embarquer hier, et qui mouillera toutes les semaines à Greenock. Tu vois par là que tu seras en peu de jours le plus riche de nous deux, car je n’ai aucune raison pour suivre les mêmes chances, et la possession d’un or superflu ne tente pas mon ambition.
Je ne m’arrêtai pas d’abord aux sages paroles qui terminaient ce discours singulier ; l’idée de cette fortune immense et inattendue que je n’avais jamais rêvée, même dans le sommeil, exerça sur mon esprit une espèce de fascination et d’étourdissement où ma raison cherchait en vain à se retrouver. Plus je m’efforçais de rattacher le fil de ma pensée à quelques-unes des combinaisons d’existence que je m’étais composées jusque-là, plus je me trouvais étranger à mon avenir, et incapable de m’y placer d’une manière assortie à mon organisation et à mon caractère. Je finis par penser tout haut. — En vérité, repris-je en balbutiant des mots confus comme mes réflexions, de semblables événements doivent nécessairement changer la position que nous tenons dans la société. Je m’en félicite pour vous, Fée aux Miettes, qu’ils appellent à jouir d’une destinée digne de votre naissance et de votre sagesse ; mais pour moi, je m’en étonne, et je ne me prépare pas sans un mélange d’inquiétude à cet état de splendeur où la Providence m’a tout d’un coup élevé. C’est à vous, qui avez acquis dans votre jeunesse l’expérience de la richesse et des grandeurs, à m’apprendre ce que nous devons faire de nos trésors, pour montrer à tout le monde que nous méritons de les posséder.
— Ceci est une grande question, mais j’essayerai de l’éclaircir puisque tu le veux, répondit la Fée aux Miettes en souriant assez tristement, autant que je pus m’en apercevoir, car j’osais à peine tourner mes regards sur elle. Il y a effectivement bien des partis différents à tirer d’une grande fortune, et je ne dois pas te le dissimuler, plus de pernicieux que d’utiles. La plupart des hommes regardent cet avantage inopiné du hasard comme une raison de se livrer doucement à l’oisiveté, de jouir des voluptés du luxe dans une tranquille paix, et d’étaler aux yeux de la multitude un faste qui lui impose, parce qu’elle estime les plaisirs qui y sont attachés au-dessus de toutes les faveurs de la nature. Si cette condition te convient, tu es maître de la choisir. Tu auras demain des palais somptueux, des ameublements exquis, des voitures éblouissantes de dorures et attelées de superbes chevaux pour te transporter à travers tes vastes domaines ; les artistes s’empresseront de te consacrer leurs travaux, les poètes feront des vers à ta gloire, les grands t’accoutumeront par leurs prévenances à te regarder comme leur égal, et tu ne pourras plus compter tes amis. Enfin tu goûteras pour la première fois les charmes d’une mollesse tout à fait inoccupée, et le profond contentement d’âme que procure la certitude de n’avoir rien à faire.
— Rien à faire, Fée aux Miettes ! Ah ! ce n’est pas dans cette pensée que peut résider un profond contentement de l’âme ! Le Dieu qui a daigné me former ne m’a pas donné ces bras robustes et habiles au travail pour que je les laisse indignement languir dans une lâche inaction. Et s’il lui plaisait un jour de me retirer ces faveurs dont il me comble aujourd’hui, que deviendrais-je après avoir oublié l’exercice de mon métier, et l’agréable habitude de ces labeurs de tous les jours qui m’occupent, qui me fortifient, qui me plaisent, qui m’ont fait quelquefois honneur et ne m’ont jamais ennuyé ? Un objet de mépris pour les honnêtes gens et de pitié pour les sages ! J’aimerais cent fois mieux me désaccoutumer de l’espérance d’être riche, et l’effort ne serait pas grand. Il n’y a pas si longtemps qu’elle m’est venue !
— À merveille, mon cher Michel ! s’écria joyeusement la Fée aux Miettes, en frappant d’aise ses blanches mains l’une contre l’autre. Ajoute à cela que le changement de ta manière de vivre ne ferait illusion qu’à toi, si tu étais assez stupide pour tomber dans un pareil aveuglement. Tu aurais beau te cacher dans ton faste comme le ver dans son cocon de soie, et la chenille dans sa chrysalide dorée, ceux qui t’ont connu te reconnaîtraient, et l’envie qu’inspirerait ton agrandissement subit ne tarderait pas à se convertir en haine secrète sous de fausses apparences, au fond du cœur de tes flatteurs les plus assidus. – « À qui appartient, dirait-on, ce carrosse aux panneaux resplendissants qui fait voler si haut la poussière sous ses roues ferrées d’argent ?… — Eh quoi, répondraient les passants avec un dédaigneux mouvement d’épaules, ne le savez-vous pas encore ? C’est un des trois ou quatre cents équipages, car il en change tous les jours, dans lesquels le petit charpentier Michel promène cette vieille naine dentue, difforme et ridicule, que tout Granville a vue mendier pendant cent ans sous le porche de son église. Ne voilà-t-il pas un beau couple pour écraser le pauvre peuple, et n’a-t-on pas raison de dire qu’il n’est telle vanité que de petites gens ? » Tu n’aurais fait à ce compte qu’abdiquer la modeste réputation d’un honorable ouvrier pour gagner celle d’un sot riche, et c’est le souvenir le plus fâcheux qu’on puisse laisser sur la terre après celui que laissent les méchants. – Mais si la fortune ne sert qu’à rendre plus sensibles l’abrutissement des voluptueux et l’incapacité des oisifs, elle peut prêter un relief éclatant aux qualités de l’esprit et aux glorieuses ambitions du génie. Tous les travaux de l’homme en société ne se réduisent pas aux œuvres matérielles de la main. Il influe par son crédit et par son habileté sur les développements de la richesse et de la prospérité publiques. Il prend part à la création des lois et à l’administration des états. Il tient les balances de la justice dans les tribunaux ou les rênes du gouvernement dans le conseil des rois ; et pour arriver aux grands emplois, l’or est dans tous les pays la première de toutes les aptitudes. Pauvre, ton savoir et ton éducation ne te promettaient qu’un petit nombre de succès obscurs qui n’auraient jamais tiré ton nom de l’oubli ; opulent, il n’est point de carrière qui ne te soit largement ouverte, et au bout de laquelle tu n’aies à recueillir, vivant, les faveurs de la popularité, mort, les illustrations de l’histoire. La banque de Jonathas restera bientôt sans chef, au régime sordide que son avarice lui a fait adopter. Le président de justice est, depuis dix ans, fou de sottise et d’orgueil, et on n’attend qu’à le prendre sur quelque fausse application des lois qui aura coûté la vie à un bon nombre d’innocents notables, pour lui donner un successeur. Il y a des députés à élire et des ministres à disgracier. Choisis.
Je regardai fixement cette fois la Fée aux Miettes, et je trouvai ses yeux arrêtés sur moi. Cette circonstance, qui m’aurait intimidé un moment auparavant, augmenta ma hardiesse et me confirma dans la détermination que j’avais prise pendant qu’elle parlait, car toutes mes irrésolutions s’étaient dissipées.
— Mon choix est fait, lui répondis-je, et mon seul regret est d’avoir pu hésiter ; je resterai charpentier.
Elle contint sa joie, mais elle ne réussit pas à me la dérober tout à fait. Je continuai.
— Écoutez, Fée aux Miettes, et pardonnez-moi si je conteste une seule fois avec vous. Mes études ne m’ont pas rendu propre aux emplois que vous me proposez, et je suis trop sensé, grâce à Dieu, grâce aux leçons de mes parents, grâce aux vôtres, pour mettre le sort d’un pays en balance avec mon orgueil. Je ne cède pas en vous disant ceci aux timidités de la modestie. J’imagine au contraire que je n’ai jamais conçu pour moi-même une plus haute estime qu’en me rendant compte des idées où cet entretien nous entraîne, et s’il est vrai que la vanité se mêle à tous nos jugements, elle pourrait bien jouer son rôle dans mon refus. Je crois sincèrement que je pourrais apporter comme un autre le tribut de mes facultés à l’œuvre de tous, si la civilisation était, comme je la comprends, une doctrine de foi, une législation d’amour et de charité, une pratique de bienveillance réciproque et universelle ; mais dans l’état où les siècles nous l’ont donnée, je n’ai ni intelligence pour l’expliquer, ni disposition à la servir. Je respecte les pouvoirs que les nations s’imposent ; je me range sans examen aux lois qu’elles reconnaissent ; j’honore les esprits sublimes qui croient y entendre quelque chose, et les citoyens généreux et dévoués qui consacrent leur noble existence au soin de les interpréter et de les défendre, mais c’est tout ce que je puis. L’opinion que nous nous formons de l’importance de notre destination passagère est sans doute flatteuse pour notre amour-propre. Elle est surtout consolante pour notre misère, et je ne trouve pas mauvais qu’on s’efforce d’en atteindre les résultats. Quant à moi, je ne les cherche pas sur la terre, et cette vie si occupée de perfectionnements ne me montre en réalité que de vaines agitations qui aboutissent à la mort pour les peuples comme pour l’homme. L’affaire de la vie, c’est de vivre et d’espérer, car elle ne bâtit rien de durable et d’infaillible que le tombeau. Si le travail des mains a moins d’éclat et de grandeur que celui de la pensée, et j’y consens avec vous, il est donc à mon sens plus raisonnable et plus utile ; et j’aurais peine à m’ôter de l’esprit que tout homme qui a planté un arbre, ensemencé un guéret, ou construit une maison solide, aérée, spacieuse et bien distribuée, a rendu un service plus essentiel à ses semblables que les économistes, les philosophes et les hommes d’état avec leurs utopies de vieux enfants, si malheureuses en pratique. Voilà pourquoi je resterai décidément charpentier, si vous l’avez pour agréable, ma volonté vous étant d’ailleurs soumise en tout point. – Mais ce que je vous demandais, Fée aux Miettes, ce n’est pas non plus comment un usage absurde de la fortune peut couvrir celui qu’elle possède, et qui croit la posséder, de ridicule et de honte. Ce n’est pas comment, dans une société que je plains et que je suis près de mépriser, les habiles parviennent à faire servir la fortune aux triomphes de cette folle passion de pouvoir et de renommée que vous appelez en vous jouant une ambition glorieuse, et qui ne me tente guère. C’est à quoi elle est bonne pour être heureux, si elle est du moins bonne à cela, et je commence à craindre qu’il n’en soit rien.
— Il faudrait d’abord savoir ce que tu entends par le bonheur, répliqua la Fée aux Miettes.
— Ma foi, ma bonne amie, repris-je gaiement, je n’y ai jamais beaucoup réfléchi, mais je suis presque sûr que le mien ne peut pas se réaliser en barres et en billets. Le bonheur, c’est d’être le premier dans le cœur de ce qu’on aime. Le bonheur, c’est de faire du bien selon sa puissance, quand l’occasion s’en présente. Le bonheur, c’est de n’avoir rien à se reprocher. Le bonheur, c’est de se coucher en joie dans un lit propre et bien bordé, déjà content du travail de la semaine, et rêvant aux moyens de l’améliorer encore. Le bonheur, c’est de repasser dans sa mémoire les doux souvenirs d’un âge d’insouciance et de pureté, en suivant le cours de quelque rivière limpide, sur la lisière d’une prairie tout émaillée de fraisiers et de marguerites, aux rayons d’un soleil sans âpreté, à la chaleur d’un petit vent de sud chargé de parfums, et de s’arrêter à une jolie tonnelle de lilas où la Fée aux Miettes a préparé en m’attendant sous la feuillée une jatte de lait écumeux et frais, une corbeille de fruits mûrs, couverts de leur fleur veloutée, et un peu de vin généreux. Combien croyez-vous qu’il y ait de bonheur comme ceux-là dans cent mille guinées ?
— Il y en a plus que tu ne crois, répondit la Fée aux Miettes ; mais écoute plutôt ! Je suppose qu’il te souvient encore de tes premiers amis de collège ?
— Pourriez-vous en douter, Fée aux Miettes ? Je n’oublie aucun de mes sentiments, et les amitiés de collège ne s’oublient pas.
— Jacques Pellevey, continua-t-elle, n’a pas été aussi sage que toi. De curé qu’il était, il a voulu devenir évêque, et la calomnie irritée par son ambition lui a fait perdre jusqu’à sa cure. Le malheur a produit sur lui l’effet qu’il produit d’ordinaire sur les belles âmes ; il l’a rendu meilleur. Jacques, éclairé par ses fautes, s’est retiré dans un village où l’instruction n’avait jamais pénétré, pour y former gratuitement à la religion et aux bonnes études les enfants des pauvres familles ; son établissement a prospéré d’une manière si éclatante et si rapide qu’il ne regrette aujourd’hui que de ne pouvoir pas l’étendre à tous les villages voisins ; mais ton ami Jacques est pauvre lui-même, et il se consume dans les rêves de sa charité impuissante. Ne penses-tu pas qu’il serait bon d’envoyer un millier de guinées à Jacques Pellevey pour le seconder dans ses louables projets, dont j’ai la certitude qu’il ne sera maintenant détourné par aucun changement de fortune, car l’adversité agit sur le cœur de l’homme, comme certaines tempêtes sur les fruits de la terre. Elle hâte sa maturité.
— Mille guinées, c’est bien peu, dis-je à la Fée aux Miettes ; mais nous y reviendrons souvent.
— Didier Orry s’était richement marié, comme tu sais, mais la destinée a d’étranges retours. Son beau-père l’a engagé dans des spéculations aventureuses qui les ont ruinés tous les deux. Il ne lui restait plus qu’une maison assez modeste, et des grangeages médiocrement garnis que le feu du ciel a dévorés l’an passé. Il est allé frapper à ta porte avec deux enfants dans ses bras, et suivi de sa femme enceinte et malade. Quand la malheureuse famille fut instruite de ton départ, ils s’assirent tous sur le seuil et se prirent à pleurer, le père et la mère parce que tu étais leur seule espérance, et les enfants parce que leur père et leur mère pleuraient. Tous seraient morts de misère et de désespoir, si Jacques Pellevey, qui passait par là, ne les avait recueillis ; mais Jacques a déjà tant de charges qu’il ne suffit à celle-ci qu’en prenant sur ses propres besoins. Nous pourrions rétablir la fortune de Didier Orry, mais il nous en coûterait trop cher, parce qu’il a joui longtemps des douceurs de l’aisance, et que l’habitude est une seconde nature. C’est une affaire de huit mille guinées.
— Vous ne faites pas entrer dans votre compte, bonne amie, la compensation des maux qu’il a soufferts. Il faut lui en envoyer dix mille.
— Tu ne sais pas ce qu’est devenu Nabot ? Le pauvre diable a eu le malheur de recueillir de grands héritages, et tu devines aisément ce qu’il en a fait : le jeu a tout emporté. Ce qu’il y a de pis, c’est que son luxe éphémère lui avait donné du crédit, et que le jour où il s’aperçut qu’il ne lui restait rien, il devait beaucoup plus qu’il n’eût jamais possédé. Ses créanciers ont obtenu prise de corps contre lui, et je ne doute pas qu’il ne meure en prison si tu ne l’en tires. Cependant je ne te le recommanderais point, car c’est se rendre complice d’une honteuse frénésie que de lui prodiguer des secours qui sont dus à tant de respectables infortunes, si cette dernière épreuve ne l’avait décidément corrigé. Il a reconnu, dès le premier mois de sa captivité, que la privation n’était qu’un heureux apprentissage, et le vice qu’une mauvaise habitude. Il n’y retombera plus. Ses études mal ébauchées lui sont revenues en mémoire : il les a recommencées avec ce zèle amoureux qui rend les progrès si faciles. Tous les pas qu’il a faits dans cette nouvelle carrière ont été marqués par des jouissances qu’il met infiniment au-dessus de celles du monde, et son caractère, autrefois inquiet et soupçonneux, s’est ressenti du perfectionnement de son esprit. L’avantage le plus inappréciable du travail, et il en a beaucoup d’autres, c’est de distraire l’âme de ses passions sans lui rien enlever de son ardeur, mais en dirigeant ces puissances exaltées d’une intelligence et d’une sensibilité de jeune homme vers le seul but qui soit digne d’elles. J’ai lieu de croire que Nabot te ferait un jour honneur par sa conduite, s’il n’y avait pas tant à payer pour le délivrer de ses dettes. La Providence mesure les adversités qu’elle nous dispense. L’homme ne mesure pas celles qu’il se donne. J’ai entendu dire qu’il était écroué pour près de quatorze mille guinées.
— Sur quinze mille guinées, répondis-je, il lui en restera mille pour recommencer sa vie. C’est assez s’il est guéri, et surtout s’il ne l’est pas.
— Tes camarades les caboteurs avaient d’abord prospéré dans leur commerce, mais ils l’ont étendu imprudemment, et la Méditerranée leur a repris ce que l’Océan leur avait donné. Leur beau bâtiment la Mandragore, qui contenait en cargaison le produit de toutes leurs courses, a été capturé par des pirates barbaresques, et l’équipage entier est prisonnier en Alger. On n’estime pas à moins de douze mille guinées le prix de leur rançon.
— C’est racheter à trop bas prix, Fée aux Miettes, ces honnêtes et loyaux compagnons qui décimèrent leur faible pécule afin de me soulager dans ma détresse et de m’associer à leurs espérances. Douze mille guinées aux Algériens pour leur rendre la liberté ; douze mille guinées aux caboteurs pour recommencer leur trafic ! – Mais à quoi bon, je vous en prie, cette énumération dont j’aurais tout au plus besoin si je ne vous avais pas comprise ? Donnez, donnez, Fée aux Miettes ; versez de l’or aux mains de nos amis qui souffrent ; et puisque notre fortune, si exorbitante qu’elle soit, ne peut suffire à secourir toutes les misères, augmentez-la, pour donner encore, multipliez nos trésors pour multiplier vos bienfaits ; nous n’aurons jamais trop puisque nous ne gardons rien, et que ces biens immenses dont la toute puissante bonté nous a faits dépositaires pour les répandre ne seront pas payés, comme je le craignais, de notre repos, de notre indépendance et de notre obscurité. C’est ainsi seulement, vous venez de me l’apprendre, que l’oppulence peut contribuer au bonheur ; c’est ainsi que je conçois la possibilité de n’avoir pas quelque jour à regretter d’être riche.
— Tes intentions seront remplies en ce qui te concerne, reprit la Fée aux Miettes ; mais, ajouta-t-elle d’un air un peu composé, j’ai aussi de nombreux amis auxquels je dois aide et protection, et que je ne saurais favoriser de tes présents si tu ne m’y autorises, puisque je suis en puissance de mari. Ne conviendra-t-il pas que je t’en soumette la liste, comme à mon souverain seigneur et maître ?
— Eh vraiment non ! répartis-je vivement en rougissant de sa déférence. Tout ce qui nous appartient n’appartient qu’à vous, ma toute bonne, et vous pouvez en faire l’usage qui vous conviendra le mieux. Pourvu que le charpentier ait en poche une poignée de demi-schellings à distribuer de temps en temps aux pauvres beggars du port, ou tout au plus une guinée par semaine pour faire emplette de quelque bon auteur grec de Foulis ou de Balfour à la Classic Library du vieux Macdonald, il n’a rien à envier en richesse à tous les rois de la terre. Je me croirais bien réellement indigent, si j’éprouvais jamais la nécessité de posséder davantage.
— Je n’ai donc rien à désirer ! s’écria-t-elle. Me voilà en état de porter la prospérité dans cette multitude de chaumières où j’ai reçu l’aumône pendant tant d’années que j’ai mendié aux côtes de France ! Hélas ! Il n’y a que les pauvres gens qui donnent, parce que l’habitude du besoin leur a enseigné la pitié. – Et mes quatre-vingt-dix-neuf sœurs qui ont coutume de me visiter tous les ans, le lendemain de la Saint-Michel, quand j’habite ma maisonnette de Greenock, tu me laisses maîtresse, n’est-il pas vrai, de leur donner à chacune soixante guinées en commémoration de celles qui m’ont assuré de si beaux jours ? Cette douceur leur viendra fort à propos, et je les sais capables d’en tirer bon parti pour leur établissement, car elles rivalisent toutes entre elles d’esprit et de gentillesse.
— Je vous laisse maîtresse de tout, Fée aux Miettes, et je trouve seulement cette libéralité trop parcimonieuse pour un présent de noces ; mais comment se fait-il que vous ne m’ayez jamais parlé de votre nombreuse famille ?
— C’est qu’au temps de nos anciens entretiens, dit la Fée aux Miettes, et dans l’incertitude où j’étais de te fixer, je n’avais pas la force de m’occuper d’autre chose que de toi. –
Peu à peu notre conversation se ralentit, mais l’impression s’en prolongea en moi-même avec un charme inexprimable. J’éprouvai ce contentement de cœur, cette saine et pure allégresse de la pensée, cette satisfaction vague mais profonde, qu’on goûte sans la définir, et qui fait que l’on est bien sans savoir pourquoi. J’avais oublié le monde entier et ma propre existence avec lui, quand je sentis la Fée aux Miettes se suspendre à ma main et la presser contre sa bouche, en la mouillant de quelques larmes d’émotion et de saisissement.
— Sais-tu maintenant ce que c’est que le bonheur ? dit-elle.
— Oui, oui, je le sais ! le bonheur est de vivre près de la Fée aux Miettes, et d’en être aimé.
Et je m’élançai inutilement pour l’embrasser ; elle avait déjà disparu derrière la porte de son appartement, qui s’était fermée sur ses pas. Ma première idée fut de la suivre pour la voir encore un moment, mais cette porte était si bien sertie dans le panneau de la cloison qu’il me fut impossible d’en trouver les joints. C’était un merveilleux ouvrage.
Au bout d’un moment de méditation, et avant de m’abandonner au sommeil, je me mis en tête de savoir ce que Belkiss pensait de ma nouvelle position. La Fée aux Miettes ne m’avait pas seulement autorisé à regarder quelquefois son portrait, elle l’avait même exigé positivement. Je me hâtai donc de faire jouer le ressort du médaillon.
Belkiss dormait.
XXII.
Où l’on enseigne la seule manière honnête de passer la première nuit de ses noces avec une jeune et jolie femme, quand on vient d’en épouser une vieille, et beaucoup d’autres matières instructives et profitables.
Que cette nuit fut différente de celle qui l’avait précédée ! Le sommeil ne me retira pas ses prestiges ; mais de quelles riantes couleurs il avait chargé sa palette ! que d’agréables caprices, que de délicieuses fantaisies il jetait à plaisir sur la toile magique des songes ! À peine eut-il lié mes paupières que la décoration élégante, mais simple, de la maisonnette, fit place aux colonnades magnifiques d’un palais éclairé de mille flambeaux qui brûlaient dans des candélabres d’or, et dont l’éclat se multipliait mille fois dans le cristal des miroirs, sur le relief poli des marbres orientaux, ou à travers la limpide épaisseur de l’albâtre, de l’agate et de la porcelaine. Bientôt la lumière diminua par degrés, jusqu’à ne verser sur les objets indécis qu’un jour tendre et délicat, semblable à celui de l’aube quand les profils de l’horizon commencent à se découper sur son manteau rougissant. Je vis alors Belkiss, c’était elle, s’avancer modestement, enveloppée dans ses voiles comme une jeune mariée, et appuyer sur mon lit ses mains pudiques et son genou de lis, comme pour s’y introduire à mes côtés.
— Hélas ! Belkiss, m’écriai-je en la repoussant doucement, que faites-vous, et qui vous amène ici ? Je suis le mari de la Fée aux Miettes.
— Moi, je suis la Fée aux Miettes, répondit Belkiss en se précipitant dans mes bras.
Tout s’éteignit, et je ne me réveillai pas.
— La Fée aux Miettes ! repris-je en tressaillant d’un étrange frisson, car tout mon sang s’était réfugié à mon cœur. Belkiss est incapable de me tromper, et cependant je sens que vous êtes presque aussi grande que moi !
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle, c’est que je me déploie.
— Cette chevelure aux longs anneaux qui flotte sur vos épaules, Belkiss, la Fée aux Miettes ne l’a point !
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle, c’est que je ne la montre qu’à mon mari.
— Ces deux grandes dents de la Fée aux Miettes, Belkiss, je ne les retrouve pas entre vos lèvres fraîches et parfumées.
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle, c’est que c’est une parure de luxe qui ne convient qu’à la vieillesse.
— Ce trouble voluptueux, ces délices presque mortelles qui me saisissent auprès de vous, Belkiss, je ne les connaissais pas auprès de la Fée aux Miettes.
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle, c’est que la nuit tous les chats sont gris.
Je craignais, je l’avouerai, que cette illusion enchanteresse ne m’échappât trop vite, mais je ne la perdis pas un moment ; elle me fut fidèle au point de me faire penser que je m’endormais le front caché sous les longs cheveux de Belkiss ; et quand la cloche du chantier m’appela au travail, quand Belkiss s’enfuit de mes bras comme une ombre à travers les ténèbres mal éclaircies du matin, il me sembla que je sentais encore à mon réveil ma joue échauffée de la moiteur suave de son haleine.
— Belkiss ! criai-je en sortant à demi de mon lit pour la retenir.
— J’y suis, mon ami, répondit la Fée aux Miettes, et voilà ton déjeuner préparé.
Elle y était en effet, la bonne vieille, et je la vis, à la lueur de sa lampe, accroupie devant la bouilloire.
— Eh pourquoi, Fée aux Miettes, vous lever si grand matin ? ne puis-je me servir moi-même ?
— Tu n’en serais pas en peine, reprit-elle, mais je ne cède pas mes plaisirs, et celui de te rendre la vie facile et agréable est le plus doux qui reste à mon âge. Il ne m’en coûte rien d’ailleurs de me mettre avant le point du jour à ces petits soins du ménage. C’est ma coutume et mon goût, et ma santé s’en trouve mieux, surtout quand j’ai passé une bonne nuit. Mais à propos, Michel, comment as-tu dormi toi-même ?
— J’ose à peine vous le dire, ma chère amie, répliquai-je en balbutiant ; mes rêves ont été si délicieux que j’ai peur qu’ils ne soient coupables !
— Rassure-toi, digne Michel ; on n’en fait point d’autres dans ma maisonnette ; et ce qui ajoute à leur prix, c’est qu’ils se renouvelleront toutes les nuits tant que tu me seras fidèle. Tu peux donc t’y livrer sans scrupule aussi longtemps que tu me garderas l’amitié que tu m’as promise, et ne crains pas que j’en sois jalouse. Les miens valent bien les tiens.
Je partis après avoir imprimé un large baiser sur son front, et j’arrivai au chantier avant qu’aucun autre ouvrier fût en chemin pour s’y rendre. J’y avais été précédé par quelqu’un cependant, par maître Finewood, qui était là tristement assis sur une solive, et la tête appuyée sur ses mains, dans l’attitude d’un homme qui pleure. Averti par le bruit de mes pas, il se leva subitement, me reconnut et se jeta sur mon sein.
— Est-ce toi, Michel ? s’écria-t-il en me pressant à plusieurs reprises ; est-ce toi que la sainte Providence me renvoie pour le salut de ma maison, qui a été accablée de malheurs depuis ton départ ? car il me semble que tu étais pour nous comme un ange tutélaire du Seigneur. As-tu renoncé, mon garçon, à voyager avec ce mécréant de Libyen, qui promettait de te rendre à si bon marché aux terres inconnues ?
— J’ai été obligé d’y renoncer, mon cher maître, et je m’en félicite, puisque mon retour peut vous faire espérer des consolations dans le chagrin qui vous accable ; mais ne m’en apprendrez-vous pas la cause ?
— Hélas ! il le faut bien à ma honte, et je crois que cet aveu me soulagera. Tu sais que je mariais hier mes six filles à six jeunes lairds des rives de la Clyde, étourdis et débauchés, à ce qu’on m’a dit quelquefois depuis cet arrangement ; mais ce n’en était pas moins un grand honneur pour un simple maître charpentier. J’avais consacré à l’établissement de ces pauvres innocentes, qui me sont plus chères que ma propre vie, tout le produit de mes longues épargnes, trente mille guinées, Michel, qui m’ont coûté plus de coups de maillet et plus de traits de scie qu’il n’entrait de placks dans le trésor de cette reine de Saba dont je t’ai vu si entiché. Que te dirai-je, mon ami ? j’avais envoyé les six dots en six beaux sacs de marocco à mes six gendres futurs, qui s’étaient abstenus jusque-là de me visiter, et j’attendais patiemment, au déclin du soleil, comme un maladroit vieillard sans intelligence et sans esprit, l’arrivée de leurs seigneuries, pour conduire ma famille à cette cérémonie dont je faisais ma gloire et ma joie, quand on est venu m’apprendre qu’ils disparaissaient à pleines voiles avec mon argent sur un vaisseau de malédiction qui les porte au continent. J’en mourrais, j’imagine, si je n’espérais que le ciel s’est chargé de ma vengeance, et que les traîtres n’ont pas échappé à l’horrible tempête de cette nuit.
— Que dites-vous de tempête, maître Finewood ? je crois que le ciel n’a jamais été plus pur.
— À d’autres, Michel ! Vous avez le sommeil dur, mon garçon, si celle-là ne vous a pas réveillé ; mais n’auriez-vous point trouvé, par hasard, d’autres réflexions à faire sur le récit de ma cruelle infortune ?
— Pardonnez-moi, répondis-je, en lui prenant affectueusement la main et en la rapprochant de mon cœur ; je vous prie de croire à toute la joie que j’en ressens, et de recevoir mes félicitations.
— Dieu tout-puissant ! dit maître Finewood, il ne me manquait plus que cette douleur ! Vous ne me le ramenez, Seigneur, que pour me le prendre, et vous percez la main du pêcheur avec le dernier roseau sur lequel elle s’est appuyée ! – N’importe, pauvre Michel, je ne t’abandonnerai pas dans la misère de ton esprit faible et malade ; et tant qu’il restera un morceau de pain à gagner au chantier, je le romprai avec toi. Va travailler, mon fils, car j’ai remarqué que le travail te distrait des fantaisies qui t’offusquent, et rend le calme à ta raison troublée par de mauvais songes. Va travailler, Michel, et ne te fatigue pas !
— J’y vais, maître, j’y vais, repris-je en riant ; mais ne refusez pas d’écouter quelques mots encore. Je comprends que mes paroles ne vous paraissent pas sensées, et je serais fort étonné du contraire. C’est pourtant dans la sincérité de mon âme que je vous félicitais tout à l’heure ; et si c’est là une énigme à vos yeux, comme je n’en doute pas, soyez sûr qu’elle ne tardera guère à se débrouiller. Oui, maître, je vous trouve très favorisé de la divine Providence d’être débarrassé, au prix de trente mille malheureuses guinées, de six aventuriers titrés qui auraient fait le malheur de vos filles et la honte de votre respectable maison. L’avantage que vous retirez de cet événement est incalculable, et la perte est si peu de chose que je me porterais garant qu’elle sera réparée en vingt-quatre heures. Je m’attendais bien à vous voir ainsi hocher la tête en signe d’incrédulité ; mais ce que je vous promets ne s’en exécutera pas moins. Il n’y a pas longtemps que les placks et les bawbies se convertissaient en guinées sous la main de la charité. Qui sait ce que peuvent devenir les guinées sous celle de la reconnaissance ? Maintenant, permettez-moi de vous parler avec une franchise que mon dévouement filial autorise, et qui n’a pas semblé vous déplaire dans d’autres occasions. Vous avez pris souvent un intérêt trop vif, et qui me touche beaucoup plus qu’il ne me mortifie, à ce que vous appeliez les aberrations de mon esprit. Eh bien, maître, je ne puis me contenir de vous déclarer qu’il est une action, une seule action à la vérité, mais une action capitale de votre noble vie qui enchérit mille fois sur toutes les lubies que l’on me reproche. La colombe des rochers ne s’allie point avec l’épervier des tourelles, et c’est un digne mari qu’un charpentier pour la fille d’un charpentier. Pourquoi n’avoir pas donné vos six filles en mariage au grand John d’Inverness ; à Dick le trapu, qui est si robuste à l’ouvrage ; au blondin Peterson, qui entend si bien le toisé des bâtiments ; à ce gros joufflu de Jack, qui rit toujours, et dont la seule figure vous réjouit quand il entre au chantier ; à ce pauvre Edwin, que sa douceur fait aimer de tout le monde, et qui a pris tant de soin de ses vieux parents ! Elles les aimaient, je le sais, et jamais gendres mieux assortis à leurs excellentes femmes ne pouvaient prendre place à votre banquet de famille, car ce sont des ouvriers aussi honnêtes qu’habiles, et ceux-là n’auraient fait banqueroute ni à votre fortune ni à votre honneur. N’est-ce pas pour vous un vrai motif de satisfaction, maître, que de pouvoir réparer aujourd’hui votre erreur et votre injustice, et que d’acheter de ces trente mille guinées, qui ne sont d’ailleurs pas perdues, les bénédictions perpétuelles de vos douze enfants heureux ?
— Assez, assez, dit maître Finewood en passant ses bras autour de mon cou. Non seulement je ne t’en veux pas, Michel, de m’avoir ouvert librement ton cœur, mais je t’en remercie, parce que tu ne m’as rien dit qui ne fût souverainement raisonnable, si ce n’est pourtant ce qui a rapport à mes trente mille guinées. Plût à Dieu que je les eusse encore, et que ton esprit, dégagé de ses étranges chimères, te permît d’épouser mon Annah, et de recevoir avec sa main la direction de toutes mes affaires ! J’ai remarqué que tu l’avais oubliée dans ton plan, auquel je souscris volontiers, et je tirerais un bon augure de ta retenue, si j’avais, comme hier, une dot pour elle à t’offrir.
— Ah ! maître Finewood, ne me faites pas l’injure de supposer que votre fortune puisse entrer pour quelque chose dans ma détermination ! J’aime Annah comme une sœur, et je crois que c’est comme un frère aussi qu’elle m’aime. Si Annah n’était pas aussi riche qu’elle le fut jamais, si Annah était plus pauvre encore que vous ne le pensez aujourd’hui, j’aurais au contraire une puissante raison de plus pour lier ma vie à la sienne ; mais j’ai cru m’apercevoir qu’elle éprouvait quelque penchant pour Patrick, le régisseur des chantiers, qui est un beau jeune homme de bonnes mœurs et de noble caractère, bien versé dans les lettres et dans les sciences. Patrick en est, de son côté, passionnément amoureux, et la sévérité seule de ses principes l’a empêché de vous la demander, car tout ce qu’il possède se réduit aux revenus de son petit emploi. Quant à moi, toutes les prétentions me sont interdites, et il faut que vous sachiez pourquoi. Je suis marié.
— Tu es marié, Michel ! et avec qui donc, mon enfant ?
— Avec la Fée aux Miettes.
Pendant que mes paupières s’abaissaient sous le poids de je ne sais quelle lâche pudeur qui me fait redouter le ridicule, quoiqu’il n’y ait rien de plus méprisable que la dérision des ignorants, le bon maître Finewood laissait tomber ses bras à l’abandon, en exhalant par bouffées d’énormes et lamentables soupirs, suivis d’un long et triste silence.
— Avec la Fée aux Miettes ! reprit-il enfin. Que la reine des fées en soit louée, et le roi des génies aussi, et toute la brigade chimérique des Arabian Nights ! C’est un mariage comme un autre, et je te prie de présenter mes baise-mains à ton épouse, quand tu la retrouveras. – Va travailler, mon cher Michel, continua-t-il ; va travailler, car nous avons besoin de travailler pour rétablir nos affaires ; – et ne travaille pas cependant jusqu’à te faire du mal.
Maître Finewood ne m’avait rien dit de mes malheurs et de mes dangers de la veille, que je croyais généralement connus à Greenock, où de pareils événements ne sont pas ordinaires ; mais j’attribuais cet oubli aux préoccupations de sa propre mésaventure. Mes camarades qui m’accueillirent avec la même bienveillance que de coutume, ne m’en parlèrent pas davantage, ce qui me fit supposer qu’on était convenu de cette réserve pour ne pas ramener ma pensée sur des souvenirs humiliants et douloureux, et ce procédé touchant enflamma tellement mon zèle à la besogne que je fis la journée de dix compagnons.
Comme je me disposais à quitter le chantier, pensif à mon habitude et peu soucieux des allants et des venants qui se croisaient sur mon chemin, je me sentis tout à coup saisi par maître Finewood, qui m’embrassait encore plus tendrement que le matin, suspendant à peine par courts intervalles ses caresses énergiques pour donner l’essor à des exclamations de joie mêlées confusément de phrases sans liaison, dans lesquelles il était impossible de trouver le moindre sens, à moins d’avoir le secret d’Œdipe ou de Tirésias.
— Remettez-vous un peu, maître, lui dis-je, et faites-moi part des nouveaux événements qui vous ont rendu tant de gaieté, de manière à me procurer le plaisir d’y prendre part avec connaissance de cause.
— Eh ! qui aurait le droit, s’écria maître Finewood, d’en jouir à meilleur titre que toi, qui es, ainsi que je le disais tantôt, la providence visible de ma maison ! Apprends donc, mon fils, que tout ce que tu m’avais annoncé dans une de ces illuminations soudaines où tu débites souvent, passe-moi l’expression, d’assez singulières rêveries, s’est réalisé à la lettre comme par enchantement. D’abord, tu n’avais pas fait vingt pas, que ce jeune Patrick dont il a été question entre nous, instruit de la fugue de mes gens et de la catastrophe de mes guinées, est venu me demander la main d’Annah, en m’assurant du consentement de ma fille. Je ne lui ai pas fait attendre le mien, et tu seras demain de six noces à la fois, car je me montrerais ingrat en me dirigeant à l’avenir autrement que par tes conseils. Les préparatifs sont tout faits d’ailleurs, et il n’y a que six noms à changer aux contrats. Je voudrais bien inviter ton épouse aussi, et sa présence nous ferait certainement grand honneur ; mais elle est d’une espèce par trop fugitive, et j’ai entendu dire que les fées ne se rencontraient pas facilement à domicile.
— Mes vœux pour votre famille sont comblés, répondis-je sans prendre trop garde à cette ironie que le bonhomme n’avait aucune intention de rendre offensante. – Le reste est de peu de conséquence, et il me suffit de vous voir rentré dans la voie du parfait bonheur.
— Le reste est de peu de conséquence, dis-tu ? On voit bien, mon ami, que tu n’as jamais eu trente mille guinées, et surtout que tu ne les as jamais perdues, car c’est dans ces occasions-là qu’on en connaît tout le prix : mais si tu veux me prêter encore un moment d’attention, tu vas entendre merveille. Aussitôt après que Patrick m’eut quitté, j’allai me promener sur le port pour rasséréner mes sens agités à la fraîche brise du matin. La jetée était comble de spectateurs attirés par une triste curiosité, qui contemplaient les débris amoncelés sur le rivage par cette effroyable tempête dont les hurlements, capables de réveiller les morts, n’ont pas troublé ton repos. J’appris alors que le souhait qu’il m’était arrivé de proférer sans réflexion un quart d’heure auparavant n’avait été que trop exaucé, et j’en sentis quelque regret. Le vaisseau de mes insignes voleurs, battu toute la nuit par l’orage, venait de couler à fond à la vue de la rade, et depuis ce temps-là nos agiles mariniers et nos hardis plongeurs s’étaient épuisés en efforts inutiles pour porter du secours à l’équipage : tout avait péri. Comme je méditais, les pieds presque baignés par la lame, sur ces cruelles calamités de la nature, juge de mon étonnement quand je vis un barbet noir de la plus jolie espèce aborder à mes pieds ; y déposer, en secouant au vent ses oreilles humides, un de mes sacs de marocco, et se remettre à la nage avec tant de rapidité que tu aurais pris son sillage pour celui d’une murène. Je n’étais pas encore revenu de ma surprise qu’il était revenu, lui, de son second voyage avec un autre sac, et je te jure qu’il n’a pas repris haleine avant de me les avoir rapportés tous six du fond de la mer. Comme je me mettais en frais de gestes et de démonstrations pour lui faire comprendre qu’il ne me manquait plus rien et lui épargner de nouvelles fatigues, il m’a montré les talons en gagnant pays à la course, car je pense en vérité qu’il le connaissait aussi bien que moi ; et regarde plutôt, le voilà qui galope encore vers Renfrews–Mounty, ni plus ni moins que s’il avait entrepris de forcer un chevreuil des Grampians !
— Je m’en doutais, dis-je en le suivant des yeux. C’est le digne Master Blatt, la perle des pages bien appris.
— Le connaîtrais-tu en effet ? Je regrette davantage que tu n’aies pas été près de moi pour le retenir, car je lui devais au moins la politesse d’une tranche de roastbeef ou d’un bon relief de pâté.
— Ne vous y trompez pas, maître Finewood ! Master Blatt a les sentiments placés trop haut pour se laisser aller aux mièvreries des chiens du commun, et il trouve dans sa satisfaction intérieure le prix d’une action honnête.
— Merci de moi, mon homme est reparti, reprit le maître. Où diable va-t-il chercher les sentiments et la satisfaction intérieure d’un chien barbet ?
Là-dessus nous nous séparâmes, le vieux charpentier plus convaincu que jamais de ma folie, et moi réfléchissant à l’aveugle suffisance du vulgaire, qui se croit le droit de mépriser tout ce que sa faible intelligence n’explique pas.
XXIII.
Comment Michel fut introduit dans un bal de poupées vivantes, et prit plaisir à les voir danser.
J’arrivai ainsi aux murs de la maisonnette, qui me parut un peu plus accessible que la veille, car il en est de nos habitudes comme de nos études, et un esprit patient et résolu se forme à tout par accoutumance. Je m’arrêtai cependant avant d’entrer au bruit extraordinaire qui partait de l’intérieur. Ce n’était rien moins qu’un concert vocal, dans lequel il fallait une oreille exercée pour distinguer une multitude de voix, tant leur unisson était parfait et leur accord harmonieux. J’avais déjà reconnu cette chanson si familière à mes souvenirs, dont le refrain se présentait souvent à mon esprit :
C’est moi, c’est moi, c’est moi,
Je suis la mandragore,
La fille des beaux jours qui s’éveille à l’aurore,
Et qui chante pour toi !
Mais j’étais doublement empêché à concevoir que ce thème fantasque des écoliers de Granville fût parvenu si loin, et que la Fée aux Miettes reçût une si nombreuse société, quand je me rappelai qu’elle attendait ce jour-là quatre-vingt-dix-neuf visites.
— Ce sont mes sœurs, cria-t-elle du plus loin qu’elle m’aperçut, qui n’ont pas voulu partir sans te remercier de tes munificences.
Et je vis en effet au même instant les quatre-vingt-dix-neuf petites vieilles s’humilier jusqu’à terre en révérences cérémonieuses et méthodiques, avec tant de régularité qu’on aurait cru qu’elles obéissaient au jeu d’un ressort commun à toute l’assemblée. J’ai assisté en ma vie à des spectacles bien extraordinaires, mais je ne m’en rappelle aucun qui m’ait jamais frappé autant que celui-là.
Il n’y avait pas une de ces aimables petites femmes qui ne ressemblât trait pour trait à la mienne de physionomie et d’ajustements, de manière qu’il aurait été malaisé d’en faire la différence, à cela près qu’elle les surpassait toutes par la noblesse de sa prestance et par l’élévation de sa taille, ce qui lui donnait un air surprenant de bonne grâce et de majesté. Quand elles furent relevées sur leurs petits pieds, du milieu de leurs robes bouffantes où j’avais craint un moment de les voir disparaître, je m’aperçus, à parcourir des yeux la longue ligne sur laquelle elles étaient rangées comme les tuyaux d’un orgue ou les pipeaux de la flûte de Pan, que cet avantage relatif les distinguait également les unes des autres, de la première à la dernière, dans un ordre de décroissement insensible ; mais je ne saurais vous en donner une idée qu’en supposant une machine d’optique où l’on ferait passer devant vous la même personne vue à travers cent lentilles artistement graduées depuis la proportion naturelle jusqu’au dernier point perceptible de réduction. La quatre-vingt-dix-neuvième de mes belles-sœurs aurait certainement pu être offerte comme un jouet charmant à la fille cadette du roi de Lilliput, si la dignité de sa condition l’avait permis.
Après les politesses d’usage et la conversation animée sans confusion d’un cercle de femmes bien nées, on reprit la musique, où je remarquai que leurs voix parcouraient, selon leurs tailles et dans les mêmes rapports, l’échelle la plus étendue des dégradations toniques qu’il soit possible d’imaginer, sans que la délicieuse unité du chœur en fût dérangée le moins du monde, et je crois que nos savants théoriciens seraient fort embarrassés de se rendre compte d’une symphonie à cent parties exécutée avec autant d’ensemble et de méthode. La soirée fut terminée par un bal, et la famille de ma femme, qui était douée en toutes choses, se surpassait dans la danse. Je ne me sentais pas du plaisir de voir se croiser en entrechats élégants, à la hauteur de ma tête, les coins roses de leurs bas de soie blancs ; et ces élans prodigieux qui mettraient en défaut la souple légèreté de nos bayadères, ne se seraient probablement pas effectués sans désordre dans un espace aussi étroit, si la puissance d’élasticité verticale dont elles semblaient recevoir l’impulsion, ne les avait pas ramenées à leur place, avec une précision merveilleuse, comme la poupée des fantoccini qu’un fil caché appelle aux frises du théâtre, et laisse retomber perpendiculairement sur sa planchette.
Elles se retirèrent ensuite après de tendres adieux, sous les pavillons que la Fée aux Miettes leur avait fait préparer dans le jardin, et je ne les ai pas vues depuis. – Mais il est certain qu’elles reviendront demain à Greenock.
Notre souper se passa, comme la veille, en tendres et utiles entretiens, et le sentiment de ce bien-être nouveau, qui se faisait connaître à moi sous tant de formes gracieuses, me plongea peu à peu, comme la veille, dans une espèce d’extase où tout autre sentiment s’anéantit. Je ne savais plus de ma vie que ce qu’il en fallait pour me trouver heureux.
— Sais-tu maintenant ce que c’est que le bonheur ? dit la Fée aux Miettes en collant ses lèvres sur ma main.
— Oui, oui, je le sais ! le bonheur est de vivre près de la Fée aux Miettes, et d’en être aimé !
Et je me mis à sa poursuite comme la veille sans être plus habile à la rejoindre.
Je me couchai, je m’endormis ; l’espace se rouvrit à ma vue, les voûtes se creusèrent au-dessus de moi comme si elles avaient voulu se perdre dans les profondeurs du ciel ; les colonnes de marbre et de porphyre germèrent du sein des pavés pour aller les chercher et les soutenir dans les airs ; tous les flambeaux s’allumèrent à la fois, et Belkiss parut.
Elle n’y manqua jamais depuis.
XXIV.
Ce que Michel faisait pour se dédommager quand il fut riche.
Le soleil, qui commence à descendre vers l’occident, et qui n’a guère plus d’une heure maintenant à occuper le ciel, m’avertit trop bien de la nécessité de mettre des bornes à mon récit, pour que j’abuse plus longtemps, monsieur, de la patience avec laquelle vous avez daigné m’écouter, en prolongeant l’histoire d’ailleurs assez monotone, comme toutes les histoires heureuses, des beaux jours dont celui de mon mariage avec la Fée aux Miettes fut suivi. Je ne vous arrêterai donc, parmi les événements de ma vie qui se rattachent à cette époque de douce félicité, qu’à ceux dont la connaissance est nécessaire pour l’éclaircissement du reste.
Après l’établissement des six filles de maître Finewood, je continuai à travailler dans son chantier, dont il me donna la direction, du consentement et presque du choix de tous les camarades. Je plaçai même dans ses entreprises quelques fonds que ma femme avait mis en réserve pour cet usage, et dont il attribua l’origine, sans doute, à un héritage inattendu. Ce déploiement de capitaux fut si heureusement favorisé par les circonstances, que la fortune du maître se doubla dans le courant de l’automne ; et, comme il pensait, depuis plusieurs années, à jouir sans sollicitude, au terme de son honorable vie, du fruit de ses longs travaux, il se décida bientôt, d’après les instances de sa famille, à faire passer sous mon nom, mais dans l’intérêt de notre nombreuse communauté, l’administration de la maison Finewood et compagnie. Je ne vous ai pas dit que, dès le premier mois, j’avais obtenu son consentement au mariage de ses six garçons avec six jeunes filles pauvres, mais belles, sages, pieuses, et pleines d’amour pour le travail, qui en étaient adorées. Ce fut là une belle fête, car la Fée aux Miettes, qui était de moitié dans tous mes secrets et qui me dirigeait dans toutes mes actions, eut l’art de doter les six brus, au moment de la signature du contrat, par des voies si imprévues et cependant si naturelles, que personne ne s’avisa que j’y fusse pour quelque chose. La première se trouva un oncle mort millionnaire en Amérique, et qui n’avait pas plus de vingt héritiers. Le père de la seconde retourna un trésor dans son pré en déplaçant une borne, et il lui resta quelque chose quand le fisc eut pris sa part. Il en fut ainsi des autres, et les moyens dont je ne vous parle pas foisonnent en apparence dans les romans et les comédies ; mais l’imagination de la Fée aux Miettes avait plus de ressources que les comédies et les romans, d’abord parce qu’elle avait beaucoup plus d’esprit que les gens qui en font ; et puis parce qu’une bonté active et inépuisable est plus ingénieuse que l’esprit.
De mon côté, ma fortune s’était si prodigieusement agrandie qu’elle serait devenue un tourment pour moi, si la Fée aux Miettes n’avait pas consenti de bonne heure à ne m’en plus parler. Le vaisseau la Reine de Saba revenait tous les huit jours, comme il l’avait promis, mais il jetait l’ancre hors de l’horizon des vigies, et ne communiquait qu’avec la Fée aux Miettes, car le peuple ne savait plus rien de ses voyages, ou n’en parlait que par manière de risée, en disant, pour exprimer l’incertitude ou l’erreur d’une fausse espérance : Quand le vaisseau de la reine de Saba reviendra ? Cependant il naviguait, chargé au départ des inutiles escarboucles de nos ruisseaux, et au retour des cèdres et des cyprès, – trésor plus précieux au charpentier, – que je façonnais dans mes ateliers pour la construction du palais d’Arrachieh. Tout ce que je savais de l’emploi de mes richesses, et tout ce que j’avais besoin d’en savoir, c’est qu’il y avait peu d’infortunes à la portée de nos soins qui ne fussent promptement soulagées ; c’est que des hôpitaux s’ouvraient de toutes parts pour les malades, et des hospices pour les pauvres ; c’est que des villes incendiées se relevaient de leurs ruines, et reflorissaient riantes aux yeux de leurs habitants consolés ; c’est que la Fée aux Miettes me répétait chaque soir : Sais-tu maintenant ce que c’est que le bonheur ? – et que chaque soir je pouvais lui répondre : Oui, Fée aux Miettes, je le sais.
Le reste de nos conversations, qui étaient presque toujours fort longues, surtout les jours de dimanche et de fête, où je n’étais pas obligé de paraître au chantier, roulait sur d’importantes questions de morale, sur des faits curieux de l’histoire, et plus particulièrement sur l’étude des langues, dont j’avais toujours fait mon plaisir. La Fée aux Miettes regardait cette science comme le premier des liens matériels qui unissent l’homme à l’homme dans l’état de société, et elle avait formé pour me les enseigner des méthodes si claires et si bien ordonnées, qu’il n’y en avait point dont les principes généraux me coûtassent plus de quelques heures d’étude, au bout desquelles tous les mots venaient se ranger comme d’eux-mêmes sous les perceptions du sens intelligent que ses leçons avaient développé en moi ; de sorte que j’étais souvent disposé à croire qu’apprendre une langue c’est s’en souvenir, et je ne serais pas étonné que Dieu, qui a créé les hommes pour s’entendre et se servir réciproquement, eût caché ce mystère parmi ceux de notre organisation.
Mais entre tous les sujets sur lesquels j’avais coutume de ramener la Fée aux Miettes, il y en avait un qui se reproduisait en dépit de moi à tous les événements extraordinaires de ma fortune, et vous avez pu voir jusqu’ici, monsieur, que les occasions ne me manquaient pas.
— Ne serait-il pas possible, en effet, Belkiss, lui disais-je quelquefois, que vous fussiez une véritable fée ?
— Bon, bon, me répondait-elle en riant, un esprit de la trempe du tien aurait-il foi à des contes auxquels les enfants même ne croient plus ? Jamais fée n’a paru sur terre depuis le temps de la reine Mab.
— Vous parlez sagement, continuai-je en secouant la tête comme un homme qui n’ose avouer tout à fait que sa conviction n’est pas complète, mais je ne puis me persuader que ma vie soit conforme au train ordinaire des choses, et qu’il n’y ait pas un peu de surnaturel dans vos aventures et dans les miennes. J’avais résolu d’abord de ne plus vous interroger sur ce chapitre, et je vous prie de croire que je ne le ferais point si cette idée ne me poursuivait parfois de manière à me faire craindre pour ma raison.
— J’ai des remèdes sûrs, reprenait-elle alors sans rien perdre de sa gaieté, pour guérir plus tôt que tu ne crois tes inquiétudes d’esprit. Tu peux donc te livrer sans danger à tes illusions, tant qu’elles ne seront qu’heureuses, et je ne sais si le secret de la philosophie n’est pas là. Quel grand mal y aurait-il à t’imaginer que je suis réellement une intelligence favorisée de quelque supériorité sur ton espèce, qui s’est attachée à toi par estime pour tes bonnes qualités, par reconnaissance pour tes bienfaits, et peut-être par ce penchant invincible de l’amour, dont il paraît, au témoignage des livres saints, que les anges du ciel ne sont pas exempts ? Ces alliances sympathiques de deux natures inégales sont possibles, puisque la religion les reconnaît, et que la raison purement humaine qui discute tout, parce qu’elle ne discerne rien clairement, ne saurait en contester quelques exemples fort rares à la vérité, mais qui se sont établis dans nos créances, sur la foi des hommes les plus éclairés et les plus vertueux. Pourquoi cette amitié supérieure n’aurait-elle pas multiplié autour de toi quelques faits apparents dont le résultat bien réel devait être d’éprouver ta patience et ton courage, de plier ta vie par un exercice continuel à la pratique de la vertu, et de te rendre graduellement digne de parvenir à une destinée plus élevée dans la vaste hiérarchie des créatures ? N’as-tu pas remarqué que les vaines sagesses de l’homme le conduisent quelquefois à la folie ? Et qui empêche que cet état indéfinissable de l’esprit, que l’ignorance appelle folie, ne le conduise à son tour à la suprême sagesse par quelque route inconnue qui n’est pas encore marquée dans la carte grossière de vos sciences imparfaites ? Il y a des énigmes dans ta vie ; mais qu’est-ce que la vie elle-même si ce n’est une énigme ? et on ne voit pas que personne soit bien pressé d’en chercher le mot. Je te réponds que l’explication de ces difficultés t’arrivera un jour, si Dieu le permet ; et si ce dessein n’entrait pas dans les vues de son éternelle prudence, tu aurais beau t’efforcer de les débrouiller sans lui. Ne t’alarme donc plus de celles de ces impressions que tu ne peux comprendre ; accepte avec reconnaissance et goûte avec modération ce qu’elles ont d’agréable ; remets au temps, plus savant que toi, l’interprétation des difficultés qui t’embarrassent, et attends dans la sincérité d’un cœur simple que le mystère s’en éclaircisse.
Quand elle avait parlé ainsi, nous nous mettions ordinairement à la prière, et, de préférence, à cette prière d’effusion et de sentiment que les langages impuissants de l’homme essayeraient inutilement d’exprimer par des mots, communication vive, affectueuse et puissante avec le monde invisible, épanchement de résignation et de confiance dont l’humilité nous exalte au-dessus de toutes les grandeurs du siècle, révélation intime d’une âme qui se cherche, qui s’étudie, qui se connaît, et qui pressent d’une conviction inaltérable son infaillible immortalité.
D’autres fois la Fée aux Miettes prenait la Bible, ou quelque belle production de la philosophie et de la poésie antiques, et m’en lisait des passages dans la magnificence naïve de leurs langues originales, en les développant, tantôt dans ces langues mêmes, tantôt dans celles des modernes, car les faciles travaux auxquels elle n’avait cessé d’accoutumer agréablement mon esprit, ne tardèrent pas à me mettre en état de les entendre aussi distinctement que la mienne.
Et lorsqu’elle avait fini, je me disais en moi-même : Il est incontestable que la Fée aux Miettes est une de ces intelligences supérieures dont elle vient de me parler, et dont il n’est pas permis de mettre l’existence en doute, à moins de contester outrageusement au Créateur la puissance de faire quelque chose qui vaille mieux que l’homme ; elle n’est certainement pas du nombre de celles que Dieu a maudites, car toutes ses actions et tous ses enseignements semblent n’avoir pour objet que de le faire aimer davantage. Il n’y a pas d’ailleurs de plus savante, de plus digne et de meilleure femme. C’est seulement grand dommage qu’elle soit si vieille et qu’elle ait de si grandes dents. – Mais, reprenais-je aussitôt, on n’a pas à se plaindre de sa destinée quand on passe les nuits à vivre d’amour avec Belkiss, et les jours à étudier la sagesse avec la Fée aux Miettes.
XXV.
Comment la Fée aux Miettes envoya Michel à la recherche de la mandragore qui chante, et comment il finit de l’épouser.
Six mois entiers s’écoulèrent dans cet enchantement sans qu’il perdît rien de son ivresse. Un soir pourtant la physionomie de la Fée aux Miettes exprimait un sentiment de mélancolie dont j’avais cru suivre depuis quelques jours les développements, et qui mêlait dès lors un léger trouble à mon bonheur, quoique j’eusse commencé par l’attribuer à quelque savante préoccupation ; mais il n’y avait plus moyen de s’y tromper. Elle souffrait, et je pensai même, à l’abattement de ses yeux rougis, qu’elle devait avoir pleuré.
— Ma bonne amie, lui dis-je au moment où elle se disposait à me quitter, je n’ai jamais usé du droit de commandement que le mariage me donne sur vous, et que vous prenez la peine de me rappeler souvent. J’espère donc que vous me pardonnerez de le faire valoir aujourd’hui pour l’unique fois de ma vie. Quoique je sois moins exercé que vous à lire dans les cœurs, le vôtre a peu de replis où je ne me sois fait une douce étude de pénétrer pour y surprendre vos désirs ou vos chagrins, et je sais aujourd’hui positivement qu’il me cache un secret amer. Ce secret, j’avais quelque titre peut-être à l’obtenir de votre tendresse ; et, puisqu’elle me l’a refusé jusqu’ici, je l’exige de votre soumission.
— Tu m’as deviné, dit-elle en me tendant la main, et tu sauras ce que tu me demandes, puisque telle est ta volonté, quoiqu’il en coûte à mon amitié de tourmenter la tienne d’une émotion inutile. Apprends, mon pauvre Michel, qu’il me reste peu de temps à passer près de toi, et que toute la sagesse dont tu me crois armée contre le malheur n’a pu résister à la cruelle idée de notre séparation. Voilà mon secret.
— Notre séparation, Fée aux Miettes ! Ah ! je n’y survivrais pas ! Mais qui pourrait nous séparer ?
— La mort, Michel ! Un horoscope fatal m’a menacée au berceau de n’être heureuse que pendant un an de l’affection d’un époux et le sixième de ces mois, qui ont fui comme des jours, vient d’expirer aujourd’hui.
— Les horoscopes sont menteurs, et votre âme se trouble sans raison.
— Les horoscopes de ma famille n’ont jamais menti.
— Celui-là mentira, s’il a dit que la mort fût capable de nous désunir, car je ne vous quitterai pas. Toute ma vie est en vous, Fée aux Miettes, et votre seule compassion pour ma solitude et pour ma misère m’a forcé à la supporter sans découragement et sans dégoût. Que ferais-je après vous dans ce monde qui m’est étranger, au milieu des hommes qui ne me comprennent pas, et dont les tristes sciences m’ont rebuté de tous les bonheurs dans lesquels vous n’entrez pas pour quelque chose ? Je vivrais parmi eux comme le proscrit auquel l’eau et le feu sont interdits par des lois féroces, et qui n’a pas même un cœur ami où épancher le sien. – Au nom de Dieu, Fée aux Miettes, vous qui connaissez tous les secrets de la terre, et si je ne m’abuse, une partie de ceux du ciel, trouvez un moyen de déjouer cet oracle cruel, ou du moins de m’en faire partager la rigueur, sans réduire mon désespoir à une extrémité qui nous séparerait pour toujours !…
— Un moyen, mon ami ! dit la Fée aux Miettes vivement émue, il y en a un peut-être ! Mais comment prescrire à ton âge sensible et passionné, surtout quand on a le mien, une pareille obligation ? Ne t’impatiente pas, Michel, et laisse-moi parler. L’horoscope disait encore que si mon mari m’aimait assez pour achever cette année d’épreuve sans que son cœur battît de l’amour d’une autre femme, et qu’il conçût un autre bien que d’être à moi, l’homme qui m’appartiendrait ainsi par la plus vive et la plus fidèle des sympathies, ne manquerait pas de trouver, avant que l’année s’accomplît, le spécifique admirable qui prolongerait mon existence en me rendant ma jeunesse – Et je redeviendrais Belkiss !
Je me renversai sur ma chaise en couvrant mes yeux de mes mains.
— Oh ! ma bonne amie, qu’avez-vous dit… et qu’avez-vous fait ?… C’est Belkiss qui nous a perdus !…
— Que parles-tu de Belkiss, insensé ? Belkiss, c’est moi !…
— Hélas ! le sommeil m’en a donné une autre, et j’ai inutilement cherché dans votre science un préservatif contre les délices de cette illusion ! Absorbée dans les souvenirs de votre jeunesse, vous n’avez pas voulu comprendre le crime de mon bonheur. La Belkiss de ce funeste portrait m’a inspiré un amour adultère qui me rend indigne de vous sauver !
— Est-ce tout ? dit la Fée aux Miettes en souriant, et n’ai-je point d’autres rivales !
— Une rivale à Belkiss, grand Dieu ! Belkiss elle-même n’est pas la vôtre, car je ne suis pas complice du démon de mes songes, n’est-il pas vrai ?…– Et ce n’est pas ma faute si elle revient toujours, toujours ! quand je me suis défendu depuis six mois de regarder son portrait !
— Calme donc ton cœur, Michel, car, je te le répète encore, l’amour que tu ressens pour Belkiss est un sentiment dont je ne jouis pas moins que de ton ancienne et constante amitié pour la vieille Fée aux Miettes ; et bien loin d’en être jalouse, comme tu le crains, je m’en trouve doublement heureuse. Ainsi rien ne s’oppose au succès de mes espérances, mon cher enfant, si tu te sens capable d’arriver au coucher du soleil de la Saint-Michel prochaine, sans ouvrir ton âme à une autre passion, et sans y laisser pénétrer le moindre regret des engagements qui m’ont soumis ta vie.
— Exigez de moi, Fée aux Miettes, une promesse en apparence plus difficile à tenir, et qui ne me coûtera pas davantage ! Ce que vous me demandez pour six mois, je vous le jure pour toujours.
— J’en fais mon affaire une fois que ce premier terme sera passé, répondit la Fée aux Miettes ; mais je crains qu’il ne te mette à des épreuves plus dangereuses que tu ne le supposes. Il faut aller chercher ce spécifique au loin, puisque j’ignore moi-même en quel lieu la sagesse de Dieu l’a placé ; tu es jeune et bien jeune ; ta figure et ton air feraient honneur à un prince ; le costume de voyage que je t’ai fait préparer annonce tout autre chose qu’un simple charpentier ; et quoique tu n’aies pas vu le monde, tu t’y feras remarquer toutes les fois que tu y paraîtras, parce que tu as deux qualités précieuses, dont le meilleur ton possible n’est que l’expression convenue, une bienveillance universelle et une parfaite modestie. Les pays que tu vas parcourir sont remplis de femmes aimables et belles dont l’accueil exigera de toi, si tu ne veux passer pour rustique et grossier, un juste retour de politesse, et même de sensibilité. Tu seras aimé, Michel, et l’amour demande l’amour : Il l’impose quelquefois. Ajoute à cela, mon ami, que je ne t’accompagne pas, et que ces entretiens graves et tendres, où j’ai de temps en temps raffermi ton âme dans ses incertitudes, manqueront à tes soirées solitaires. Bien plus, pendant tout ce temps-là tu ne reverras pas Belkiss, dont les visites nocturnes ne s’égarent jamais loin du toit conjugal, et tu n’auras pour te consoler que la conversation muette de son portrait.
— Je n’en ai pas même besoin, répliquai-je vivement. Ses traits et les vôtres sont assez empreints dans mon cœur pour ne s’en effacer jamais. Les dangers dont il vous plaît de m’effrayer m’alarment si peu d’ailleurs, que je croirais commencer à être coupable si je pensais à me prémunir contre eux. Vous garderez le portrait de Belkiss, ajoutai-je en lui présentant le médaillon ; et si vous voulez jeter quelque charme sur notre séparation passagère, c’est le vôtre que vous me donnerez.
— Tu les conserveras tous les deux, s’écria la Fée aux Miettes, et ce sera trop de bonheur pour moi qu’un regard de toi tous les jours, sous la forme disgracieuse que les ans m’ont donnée ! Mais tu n’as donc pas remarqué qu’en faisant jouer le ressort dans le sens opposé, on découvrait l’autre face de ce médaillon ? – Vois plutôt !
C’était effectivement le portrait de la Fée aux Miettes, et j’y appliquai mes lèvres avec ardeur.
— Enfant ! reprit-elle, pauvre, mais digne créature qu’une méprise de l’intelligence qui préside à la distinction des espèces a malheureusement laissé tomber pour un petit nombre de jours dans le limon de l’homme, ne te révolte pas contre l’erreur de ta destinée ! je te reconduirai à ta place !
Et puis, comme si ces paroles lui étaient échappées par distraction, elle revint au sujet de mon entreprise et aux dispositions de mon voyage.
— Il n’y a pas de temps à perdre, dit-elle, car je sens que l’horrible crainte de te perdre pour jamais achevait déjà de miner mes organes affaiblis. Les heures me vieillissent plus depuis quelque temps que ne faisaient les années, et je ne serais pas surprise d’avoir donné carrière devant toi à quelques idées privées de sens, comme les vagues rêveries des vieillards.
— Il n’en est rien, ma bonne amie, mais je suis prêt à vous obéir, et je crois que je serais déjà parti, quoique l’heure soit peu favorable sans doute aux recherches que vous avez à m’ordonner, si vous m’aviez fait connaître le spécifique dont vous attendez votre guérison. Il faudra qu’il soit bien difficile à conquérir s’il m’échappe !
— Eh ! serait-il vrai, Michel, que j’eusse oublié de te le nommer ! C’est la mandragore qui chante !
— La mandragore qui chante ! dites-vous ? pensez-vous, Fée aux Miettes, qu’il y ait des mandragores qui chantent, ailleurs que dans les folles ballades des écoliers et des compagnons de Granville ?
— Une seule, mon cher Michel, une seule, et son histoire, que je te raconterai un jour, est une des plus belles de l’Orient, puisqu’elle se lit dans un des livres secrets de Salomon. C’est celle-là qu’il faut trouver.
— Bonté inépuisable du ciel ! m’écriai-je, daignez me secourir dans cette déplorable extrémité ! Comment trouver en six mois la mandragore qui chante, dont la Fée aux Miettes disait tout à l’heure qu’elle ne savait pas elle-même en quel lieu la sagesse de Dieu l’avait placée, et qu’on cherche inutilement depuis le règne de Salomon !
— Ne t’épouvante pas de cette difficulté ! La mandragore qui chante se présentera d’elle-même à la main qui est faite pour la cueillir, et tu serais arrivé sans succès au dernier moment de ton généreux exil, le dernier rayon du soleil de Saint-Michel serait près de s’éteindre dans le crépuscule, à l’horizon du monde le plus reculé où tes voyages puissent te conduire, jusque dans ces glaces du pôle où jamais une fleur ne s’est ouverte aux clartés des cieux, que la mandragore qui chante s’épanouirait fraîche et vermeille sous tes doigts, si tu n’as cessé de m’aimer, et te répéterait sur un mode inconnu de la terre ce refrain de ton enfance :
C’est moi, c’est moi, c’est moi !
Je suis la Mandragore.
La fille des beaux jours qui s’éveille à l’aurore,
Et qui chante pour toi.
Alors tu n’auras plus à te soucier, notre destinée sera complète, et nous ne tarderons pas à nous revoir.
— Attendez, dis-je à la Fée aux Miettes, qui se disposait à gagner son appartement, selon l’usage, après cette allocution ; je ne vous ai jamais contrariée sur les petits arrangements de notre ménage, depuis que vous nous séparez tous les soirs par une porte si hermétiquement close que je ne croirais pas perdre au change en donnant l’île de Man pour enrichir mes ateliers de l’ouvrier qui l’a faite. Aujourd’hui c’est autre chose. Je vous quitte pour longtemps peut-être, et je vous quitte abattue et souffrante : c’est vous qui me l’avez dit. L’heure de mon départ sonnera longtemps avant votre réveil, et je partirais malheureux si je m’éloignais de vous inquiet de votre santé, sans avoir reçu votre baiser d’adieu et votre bénédiction. Ne fermez pas cette porte, Fée aux Miettes ; j’ai besoin de vous entendre respirer, et de m’endormir, assuré du calme de votre sommeil.
La porte resta ouverte, et bien m’en prit, car l’inquiétude qui m’obsédait m’empêcha de m’assoupir. Peu de minutes s’écoulaient que je ne descendisse de mon lit pour venir, d’un pied furtif, prêter l’oreille au souffle de la Fée aux Miettes ; à mesure que mes incursions me ramenaient plus près d’elle, il me paraissait plus irrégulier et plus agité. Je crus même entendre une faible plainte et deviner le mouvement d’un frisson. Je me dis :
— Si elle avait froid ! – La draperie qui la couvre est si légère, ajoutai-je en la soulevant ; et elle retomba sur nous deux.
La Fée aux Miettes se réveilla.
— Que se passe-t-il donc de nouveau dans votre esprit, Michel ? dit-elle en me repoussant avec plus de force que je n’en attendais de ses petites mains. Je ne serais pas plus étonnée d’apprendre que l’innocente colombe s’est métamorphosée en pie effrontée ! Avez-vous oublié les conditions de notre mariage et les réserves que j’y ai mises, ou vous imaginez-vous qu’il puisse arriver un temps où les princesses de ma maison dérogeront jusqu’aux brutales amours de la populace humaine ? Rendez grâce à la nuit qui vous dérobe la rougeur que votre audace vient de faire monter à mon front, car il m’est avis qu’elle vous forcerait à mourir de repentir et de honte !…
— Eh ! mon Dieu, Fée aux Miettes !… Excusez ma témérité en faveur de son motif ! C’est seulement que j’ai pensé que vous aviez froid, en vous entendant grelotter sous votre couverture comme un jeune oiseau qui n’a pas encore poussé ses premières plumes, quand une brise du matin court en sifflant sur son nid, pendant que sa mère est allée à la picorée dans les halliers. Si vous n’aimez pas assez votre pauvre Michel pour dormir sans défiance à côté de lui, je suis prêt à vous quitter ; mais ne m’expliquerez-vous pas auparavant comment il se fait que vous soyez dans votre lit presque aussi grande que moi ?
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle ; c’est que je me déploie.
— Cette chevelure aux longs anneaux qui flotte sur vos épaules, Fée aux Miettes, vous l’avez jusqu’ici cachée à tous les yeux.
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle : c’est que je ne voulais la laisser voir qu’à mon mari.
— Ces deux grandes dents qui vous déparent un peu au jour, Fée aux Miettes, je ne les retrouve pas entre vos lèvres fraîches et parfumées.
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle ; c’est que c’est une parure de luxe qui ne convient qu’à la vieillesse.
— Ce trouble voluptueux, ces délices presque mortelles qui me saisissent auprès de vous, Fée aux Miettes, je ne les avais jamais éprouvées avec votre permission que dans les bras de Belkiss !…
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle ; c’est que la nuit tous les chats sont gris.
— Ces explications, Fée aux Miettes, je les avais rêvées une autre fois, ou je les rêve maintenant.
— Oh ! que cela ne t’étonne pas, dit-elle ; tout est vérité, tout est mensonge.
La Fée aux Miettes ne me repoussait plus, et je m’endormis le front caché sous ses longs cheveux, comme il me semblait m’endormir dans mes songes des nuits précédentes sous les longs cheveux de Belkiss.
Je ne me réveillai qu’au bruit de la cloche du chantier qui m’annonçait ce jour-là l’heure de mon départ pour un long voyage, et ma vieille femme était accroupie déjà auprès de la bouilloire à terminer les préparatifs d’un déjeuner plus substantiel qu’à l’ordinaire.
Un moment après, je l’embrassai tendrement, et je gagnai les hauteurs de la montagne pour me mettre à la recherche de la mandragore qui chante.
XXVI.
Le dernier et le plus court de la narration de Michel, qui est par conséquent le meilleur du livre.
Si mon Iliade vous a coûté beaucoup d’ennui, monsieur, ne craignez pas que je mette votre patience à une nouvelle épreuve par la longue narration de mon Odyssée. Ce n’est pas qu’elle n’ait été féconde en aventures extraordinaires dont la connaissance pourrait servir en temps et lieu à l’instruction des hommes de bonne foi ; mais il faudrait pour cela qu’elle fût racontée dans une langue plus naïve et moins spirituelle que la nôtre, chez un peuple qui jouisse encore de son imagination et de ses croyances, et je me propose bien de le faire un jour, si je découvre ce soir la mandragore qui chante. Vous voyez maintenant qu’il me reste peu de temps à m’assurer de son existence, qui est la condition nécessaire de la mienne.
Il me suffira de vous dire que j’erre depuis six mois à travers des plaines de mandragores, qui relèvent toutes de quelque châtellenie peuplée des plus jolies femmes de la terre, et que je n’ai trouvé nulle part ni une mandragore qui chantât, ni une femme qui me fît oublier l’amour de la Fée aux Miettes.
Une semaine s’est à peine écoulée que je me retrouvai aux portes de Glasgow, mêlé à un couple d’herbalistes (1) qui cherchaient des simples.
— Monsieur, dis-je en m’adressant à celui de ces curieux dont l’air rogue et suffisant annonçait le mieux un savant profès, oserais-je vous demander si vous savez où je pourrais me procurer la mandragore qui chante ?
— Mon ami, me répondit-il en me tâtant le pouls, elle est infailliblement, si elle existe quelque part, à l’hospice des lunatiques, où ce garçon va vous conduire.
Et c’est depuis ce jour qu’on m’y retient prisonnier sans contrarier mon projet, puisque les mandragores n’y manquent pas…
Mais je vous le demande, monsieur, n’avez-vous rien entendu, et ne vous semble-t-il pas qu’une harmonie exquise court en murmurant sur ces fleurs mourantes, avec le dernier rayon du soleil horizontal ? Adieu, monsieur, Adieu ! –
Et Michel m’échappa pour courir à ses mandragores.
Dieu me préserve, infortuné, dis-je en me frappant le front de la main, et en m’élançant dans l’avenue sans regarder derrière moi, Dieu me préserve d’être témoin de ton désespoir quand le dernier de tes prestiges s’évanouira !
CONCLUSION.
Qui n’explique rien et qu’on peut se dispenser de lire.
J’atteignais à ce portique élégant qui s’ouvre sur le quai de la Clyde, quand un homme raide et sévère, habillé de noir de la tête aux pieds, me retint par le bras avec un mélange de politesse et d’autorité. Je le saluai ; il me répondit d’une faible inclinaison de tête, et reprit sa pose inflexible en cillant un œil solennel, et puisant largement du tabac d’Espagne dans sa tabatière d’or.
— Monsieur est probablement philanthrope ? dit-il.
— Je ne sais pas ce que c’est, monsieur, lui répondis-je, mais je suis homme.
Il prit lentement sa prise de tabac pour se dispenser d’une explication dont il ne me croyait plus digne.
— J’ai supposé que monsieur appartenait à la profession, reprit-il, parce que je l’ai vu s’entretenir longtemps avec un misérable monomane qu’on nous amena ces jours derniers, et qui est travaillé d’un diable bleu fort étrange. Il a pour lubie spéciale de s’enquérir à tout venant d’une mandragore qui chante. Or monsieur n’est pas sans savoir que cette plante, qui est l’atropa mandrogora de Linné, est dénuée, comme tous les végétaux, des organes qui servent à la vocalisation. C’est une solanée somnifère et vénéneuse, comme un grand nombre de ses congénères, dont les propriétés, anodines, réfrigérantes, narcotiques et hypnotiques, étaient déjà connues du temps d’Hippocrate. On l’emploie utilement contre la mélancolie, les convulsions et la goutte, et je l’ai vue héroïquement résolutive en cataplasmes dans les engorgements, les squirres et les scrofules. Ce que je puis assurer, c’est que le suc de sa racine et de sa partie corticale est un éméto-cathartique puissant, mais dont on ne fait guère usage qu’avec des malades de peu d’importance, parce qu’il occasionne plus souvent la mort que la guérison.
— En vérité ! m’écriai-je en croisant les bras, pendant qu’il me retenait fermement par un des boutons de mon habit.
— Ce qui a occasionné, ajouta-t-il en souriant avec une dignité dédaigneuse, l’erreur de ce pauvre garçon, c’est une sotte superstition de ces ignorants d’anciens, qui s’est perpétuée à travers les ténèbres du moyen âge, et dont le bas peuple n’est pas encore entièrement désabusé. On croyait, avant les progrès immenses qu’a faits de nos jours la médecine philosophique et rationnelle, que la mandragore formait des cris plaintifs quand on l’arrachait de la terre, et c’est pour cela qu’il était recommandé à ceux qui tentaient cette périlleuse opération de se boucher exactement les oreilles pour n’être pas attendris, ce qui semblerait indiquer à la vérité que ces cris passaient pour être modulés selon les règles de l’harmonie. Nous tenons ceci pour une aberration capitale, en faveur de laquelle on s’appuierait en vain de l’opinion d’Aristote, de Dioscoride, d’Aldrovande, de Geoffroi Linacer, de Columna, de Gessner, de Lobelius, de Duret, et d’une foule d’autres grands hommes, depuis que nous avons reconnu qu’il n’y avait point d’absurde folie dont on ne pût trouver l’origine écrite dans un livre de science.
— Voilà par exemple un fait, répliquai-je, dont je suis parfaitement convaincu.
— Je m’en doutais à l’attention que vous portez à mon discours, continua-t-il en me serrant le bouton d’une manière irrésistible. En effet, monsieur, comment la mandragore chanterait-elle, puisque nous savons que la fonction mécanique du chant s’exécute virtuellement par l’office de la membrane crico-thyroïdienne, ou, pour m’expliquer avec beaucoup plus de précision et de clarté, dans l’espace qui est compris entre les ligaments thyro-aryténoïdiens, retenez bien cela, je vous prie ; de sorte que Galien assimilait la glotte, qui est une ouverture supérieure du larynx, à un instrument à vent, bien qu’elle ne présente pas exactement toutes les conditions que réclame la composition d’une flûte à bec, et moins encore celles d’un instrument à embouchure. Le savant M. Ferrein, qui est si célèbre dans le monde, a voulu y voir un instrument à cordes, mais cette opinion est abandonnée depuis les découvertes des physiologistes modernes qui en ont fait définitivement un instrument à anche. M. Geoffroy Saint-Hilaire, que vous pouvez connaître, démontre même fort agréablement que cet instrument est à deux fins, et qu’il fait très bien tour à tour, moyennant les dispositions requises, la partie de clarinette et celle de flûte traversière ; d’où il a tiré l’heureuse distinction des voix anchées et des voix flûtées, qui est maintenant la seule reçue dans les cours d’anatomie et dans les chœurs de l’Opéra. Le grammairien Court de Gébelin, pédant frotté de racines et d’étymologies, mais fort peu versé d’ailleurs dans les sciences médicales, est le seul qui ait défini la voix un instrument à touches dont le clavier est dans la bouche de l’animal, et auquel le larynx sert de tuyau, et le poumon de soufflet ; ce qui est assez satisfaisant pour l’articulation, mais ce qui n’explique nullement, comme vous voyez, le phénomène phonoïque. Les ignorants se mettent encore plus à leur aise, en prétendant que la voix est tout bonnement un instrument sui generis, dont les effets se produisent comme il plaît à Dieu. C’est un système qui fait pitié. Or il est inutile de vous rappeler, monsieur, que l’analyse la plus scrupuleuse n’a jamais fait découvrir, ni dans le calice monophylle et turbiné, ni dans la corolle pentapétale et campanuliforme de la mandragore, l’ombre d’une glotte et d’un larynx, et qu’elle manque essentiellement de membrane crico-thyroïdienne et de ligaments thyro-aryténoïdiens…
— C’est probablement pour cela, dis-je, que la mandragore est muette ?
— Il n’y a pas de doute. Comme le sujet actuel est flegmatique, doux et malléable d’inclinations, et inepte de nature, il est difficile de juger de la méthode curative qu’on pourra lui appliquer avant de l’avoir vu dans le paroxysme qui va succéder à ses hallucinations. Le plus sûr sera d’y procéder graduellement, en commençant par les affusions d’eau glaciale sur l’occiput et l’épigastre, et en passant de là aux sinapismes, aux épispastiques et aux moxas, sans négliger, comme de raison, un fréquent usage de phlébotomie jusqu’à syncope. Si l’éréthisme persiste, nous avons l’usage des ceps, des poucettes, du gilet de force et du maillot…
— Ne me retiens pas, bourreau, m’écriai-je en laissant mon bouton dans ses mains de cannibale, et en franchissant les grilles aussi brusquement que si j’avais eu tous les chiens de l’île de Man à mes trousses. — Il faut que vous soyez bien mal avisé, continuai-je en parlant au concierge presque sans m’arrêter, pour ne pas exercer une surveillance plus attentive sur les plus dangereux de vos prisonniers ! L’égalité, si vainement cherchée par les hommes, serait-elle une chimère aussi à la maison des fous ?
— De qui parle monsieur ? répondit gravement le concierge.
— De qui, maître Cramp ? de qui ? pouvez-vous le demander ? de cet horrible homme noir dont je ne me suis délivré que par miracle ! Ne voyez-vous pas qu’il sortirait s’il le voulait ?
— Cela ne dépend que de lui, reprit maître Cramp. C’est un fameux médecin de Londres qui est venu faire des observations philanthropiques dans notre maison de Glasgow, pour les appliquer au perfectionnement de la science et à l’amélioration du sort de tous les malades des trois royaumes.
____________
Ô le plus sage des hommes, ô Tobie, qui me rendra la sibilation plaintive de votre lila burello !
…
____________
— Oui, monsieur, il n’y a rien de plus vrai, me disait le lendemain Daniel Cameron, tandis que je l’écoutais la tête appuyée sur ma main et le coude appuyé sur mon oreiller ; le lunatique avec lequel monsieur a bien voulu s’entretenir hier si longtemps a disparu quelques minutes après, et tous les gardiens ont passé la nuit à sa recherche.
— Il se sera évadé, Daniel, et j’en remercie le ciel. Le voilà quitte, le pauvre Michel, du gilet de force, du maillot, des ceps, des poucettes, de la phlébotomie, des moxas, des épispastiques, des sinapismes, des affusions d’eau glacée, et des éméto-cathartiques !
— Évadé, monsieur ? et comment s’évaderait-on de la maison des lunatiques, à moins de s’évader par l’air, comme le disent ses camarades, qui prétendent l’avoir vu se balancer un moment à la hauteur des tourelles de l’église catholique, avec une fleur à la main, et chantant d’une manière si douce qu’on ne savait si ces chants provenaient de la fleur ou de lui ?
— C’était de la fleur, Daniel, ne t’y trompe pas, quoique je comprenne à merveille que tu tombasses dans cette méprise en te souvenant que les fleurs n’ont point de ligaments thyro-aryténoïdiens, si tu l’avais jamais su par hasard. – Mais écoute, ajoutai-je pendant que j’achevais de jeter quelques mots sur mes tablettes ; écoute, Daniel, tu sais lire, et ce funeste avantage de l’éducation ne t’a fait perdre aucun de ceux de ton intelligence naturelle. Va au port de Clyde, mon garçon ; prends une bonne place pour Greenock sur le Caledonian, ou sur l’Ayr, ou sur le Fingal ; salue de ma part en passant le vieux rocher de Balclutha où Wallace planta son drapeau, et rapporte-moi demain les informations que tu auras recueillies sur ces notes que j’ai rédigées de façon à ne pas embarrasser ton esprit. – Écoute encore, Daniel, prends de l’or, et ne manque pas de finir tes courses chez mistress Speaker, et d’y souper d’un bon ptarmigan de montagne, arrosé de vin de Porto. Quant à moi, je t’attendrai en dormant, parce que c’est la meilleure de toutes les manières de passer sa vie dans une grande ville.
Je m’éveillais à peine, en effet, quand Daniel s’arrêta le lendemain au pied de mon lit, à la même heure et dans la même position, en tournant dans ses mains son bonnet de loutre.
— C’est toi, Daniel ! assieds-toi, lui dis-je, et procédons par ordre. Michel est-il arrivé à Greenock ?
— Il n’y a pas d’apparence, monsieur, à moins que les fées auxquelles les bonnes gens de Glasgow attribuent sa délivrance ne l’aient rendu invisible. Il n’y a personne à Greenock qui ne s’en souvienne, personne qui ne le regrette, qui ne le plaigne et qui ne l’aime ; et personne ne l’a revu. Tout ce qu’on sait de lui, c’est qu’il est parti de Greenock il y a six mois, en laissant la direction et les profits de ses chantiers à la famille de maître Finewood, et qu’il n’a donné depuis aucune de ses nouvelles. On craint qu’il ne soit mort, et on pleure.
— Tu as fait sagement, Daniel, de ne pas affliger les Finewood de l’idée humiliante de sa détention à la maison des lunatiques. Le souvenir d’une honte non méritée qui s’attache au nom d’un ami nous est quelquefois plus pénible encore que sa perte. Mais tu ne m’as rien dit de l’intérieur de cette république de charpentiers ?
— C’est un charme que de la voir. Ils m’ont fait asseoir à leur table, monsieur, et je vous jure qu’il n’a jamais rien existé de pareil, même dans nos clans des Highlands, depuis le temps des patriarches. Représentez-vous le père Finewood et sa femme entourés de leurs six filles, de leurs six gendres, de leurs six fils, de leurs six brus et de leurs douze petits-enfants pendus à la mamelle de leur mère, car toutes les filles de maître Finewood ont eu le même jour, au bout de neuf mois, un petit garçon qui s’est appelé Michel, et tous ses fils, un mois plus tard, une petite fille qui s’est appelée Michelette ; mais ce qui peut passer pour un véritable miracle de nature, c’est qu’il n’y a pas un des marmots qui ne porte sur le sein gauche une jolie fleur des bois, si vivement enluminée en sa couleur, que la main s’étend involontairement pour la cueillir. Il faut que ce soit un phénomène bien rare, puisque le même signe ne se retrouve que sur un autre enfant de Greenock, et peut-être de toute la Grande-Bretagne. C’est aussi un garçon, né, dit-on au même instant que les autres, et qui est le fils d’une certaine Folly Girlfree et du maître du calfat.
— Ce qui m’étonnerait, Daniel, c’est que, familier comme tu l’es avec les plantes de mon herbier, dont je t’ai souvent confié le soin, à ma grande satisfaction, tu n’eusses pas trouvé moyen de comparer cette fleur à quelque fleur qui t’est connue, si ses caractères étaient aussi bien déterminés que tu le dis.
— Ma foi, monsieur, je vous dirai qu’elle m’a fait le juste effet d’une mandragore !
— Après, Daniel, après ! N’aurais-tu pas perdu trop de temps à t’égayer chez le charpentier, pour arriver de bonne heure sous les murs de l’arsenal, quoique bien averti que la maison de la Fée aux Miettes n’était pas facile à trouver ?…
— Oh ! que je l’aurais bien trouvée si elle y était, monsieur, fût-elle aussi petite que la cage aux claies de bois où siffle la linotte du savetier, car j’ai l’œil plus fin qu’un chat-pard ; mais âme qui vive à Greenock n’a ouï parler de la Fée aux Miettes ; et quant à sa maison de l’Arsenal, il faut que ces messieurs du génie l’aient fait démolir.
— Tu as au moins soupé chez mistress Speaker, comme je l’avais exigé ?
— D’un excellent ptarmigan de montagne et d’une bouteille de vin de Porto.
— À la bonne heure. Il est impossible que tu n’y aies pas appris quelque chose ?
— Comment ! monsieur, si j’y ai appris quelque chose !… Le ptarmigan est certainement, de tous les oiseaux de la terre et du ciel, celui dont les sucs se marient le mieux avec l’assaisonnement mordant et aromatique – je crois que c’est le mot – d’une sauce à l’estragon.
— Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, Daniel. Mistress Speaker peut-elle avoir oublié Michel ?…
— Oublié Michel, la digne femme ! oh ! ne l’en accusez pas ! Si j’avais voulu l’écouter sur ses louanges, il y en avait pour huit jours, quoiqu’elle n’ait pas une grande estime pour son jugement ; mais aussitôt que j’eus entrepris de lui toucher un mot de cet homme à la tête de chien danois dont il est parlé dans votre pancarte, elle faillit m’arracher les yeux.
— C’est bien à moi, dit-elle, miss Babyle Babbing, veuve Speaker, qu’on vient débiter de pareilles bourdes ! Il faut que vous ayez le front de votre mère, Niel, pour vous évertuer ainsi en folâtreries avec une femme respectable, et je ne sais ce qui me tient de vous faire harceler par les deux maîtres dogues qui couchent dans ce pailler. – Là-dessus je n’insistai pas.
— Et tu fis sagement, Daniel ! – Mais t’es-tu informé de Jonathas ?
— Jonathas est plus mort que vivant, monsieur ; mais il n’est pas mort tout-à-fait.
— Je le crois bien, vraiment ! Le traître aura placé de l’argent à fonds perdu.
— Monsieur n’a-t-il plus rien à me commander ? reprit Daniel après un moment de silence.
— Eh quoi donc, Daniel ? des chevaux, des chevaux et le monde entre l’Écosse et nous !
…
____________
Pendant que je me reposais à Venise des fatigues d’un long voyage, et que j’oubliais, dans l’agitation sans but des Casini et du Ridotto, les émotions plus profondes que j’avais ressenties en quelques heures à Glasgow, je fis connaissance au café Quadrid’un personnage sérieux et concentré dont les habitudes méditatives m’avaient désarmé des préventions contraires que m’inspirait sa physionomie. C’était un homme sec, étroit, anguleux, à l’œil pointu, aux regards coniques, – et après les regards directs, je ne fais cas que des regards divergents, – à la parole haute, claire, brève et décidée, aux mouvements isochrones et à l’inflexible perpendicularité. L’espèce de soliloque intérieur auquel il paraissait incessamment livré ne pouvait avoir d’objet, selon moi, qu’une contemplation rêveuse et austère de quelque haute vérité morale. Au bout de quelques entretiens de bienséance qui ne duraient jamais longtemps, à cause des profondes préoccupations qui absorbaient ce grand homme, j’appris par un mot échappé à sa distraction pensive, et qu’il s’empressa de racheter, j’en dois convenir, par les formules les plus humbles de la modestie, tant il appréciait à sa juste valeur la lourde responsabilité d’une telle gloire, j’appris donc qu’il faisait partie de l’académie des lunatici de Sienne, et qu’il était venu à Venise pour y chercher des auxiliaires à son opinion, dans la double querelle qui divisait, à forces exactement égales, les membres de cette illustre assemblée.
— Les lunatici de Sienne ! m’écriai-je en l’entraînant brusquement sur la place Saint-Marc, où le soleil brillait de toute sa splendeur vénitienne par une belle matinée de dimanche. – Les lunatici de Sienne, dites-vous ? La raison expérimentale de l’espèce fait-elle enfin de jour en jour des progrès plus rapides ? le sentiment et la fantaisie reprennent-ils partout la place qu’ils n’auraient jamais dû perdre, parmi les plus saines occupations de l’esprit ? Oh ! monsieur, votre académie des lunatici aura bientôt des succursales sur toute la terre – je ne lui parlai cependant pas des lunatiques de Glasgow – ; mais apprenez-moi, de grâce, continuai-je, quelles sont les questions ardues qui ont trouvé si peu d’harmonie dans un conseil si judicieux ? Je brûle de les connaître.
— La première, me répondit-il avec une affabilité composée, n’est pas d’une nature aussi grave que vous pourriez le croire ; mais plus elle sort du cercle des études vulgaires, plus elle est propre, comme vous savez, à exercer les utiles loisirs des académies. C’est de savoir si quand Diogène fricassait les congres qui lui attirèrent un si méchant sarcasme de la part d’Aristippe, il les fricassait à l’huile ou au beurre.
— Par le soleil qui nous éclaire, dis-je en le regardant en face pour m’assurer qu’il ne se moquait pas, si je m’en rapporte aux usages naturels du pays, et à la dernière mercuriale d’Athènes antique, ce devait être de l’huile ; mais je ne vous donnerais pas une tranche de zucca pour le savoir.
— La seconde, reprit-il avec un air un peu renfrogné, parce qu’il jugeait que j’avais traité trop lestement une question de cette importance, – la seconde, monsieur, touche aux intérêts moraux les plus profonds, j’ose même dire métaphoriquement, aux entrailles maternelles de notre belle Italie.
— Ah ! voilà des questions ! et celles-là méritent, en effet, d’être débattues avec chaleur entre des hommes éclairés et sensibles !
— Que pensez-vous, monsieur, poursuivit le lunatique de Sienne, qu’il fût arrivé des destinées éventuelles du pays, si Pompée, à la bataille de Pharsale, au lieu de disposer en échelons sa cavalerie, qui manqua par là l’occasion d’envelopper l’aile gauche de l’ennemi, l’avait établie en potence sur une verticale immédiatement appuyée à la première horizontale de son front de guerre ?
— Je pense, monsieur, que je m’occuperais davantage et plus utilement avec le poète Villon, de ce que deviennent les neiges d’antan et les vieilles lunes, et que si telles sont les occupations et les disputes de votre académie des lunatici, elle a indécemment usurpé le nom des hommes les plus intéressants, et, selon toute apparence, les plus raisonnables de la terre ! –
Je m’inquiétai peu de sa réponse, car, du temps que je lui parlais, mon oreille avait été délicieusement avertie par ce cri qui a toujours éveillé en moi une vive sympathie :
— Voilà, voilà, messieurs, la véritable bibliothèque merveilleuse, tout ce qu’il y a de plus extraordinaire et de plus nouveau, la Malice des femmes, la Patience de Griselidis, les Amours de la fée Paribanou et du génie Eblis, l’Histoire pitoyable du prince Erastus, les Prouesses des deux Tristans ; les voilà, messieurs, les voilà, pour la bagatelle d’une demi-lire. –
Et, pendant que je courais, je voyais flotter au vent les banderoles multicolores du crieur enroué, qui continuait à brandir fièrement, devant la foule, ses petits livrets bigarrés de jaune et de bleu, et qui reprenait sa litanie de plus belle à l’arrivée de chaque acheteur :
— Voilà, voilà, messieurs, les superbes aventures de la Fée aux Miettes, et comment Michel le charpentier a été enlevé de sa prison par la princesse Mandragore ; comment il a épousé la reine de Saba, et comment il est devenu empereur des sept planètes ; les voici avec la figure !
— Donne, donne, m’écriai-je en lançant fièrement une lire au travers de son échoppe ambulante, et en saisissant la brochure au vol. –
Quand je m’arrêtai pour y jeter un regard, je trouvai mon académicien à mes côtés. Ses traits portaient l’empreinte d’un mélange de consternation et de colère.
— Que vous proposez-vous de faire de cela ? me dit-il rudement.
— La dernière et la plus douce de mes études, lui répondis-je en passant, car le livre que vous voyez renferme plus de choses affectueuses, raisonnables et d’un profitable usage pour le genre humain, qu’il n’en entrerait en mille ans dans les mémoires de l’académie des lunatiques de Sienne.
Et je le tiens pour plus moral et même pour plus sensé, continuai-je en marchant toujours, que tout ce que les savants ont écrit depuis que l’art d’écrire est un vil métier, et la science une sèche, rebutante et sacrilège anatomie des divins mystères de la nature ?
Et j’avance hautement que de pareils livres influeraient d’une manière bien plus essentielle sur le perfectionnement moral de l’éducation d’un peuple intelligent et sensible, que toutes les babioles pédantesques de quelques méchants philosophastres brevetés, patentés et appointés, pour instruire les nations ! –
J’aurais mieux fait que de l’avancer. Je l’aurais prouvé par raisons démonstratives, si le volume ne m’avait été pris avec tout mon bagage par une bande de Zingari, pendant que je dormais comme un enfant, plongé dans un doux rêve au fond de ma calèche, sur les bords du lac de Côme.
— Heureusement, Daniel, dis-je en me réveillant, que ces pauvres Zingari s’en trouveront bien.
— Je le crois comme vous, répondit Daniel… s’ils le lisent. –
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique